

prod. James Benning
ALLENSWORTH
James Benning | États-Unis | 2023 | 65 minutes | Forum
Regarder un James Benning en plein festival s’apparente à une promenade méditative dans le parc, à l’assurance du calme et du thème lentement établi, de la vision qui s’aligne à l’idée à la vitesse de l’air qui circule dans l’image et de la poussière qui retombe au fil des minutes qui immobilisent chaque plan parfaitement composé sous ses allures de normalité sous-estimée. Allensworth porte sur le petit village du même nom, fondé en Californie en 1908 par une communauté afro-américaine excentrée, la première à avoir fondé son propre village dans le Golden State, à s’être autogérée, à avoir fièrement revendiqué le statut de communauté noire autonome.
Benning y plante sa caméra au fil d’une année et de ses saisons. Sur 12 mois il y aura 12 plans pour 65 minutes, une auscultation contemplative, parfaitement composée, avec des cadres qui jouent de l’aridité fantomatique du paysage, de son herbe toujours un peu mourante, de ses bâtiments restaurés parfaitement droits et peints d’un blanc qui clame l’innocence perdue des lieux. Le soleil décline à travers la temporalité allongée des images, révélant des ombres qui découpent les charpentes pendant que le son d’un train au loin passe et repasse au fil des mois, avant qu’on finisse par le voir en mai, comme un serpent qui gronde, affichant par son passage enfin relié au son toute l’indifférence des rails qui contournent cette bourgade oubliée. Durant l’été, Benning se détourne exceptionnellement de son ascétisme habituel, conviant une jeune Afro-américaine à venir réciter dans une salle de classe abandonnée, habillée comme une étudiante de 1910, la poésie de Lucille Clifton et de Elizabeth Eckford qui résonne parfaitement dans l’espace à la manière d’une incantation pour rassurer les gens qui y ont déjà habité. À cela s’ajoute du gospel, du blues, les voix de Nina Simone, de Huddie Ledbetter.
Le plus curieusement du monde, Allensworth m’a rappelé dans la sélection de cette 73e Berlinale le film hyperactif de Makoto Shinkai, Suzume, qui raconte l’histoire d’une héroïne éponyme qui doit parcourir le Japon afin de fermer des portes apocalyptiques en tendant l’oreille face aux ruines : écouter ses anciens habitants, retenir leur douleur, la soutenir avec eux. C’est cet exploit que Benning parvient à lentement inscrire en 12 plans, sur son tableau vert à lui, écrivant lentement, effaçant tout aussi lentement au fil de ses images, nous amenant à tâtons à saisir la vitalité passée face à l’ignorance actuelle, à rendre un hommage qui soit aussi celui d’un acte de mémoire engagé. Dans ses derniers plans, Allensworth se concentre sur les tombes des gens qui ont vécu dans cette communauté, qui au final n’aura été qu’une utopie de quelques décennies avant que les autorités ne découvrent une contamination à l’arsenic dans ses installations d’eau potable. Au loin, au fond des cadres d’un automne qui s’assombrit, l’Amérique contemporaine se pointe le bout du nez sous la forme d’un parc de roulottes, abritant aujourd’hui une communauté sans institution municipale et occupée à 95% par des hispanophones vivant dans la précarité totale de leur excentrement. Au rêve d’autonomie s’est succédé la réalité de l’esclavage capitaliste ou, comme l’écrivait Lucille Clifton : « God bless America. You don’t know the half of it. What I don’t know is the other. » (Mathieu Li-Goyette)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2023
Prochaine projection : 11 octobre à 19h00 (Cinémathèque québécoise)

prod. Bunbury Films
L’OURAGAN FUCK YOU TABARNAK !
Ara Ball | Québec | 2023 | 110 minutes | Compétition nationale
Même si la riche production (avec ses belles images lustrées tournées en steadicam et sa distribution cinq étoiles) donne un aspect institutionnel à cette version (archi)longue du court métrage éponyme de 2013, force est de constater qu’il conserve assez de son esprit punk pour plaire. Le grand dynamisme de la caméra, les bris constants du quatrième mur, la bande sonore musclée, l’iconoclasme hyper appuyé et la grande vulgarité de l’œuvre lui injectent du moins une certaine énergie transgressive qui fait beaucoup de bien dans le paysage du drame familial québécois. Ils lui insufflent une sorte d’ardeur brûlante qui conjure la glaciation émotionnelle tout en déployant une crudité candide qui aide à faire passer ses faiblesses narratives et dramatiques. À ce titre, on note d’ailleurs que le texte possède une texture prolétaire appréciable, exempte de la poésie d’un Léolo (1992), mais de sa littérarité également, de sorte qu’on s’imagine parfois un ersatz contemporain du classique de Lauzon, particulièrement dans sa représentation carnavalesque du Hochelaga des années 1990. On est surtout content de voir que le film nous offre une façon de penser la société différemment, se profilant parfois comme une capsule publicitaire pour une sorte d’utopie anarchiste, où la vie communautaire nous apparaît comme une alternative idéale aux institutions sociales.
L’Ouragan, c’est le surnom que se donne le jeune Delphis Denis (Justin Labelle), alors qu’il décide un jour de ne plus s’en faire imposer et de cesser d’obéir aux règles sociales après avoir été expulsé de son école de quartier. Il quitte ainsi son père rugueux et colérique (Patrice Dubois) et sa mère paumée mais aimante (Larissa Corriveau), puis rejoint un groupe de punks vivant dans une commune après avoir passé un dur moment dans la rue. Or, s’il occupe l’avant-plan, c'est aussi parce que le récit d’apprentissage de Delphis, qui doit assimiler la notion de partage et évacuer le sexisme et l’homophobie issus de son milieu, est plus intéressant et édifiant que le mélodrame parallèle impliquant sa mère, son jeune frère et la DPJ, surtout que la gamme émotionnelle des interprètes (notamment celle de Labelle) s’avère parfois limitée. Il est particulièrement outrageant de constater le sort que le film réserve au personnage de Corriveau, dont on instrumentalise le calvaire à des fins narratives aussi secondaires. On aurait parfois envie de répéter à Ball et aux organismes subventionnaires la leçon que les punks tentent d’inculquer à l’Ouragan selon laquelle il importe de ne pas trop se prendre au sérieux… Quoiqu’il en soit, l’expérience du film demeure pourtant assez revigorante, même si elle n’est pas totalement mémorable, à l’instar d’une rasade de fort ou d’un spectacle de musique punk. En tant que Montréalais, je ne peux pourtant pas m’empêcher de lui reprocher son accablante géographie, alors que, d’un plan à l’autre, on passe de Saint-Henri à Rosemont ou qu’on voit les personnages embarquer dans le métro à la station Fabre pour en sortir… à la station Fabre ! (Olivier Thibodeau)

Monster est une forme de film-mensonge, un récit initialement énigmatique, rempli à ras bord de fausses pistes et d’angles morts. Il se présente d’abord comme l’histoire de Saori (remarquable Sakura Andō, qui avait impressionné dans Shoplifters [2018]), mère monoparentale du jeune Minato, qui commence à s’inquiéter du climat scolaire dans lequel évolue l’enfant lorsqu’il revient à la maison chaque jour plus tourmenté. Le visage atterré, Minato se déclare monstrueux, « un humain auquel on aurait greffé un cerveau de porc », et avoue finalement, sous le regard insistant de sa mère, que l’insulte proviendrait d’un professeur tortionnaire. Saori tente d’intervenir auprès d’une direction scolaire muette, seulement soucieuse de protéger sa réputation en taisant l’affaire au plus vite sous un langage abscons et réducteur. Ces séquences présentent un des intérêts typiques de Kore-Eda, à savoir comment le noyau familial (biologique ou non) s’inscrit en relation, mais surtout en opposition à la violence des institutions dans lesquelles elle s’inscrit. Le lien entre Saori et Minato, marqué par l’inquiétude, le deuil d’un père à la présence fantomatique, mais surtout par une tendresse réciproque, est ainsi caractéristique des plus beaux récits du cinéaste. Puis rapidement, au moment où la tension principale semble bouclée, le film revient en arrière, reprend son récit en s’intéressant à un second personnage et en nous dévoilant la partialité de notre perspective initiale. Serait-il probable, tout compte fait, que le monstre pointé du doigt ne soit qu’un bouc émissaire, et que la violence qui s’y soit mue ait été plus complexe, dissimulée sous des mensonges ?
À travers ses trois segments successifs et les transferts du blâme qui s’y effectuent, Kore-Eda dévoile petit à petit le sujet qui sous ses silences l’intéresse : l’homophobie ambiante qui vient structurer toute une performance de la masculinité apposée avec attentes sur ses personnages de jeunes garçons. Reste à savoir si le dévoilement de ces enjeux en tant que mystère à découvrir dans le cadre d’un quasi-récit d’enquête reste la manière la plus approfondie de s’y intéresser, ou si la grammaire humaniste de Kore-Eda peut être employée à bon escient pour réfléchir l’injure déshumanisante. La métaphore visuelle répétée d’une saleté terreuse, s’accrochant aux corps et aux vêtements des enfants, et s’opposant au travail répété de nettoyage entrepris par les adultes, est peut-être elle aussi quelque peu simpliste. Monster est d’ailleurs tendu entre une représentation de la violence en tant qu’ambiance structurale et un désir scénaristique de la personnifier en un individu identifiable, rendant fortement incertain le potentiel proprement politique du film. Il reste que Kore-Eda conserve son statut de maître du mélodrame (à l’aide de la dernière bande-son signée Ryūichi Sakamoto, particulièrement efficace ici) et s’impose toujours comme un grand cinéaste de la douceur, triomphant dans les moments de détente, de jeux innocents et de complicité enfantine. Si les moments de tragédie apparaissent comme des ressorts scénaristiques un peu trop grossiers, c’est dans l’improvisation de conforts utopiques ou dans la profondeur saisissante d’une rencontre inopinée que la touche mélo appuyée de Kore-Eda réussit, toujours, à nous atteindre. (Thomas Filteau)
Prochaine projection : 12 octobre à 20h30 (Cinéma du Parc - Salle 1)

prod. faktura film
MUSIC
Angela Schanelec | Allemagne / France / Serbie | 2023 | 108 minutes | Compétition
Je ne sais pas trop où me situer par rapport à ce film singulier, à la fois impénétrable et fascinant, sensuel et froid, détaché et passionnel (particulièrement dans la performance de l’art titulaire qui permet à l’anti-héros de transcender son imparfaite carcasse). Je sais seulement que c’est l’œuvre la plus intéressante que j’ai vue aujourd’hui, en ce mercredi lumineux où ce sont les ersatz argentins de Sophie Bédard-Marcotte et les Hospitaliers ukrainiens qui ont accaparé le reste de mon temps. D’entrée de jeu, je dois admettre que je ne suis pas familier avec le travail d’Angela Schanelec, dont on me dit qu’il est « malade mental » ; il s’agissait ici pour moi d’une première incursion confondante dans son cinéma. Parce que derrière sa prémisse banale (une jeune agente pénitentiaire tombe amoureuse d’un détenu inculpé pour homicide involontaire, dont elle apprend trop tard le nom de sa victime), Music est un film dramatique exempt des ressorts hollywoodiens traditionnels, de sa chronologie nette et de ses enjeux clairement définis ; c’est un film qui raconte moins une histoire qu’il nous la laisse inférer, ne cédant jamais à la facilité des dialogues — il y a en très peu dans le film, la voix servant surtout à l’expression opératique de l’intériorité des personnages — pas plus qu’à la lisibilité de gestes. Ce sont des actions subtiles et des paysages vaporeux dont on tire le substrat de l’œuvre, au gré d’un récit troué de profondes ellipses où c’est le public qui doit faire lui-même des ponts entre chacun des îlots temporels qui constituent l’archipel narratif du film. S’il avait survécu à mon parcours universitaire, l’enfant monstrueux que j’ai fait avec Gilles Deleuze me dirait sans doute qu’il s’agit ici d’un exemple d’image-temps.
Music se laisse d’abord découvrir tranquillement, langoureusement, à travers une série de tableaux méditerranéens tournés en plans grand ensemble, où se joue un drame familial très succinctement esquissé qui implique la rescousse d’un bébé dans une masure montagnarde par deux urgentologues qui adopteront l’enfant, puis l’amèneront avec eux lors d’une journée à la mer. Un raccord nous transporte ensuite subrepticement une quinzaine (ou est-ce une vingtaine ?) d’années dans le futur, au moment de l’homicide, dont le déroulement est si mystérieux qu’il rappelle celui de l’Arabe dans L’Étranger de Camus. Le reste de la trame se déploie de façon moins ambiguë, relatant l’histoire d’amour entre le coupable à la voix d’or et l’agente correctionnelle candide qui tombe pour lui au premier regard, jusqu’à l’adolescence de leur enfant, dont la maturation s’effectue par bonds elliptiques prodigieux de plusieurs années — on ne sait jamais vraiment quel âge ont les personnages, mais c’est aussi ça le propre du film, soit la culture de l’insaisissable essence des êtres. De naissance en naissance, on passe de mort en mort également, au sein d’un cycle naturel qui n’a pas tant d’égard pour la substance « sacrée » de la vie humaine. C’est cela d’ailleurs qui m’avait perturbé au premier abord, soit le caractère antidramatique des séquences funestes, mais c’était là le fruit de mon âme romantique, nourrie à l’iconographie judéo-chrétienne, que j’ai heureusement su ranger au placard en cours d’écriture, pour réaliser que le film nous suggère en fait l’existence de quelque chose qui transcende l’humanité individuelle, soit ce cycle vital dont les humains font partie, mais surtout… la musique (et plus largement, l’art), dont l’enregistrement nous rendra immortels de toute façon. (Olivier Thibodeau)
*Texte originellement publié dans notre couverture de la Berlinale 2023
Prochaine projection : 9 octobre à 19h15 (Cinémathèque québécoise)
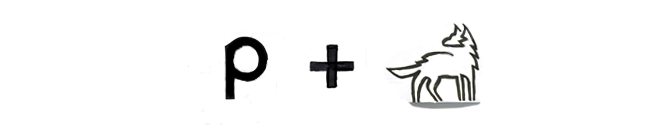
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
