
Quelques réflexions autour de Media City : le paradoxe contemporain de l’avant-garde
On s’immerge pendant une semaine dans un cinéma surplombé de l’adjectif « expérimental » qui, disons-le, a souvent deux fonctions. D’abord permettre aux festivals mainstream d’enfermer certaines pratiques dans des programmes « fourre-tout », les excluant des compétitions pour ne jamais, ô grand jamais, mettre en doute les formes normatives et dominantes du « vrai » cinéma. Ensuite qualifier une renaissance analogique qui commence à battre de l’aile, s’appuyant inlassablement sur la préciosité de son celluloïd pour faire perdurer une tradition où la notion d’expérimentation, au sens de recherche de nouvelles formes, n’existe plus. Il faudrait un texte, un jour prochain, pour vraiment discuter ce phénomène (les chroniques de Mike Hoolboom s’y frottent déjà un peu), mais cette remarque me semble essentielle alors que la deuxième soirée du Festival Media City s’achève.
Je sors du programme #3 habité par une colère noire, c’est-à-dire pris de tremblements épidermiques, le ventre politiquement bouillonnant. Par certains aspects, et loin de moi l’idée d’une condamnation définitive puisque je possède moi aussi un attachement particulier au grain de la pellicule, la programmation de Media City participe de la deuxième définition d’ « expérimental » précédemment établie. Si l’amour du celluloïd n’a rien de problématique en soi, il est à l’origine de ce que j’appellerais le paradoxe contemporain de l’avant-garde. Le terme, hérité du siècle passé, invoque sémiotiquement l’idée d’un cinéma visionnaire. Or, le passage à une résistance analogique nous fait basculer dans l’époque du laboratoire, qui reste un espace marginal, mais devient animé d’une force de préservation des pratiques, et non plus d’un élan de révolution des images. C’est là que le terme d’avant-garde montre toute sa désuétude et initie un trajet dangereux que j’exprimerais par l’interrogative : peut-on prétendre à un cinéma expérimental quand notre vision est imprégnée d’une lecture passée — j’hésite à dire « passéiste » — du monde ?
Avant d’aborder les deux films qui m’ont mis dans cet état, il faut noter autre chose. Il n’y a plus, ou très peu, de critique de cinéma expérimental et ceci pour plusieurs raisons, dont celles-ci :
1. Il s’agit évidemment de pratiques marginales, et souligner les défauts d’œuvres qui peinent déjà à exister dans le contexte artistique contemporain a quelque chose de vain, voire de contreproductif.
2. Un film expérimental n’est pas bon ou mauvais. À vrai dire, je mettrais quiconque au défi de voir la programmation de Media City et de ne pas trouver dans chacune des œuvres présentées au moins une image, une idée, un processus, une intention bien plus inspirante que tout ce que l’on peut trouver dans des films distribués sur tous les écrans et récompensés par une pléthore de festivals décérébrés. Cependant, la réception de ces films se fait dans la chair et la sueur : pas question ici de discuter des faiblesses du scénario ou de dialogues moyens, ce que l’on discute c’est une démarche et un positionnement, alors on s’investit corps et âme dans un film ou bien chacun de ses photogrammes provoque chez nous une réaction urticante. J’exagère le trait, mais on comprend l’idée.
À ces deux notions, expédiées rapidement, j’aimerais répondre en décalant le regard. D’abord, je crois que légitimer le cinéma expérimental, c’est lui accorder le droit au même traitement que les autres cinémas. Se confiner à parler uniquement des films expérimentaux que l’on aime tend à uniformiser les textes, et ne rend pas justice à un espace en constante ébullition. Ensuite, toute critique qui puisse être formulée contre ces pratiques relève d’un positionnement artistique, et ce type de discours n’attaque aucunement les artistes ou ne tend pas à faire disparaître des pratiques. Au contraire, il s’envisage comme l’ouverture d’un dialogue.
Ces remarques préliminaires évacuées sommairement, il est désormais temps de revenir aux deux films qui ont provoqué ce bouillonnement. Il s’agit moins ici d’élaborer de véritables commentaires, mais d’ouvrir des questions qui s’adressent plus largement aux cinéastes, critiques, programmateurs ou spectateurs que les lignes précédentes n’ont pas trop rebuté.
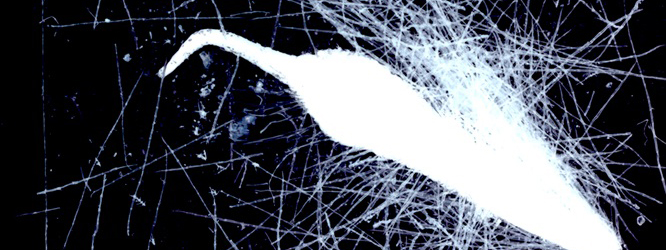
prod. Adam Piron
YAANGNA PLAYS ITSELF
Adam Piron | Kiowa, Mohawk | 2022 | 16mm | 7 minutes | Compétition internationale
Le film s’ouvre sur un texte défilant de bas en haut. On y aborde l’histoire d’El Aliso, un sycomore ancestral abattu en 1895 après quatre siècles d’existence physique et spirituelle à Yaangna, le village autochtone transformé en centre-ville de Los Angeles par quelques bûcherons coloniaux. Piron prend le temps d’invoquer l’histoire, il préfère la longueur du texte à la brièveté pour exprimer l’importance qu’il accorde à dire les choses, exposer les forces en présence, l’âme des choses et la violence qui leur a été infligée. Puis, le film se transforme en exploration minérale. Sa description dans le catalogue du Festival explique que tous les éléments accolés au celluloïd sont issus du territoire réel et imaginaire de Yaangna. L’image frémit dans un sombre azure granulaire, le clignotement s’intensifie, puis le noir revient.
La pellicule devient trace directe des souvenirs, de la terre bafouée et incarne même par-là l’espoir de reconstruire une culture déracinée à partir de ses résidus naturels. C’est là que gît la puissance du film, pourtant je ressens une gêne sincère après le visionnement. Cette image bleue, ces textures analogiques me font penser à mon voisin quand je lui ai parlé maladroitement de cinéma expérimental ; il me semble que l’image que j’ai aperçue dans le reflet de sa pupille ressemblait trait pour trait au film de Piron. Un brouhaha visuel qui ne peut se saisir que par le déploiement conceptuel d’un paratexte de catalogue. S’il s’agit de redonner la force à une culture, ce geste abstrait — malgré la puissance d’une parole détachée des codes d’un alphabet, d’une langue et d’un cinéma coloniaux — parvient-il à redonner la parole à ceux pour qui il prétend la prendre ? Je saisis toute l’ampleur artisanale, matérielle, métaphysique même de la proposition et pourtant, impossible de ne pas y voir les tropes d’une tradition d’altération de la pellicule qui supplante peut-être le propos du film. Il n’y a pas de « bonne manière » de faire des films, c’est bien contre cette idée que se dresse le cinéma expérimental, mais nos approches héritées sont-elles aujourd’hui les plus pertinentes pour aborder des thématiques si complexes ?
Une dernière note : un film n’est pas détaché de son environnement. Je me réconcilie avec Yaangnaen en écrivant ce texte. Adam Piron est membre fondateur du collectif COUSIN, qui encourage et soutient des cinéastes autochtones ; il est aussi directeur de l’Indigenous Program au Sundance Institute. L’être cinéaste s’étend au-delà des films, la pensée déborde des photogrammes et toutes les critiques que je peux soulever ne trouveront pas de réponses sur la seule base d’une analyse filmique quand celle-ci porte en son sein un rapport aux lieux, aux individus, à une implication collective au cœur de l’idée de dialogue.

prod. Sam Drake
BODY LEGATO
Sam Drake | États-Unis | 2022 | 16mm | 6 minutes | Compétition internationale
La ville, une pelle mécanique, l’atelier d’un boucher, les cimes des arbres et la noirceur du béton. Le film de Sam Drake est une réflexion poétique et politique sur les espaces habités et sur notre rapport aux corps (vivants et bitumeux). Par un collage de séquences en 16 mm qui joignent la tradition du ciné-journal (filmer le quotidien) et de la musique visuelle (penser le film comme une composition musicale où les photogrammes sont des notes), la cinéaste américaine nous plonge dans une méditation critique sur l’espace urbain. La poésie du montage est indéniable et se construit autour du changement d’échelle : là les mains découpant la viande, ici un train en vue aérienne plongeant dans l’infini du paysage. Par ce procédé, le film fait dialoguer différents modes de représentations et différentes manières d’habiter l’espace. Ce regard finit par développer un discours existentiel mélancolique qui, par certains aspects, se perd dans un alarmisme éculé.
On saisit la justesse avec laquelle est développée l’idée d’une beauté bousculée par la violence banale de notre monde ; j’ai pourtant le sentiment que cette fable existentialiste appartient à un autre temps. L’ombre de Fernand Léger plane sur ce ballet mécanique, mais le cinéma est devenu parlant. Qu’ont-ils à dire ces bouchers que l’on filme comme des corps désincarnés ? Pourquoi nous exposer à l’ultra-violence d’un coyote abattu ? Quel rapport la cinéaste entretient-elle à ces travailleurs ? Aucune réponse, ni dans l’image ni dans les mots absents. C’est que le film est une mélodie et non un discours. Encore une fois, la même question : que faire de nos traditions ? Comment sauver les photogrammes sans se laisser tomber dans le piège de la répétition d’une valse en faux temps ?
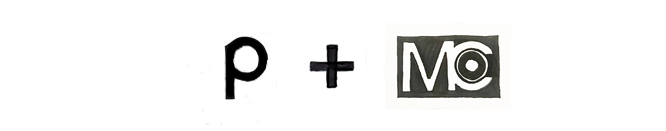
PARTIE 1
(III., ANTFILM,
The Newest Olds, Workshop)
PARTIE 2
(« Quelques réflexions autour de Media City :
le paradoxe contemporain de l'avant-garde »,
Yaangna Plays Itself, Body Legato)
PARTIE 3
(The Secret Garden, Mast-Del,
The House Is Black, Super 8 Constellations)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
