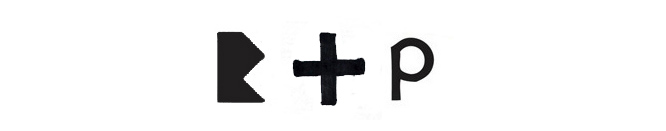THE BOTANIST
M. Plante-Husaruk et M. Lacoste-Lebuis | Québec | 2016 | 20 minutes | Compétition nationale courts et moyens métrages
Pour un premier film, il faut dire que celui de Maude Plante-Husaruk et Maxime Lacoste-Lebuis n’est pas piqué des vers. Bien mené jusqu’au bout de son projet simple mais pas simpliste,
The Botanist traite du quotidien surprenant de Raïmberdi Mamatumarov, formé à la botanique et à l’électronique et suffisamment pour avoir répertorié dans son propre cahier d’herboriste une pléthore de plantes affublées de leur nom latin. Dehors, une turbine hydromoteur qu’il a lui-même construite avec de vieux appareils fournit de l’électricité pour sa maison. Il rêve même de l’améliorer, question d’en tirer du 220 volts. Dans les ruines de l’URSS, dans ce Tadjikistan de steppes arides, le botaniste est un peu comme un bucheron dans le désert, sans grande variété autour de lui, tellement qu’il les oublie peu à peu, usant du savoir qui sommeille derrière son apparence de berger pour transformer sa condition de vie. Même dans le village du coin, Raïmberdi est un agent du progrès, puisqu’il y travaille comme professeur, léguant aux générations futures une formation, mais aussi ses précieuses leçons de vie dont il regorge. Et si, comme il le dit si bien, c’est souvent la vie qui nous force à faire des choses, il faut dire que la caméra du duo de cinéastes suit elle aussi le cours de cette vie, sachant adroitement faire le point au bon moment, sur le bon sujet, livrant le tout dans une esthétique qui fait honneur au botaniste et à son visage éloquent.
(Mathieu Li-Goyette)
 BROTHERS IN THE NIGHT
BROTHERS IN THE NIGHT
Patric Chiha | Autriche | 2016 | 88 minutes | Compétition internationale longs métrages
Ce film sur la prostitution masculine à Vienne – un monde viril, un monde de nuit, un monde violent – commence, étonnamment, sur de somptueuses images du Danube, filmé en plein jour, sur la très sophistiquée musique de Gustav Mahler. Or, très vite, le soleil s’éclipse, le fleuve n’est plus qu’un souvenir vague et la symphonie lentement s’amenuise. Nous entrons dans un monde où les émotions auront du mal à s’ancrer. De jeunes immigrants bulgares, complètement avinés, venus dans la capitale autrichienne pour « faire de l’argent », discutent sèchement entre eux et se dirigent vers le bar où ils consommeront de la bière comme les clients leurs bites. C’est sous les conseils d’un ami que le réalisateur Patric Chiha pénètre, un soir, dans ce débit, véritable antre de la prostitution masculine, afin de donner le branle à un documentaire « très sérieux » sur l’immigration et l’homosexualité. Fasciné par ces jeunes hommes aux cheveux gominés et aux blousons de cuir, opiniâtrement agrippés à leur queue de billard, il les approche et leur propose de faire un film non « sur » eux, mais « avec » eux. Un « beau » film, prend-il soin de leur préciser. Après leur accord, il tente de les apprivoiser (comprendre : boire des hectolitres de bière et fumer d’illicites substances) pendant plus d’un an (année « déprimante, insupportable » avouera-t-il, même s’il ajoute s’être viscéralement pris d’affection pour ces jeunes) afin d’établir une sorte de plan de match. L’idée, en somme, sera toute simple : il propose à ces prostitués, pour qui l’apparat est tout – preuve, s’il en est, les nombreux moments où on les voit se regarder eux-mêmes sur des photos défilant sur leur téléphone –, de « jouer à faire un film » (plan parfait pour ces hommes jouant la carte de l’ambigüité sexuelle). Et c’est ce qui explique l’esthétique un peu pompière de ce documentaire trop enfumé, aux éclairages trop appuyés et aux costumes trop décalés, habits (de marins, de motards) qu’ils revêtent pour ne pas avoir à se mettre (à) nus. C’est aussi ce qui explique ces scènes trop longues pendant lesquelles ils déballent, dans un langage ordurier, de choquants propos envers les (ou leurs) femmes, lesquels camouflent à peine le mépris qu’ils entretiennent sans doute à l’égard d’eux-mêmes. Et c’est aussi enfin ce qui explique la facticité de certains lieux : outre le bar où ils se vendent, la discothèque où ils dépensent, l’appartement où ils croupissent, les lieux empestent tous un peu le toc. Leur seule vérité, d’ailleurs, c’est le mensonge. Un mensonge qui se dira dans une syntaxe approximative et un dialecte que le réalisateur lui-même aura eu du mal à comprendre : un peu de bulgare, un peu de romani, un peu de turc, un peu d’allemand (teinté de «
slang »). Il se serait cru dans une ONU interlope. Chiha l'admettra : ces jeunes vivent hors du temps. Ils sont à Vienne, mais de Vienne, nous ne verrons rien. Leur univers, c’est les bars, la nuit. Et il ajoute : « Je ne voulais pas partir d’un point pour me rendre à un autre. Je voulais les observer et aller là où ils me mèneraient. » Ce film – qui aurait pu se passer n’importe où – trace ainsi un cercle dont la circonférence est partout et le centre a foutu le camp. Le documentariste ne cherche pas à dire quelque chose sur ces prostitués, mais les laisse plutôt dire eux-mêmes : leur passé, leur rêve, leur crainte. Or, le passé, ils le fuient ou le refoulent, et l’avenir, ils ne l’entrevoient ni ne l’imaginent. Et du reste, ils n’ont peur de rien. Les dernières images du film – « deux semaines plus tard » – nous les montrent, dansant, s’éclatant, s’excitant, suintant à « La liberté viennoise », un bar où, se trémoussant sur des musiques bulgares, ils retrouvent leurs origines et laissent tomber la frontière de leurs orientations ambigües. Le spectateur s’ingéniera à relever les minces différences entre leur vie privée et leur vie « professionnelle ». Au terme de ce voyage, lors duquel nous les aurons beaucoup entendus se parler entre eux, et très peu vu pratiquer leur « métier », nous resterons avec ce sentiment que ce film va un peu comme va leur vie : nulle part.
(Jean-Marc Limoges)

à propos de
MANUEL DE LIBÉRATION
Un film de Alexander Kuznetsov (France, 2016) de 80 minutes.
Présenté en Compétition internationale longs métrages.
(Julie Delporte)
 TERRITOIRE PERDU
TERRITOIRE PERDU
Pierre-Yves Vandeweerd | 2011 | Belgique | 75 minutes | Rétrospective
Il n’y a probablement rien de plus triste, dans un film sur des nomades, que de les voir restreints à des intérieurs assombris, assis là par terre sans bouger parce qu’ils ne peuvent plus prendre le large. Figures abattues par la lutte et l’usure, elles sont lentement mises en opposition avec d’autres silhouettes, celles-là mobiles, toujours en mouvement, la mitraillette bien appuyée sur l’épaule. Au-delà des images poétiques, Pierre-Yves Vandeweerd nous raconte la confrontation terrible entre deux blocs : les nomades du Sahara occidental, les Sarhaouis, et les forces militaires marocaines qui les empêchent depuis 1980 de se déplacer en dehors du mur qu’ils ont construit pour s’en « protéger ». Dans un Super 8 granuleux, avec une texture qui grave en elle des images magnifiques que l’on touche des yeux, Vandeweerd allie l’état des lieux à leur exploration poétique, reprenant le concept des nomades de « gens du vide » (qui tient pour la présence invisible des ancêtres autant que pour les personnes disparues dans les camps de travail marocains) en réalisant un film sur ces gens dévidés ; de qui on a tiré méthodiquement le mince fil des moyens de subsistance et de dignité, les coupant ensuite du même geste tranchant, par ce mur bien d’actualité, de leurs terres ancestrales. Toujours par les moyens de la poésie des images qui défilent patiemment sous notre regard, le cinéaste parvient à exprimer la condition précaire des Sarhaouis, non pas dans des élans didactiques, mais bien en superposant leur parole (toujours hors champ) à de magnifiques portraits statiques, qui nous permettent de rencontrer une multitude de visages marquants que « l’égarement a rendu mélancoliques ». Vivre en nomade, nous dit ce film qui a décidé d’être hors du temps, d’être nomade pour ne jamais se restreindre au seul instant politique, ce n’est pas la même chose que vivre en sédentaire. En nomade, le territoire devient mémoire, car à son paysage comme sur la pellicule se plaque l’histoire des Hommes qui le traversent et qui y grandissent en le traversant. Et il semble que cela tienne aussi pour le cinéma de Pierre-Yves Vandeweerd.
(Mathieu Li-Goyette)
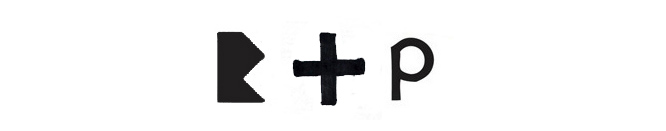
PRÉSENTATION
OUVERTURE : FUOCCOAMARE : PAR-DELÀ LAMPEDUSA
JOUR 1
(David Lynch: The Art of Life, Ta'ang)
JOUR 2
(Angry Inuk, Hier à Nyassan, Kate Plays Christine, Il Solengo)
JOUR 3
(Aim for the Roses, Fuocoammare : par-delà Lampedusa,
Dark Night, S.E.N.S., We Can't Make the Same Mistake Twice)
JOUR 4
(The Botanist, Brothers in the Night,
Manuel de libération, Territoire perdu)
JOUR 5
(Austerlitz, Combat au bout de la nuit, He Who Eats Children
Quebec My Country Mon Pays, Les tourmentes)
JOUR 6
(Brothers in the Night, Gatekeeper, The Great Theater,
Long Story Short, Speaking is Difficult, Uzu,)
JOUR 7
(A Train Arrives at the Station, Andrew Keegan déménage,
Animals Under Aneasthesia, Dialogue(s), Gulistan, terre de roses,
Isabella Morra, Manuel de libération, Non-contractual)
JOUR 8
(Calabria, Le goût d'un pays)
JOUR 9
(Le concours, The Dreamed Ones, Swagger)