DINER
Mika Ninagawa | Japon | 2019 | 117 minutes | Temps Ø



prod. knockonwood
37 SECONDS
Hikari | Japon | 2019 | 115 minutes | Panorama international
Dommage qu’il ne soit pas en compétition, puisque 37 Seconds constitue l’antidote parfait au sordide Touch Me Not (2018) d’Adina Pintilie, Ours d’or de la précédente Berlinale*. La comparaison nous apparaît d’ailleurs naturellement, puisqu’il s’agit ici d’un autre film à propos de la sexualité des handicapés, caractérisés cette fois par la chaleur humaine plutôt que la froideur clinique, par l’abandon de l’autrice à ses sujets plutôt que l’abandon de ces derniers aux tentatives d’autopromotion d’une maîtresse démagogue, un film où la sexualité n’est pas une fin en soi, mais une étape dans un parcours plus vaste, un parcours presque épique vers l’émancipation individuelle. Lors de notre première rencontre avec Yuma, la protagoniste du récit, celle-ci fait figure d’étrangère dans un monde d’individus auto-mobiles, statique dans la foule ambulante, à la merci des bons soins prodigués par les employés de métro et par sa mère hyperprotectrice, gagnant un mince pécule comme aide-mangaka, tapie dans l’ombre d’une employeuse célèbre et esclavagiste. Quand on la quitte, elle est devenue une artiste à part entière, affranchie de sa mère éplorée, arpentant le trottoir sous le soleil éblouissant en arborant un sourire épanoui. Entre ces deux rencontres, un parcours fascinant, qui nous amène de Tokyo à la Thaïlande en passant par les hôtels de passe et les bars de travelos de la capitale, un récit initiatique d’autant plus magnifique qu’il est tardif, preuve qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre à se connaître et sortir de sa coquille.
37 Seconds, c’est un film porté par la beauté de ses personnages, marginaux pour la plupart, empressés de se venir en aide les uns les autres, et de pourvoir à Yuma les expériences de vie nécessaires à son développement, des choses simples comme sa première brosse, sa première relation sexuelle, ses premières sorties hors du cocon familial, et ses premières séances de magasinage (lors de la seule scène véritablement abjecte du film, où le glamour du consumérisme est appuyé par une chanson pop anglophone imbuvable). 37 Seconds, c’est un film fort d’une distribution fabuleuse, et particulièrement de la performance entière et touchante de Mei Kayama, de sa petite voix de souris et de son beau visage si expressif, filmé avec une tendresse infinie, bref d’un humanisme qui enveloppe tout un chacun : les travailleurs du sexe, la sœur expatriée de la protagoniste, apeurée a priori par la condition de sa jumelle, même la mère tyrannique, dont on comprend finalement que son attitude possessive est due au vide lancinant de son existence. Et bien qu’il s’agisse d’un premier long métrage pour Hikari, celle-ci force l’admiration par l’utilisation d’une caméra intimiste qui s’avère complice plutôt qu’inquisitrice, une caméra qui ne se veut intrusive que pour mieux montrer la violence sournoise du protectionnisme exercé par la mère, qui dans une des premières scènes, dévêtit sommairement sa fille avant de la mettre au bain, la laissant nue et vulnérable face à tous, ignorante du fait qu’il sommeille en fait dans son petit corps prostré une grande force de caractère qui n’attend que l’aide des circonstances, et de la réalisatrice, pour s’épanouir. Et même si son récit possède un immense potentiel mélodramatique, cette dernière parvient admirablement à doser l’afflux de sirop, de sorte que les larmes qu’elle nous tire sont dues exclusivement au sublime des péripéties diégétiques. (Olivier Thibodeau)
*Critique publiée une première fois dans notre couverture de la Berlinale 2019

prod. Ego Film Arts / The Film Farm
GUEST OF HONOUR
Atom Egoyan | Canada | 2019 | 105 minutes | Film d’ouverture
Les sans-abris du premier plan du nouveau film d’Atom Egoyan pourraient être les autochtones du plan final du dernier Denys Arcand. Ils semblent dresser une mesure de réalisme semblable, par leur position de témoins indifférents aux événements privilégiés qui ont pourtant intéressé ces cinéastes. Dans les deux cas, l’espace limitrophe au drame humain est déguisé dans une forme de réalisme à numéro, queue leu-lade de types sociaux et de communautés culturelles qui portraiturent Montréal comme Toronto dans un multiculturalisme fade et touristique ; signe à la fois qu’Arcand et Egoyan sont de cette génération de cinéaste à ne plus savoir comment actualiser ni leurs styles ni leurs intérêts. Ils tournent toujours, allongeant une carrière décevante grâce à une gloire révolue, ce qui les fait vieillir tristement, s’accrochant à ce qui les définit comme un boomer canadien à Supertramp.
Guest of Honour débute après cette amorce braquée sur les plus démunis, nous traîne dans une église et nous plante en face de la discussion la plus convenue du monde. Veronica (Laysla De Oliveira), fille d’un inspecteur de restaurants tout juste décédé, fait face au père d’une congrégation (Luke Wilson) dont l’église accueillera les funérailles. Ainsi débute le premier flash-back d’un récit à tiroirs interminable, multipliant les révélations-chocs emboîtées dans des tromperies de boudoir. Son père, Jim (David Thewlis, seule raison de se rappeler du titre du film), regarde des souvenirs de sa femme qu’il a enregistré avec sa caméra. On apprendra qu’elle est morte d’un cancer la scène suivante, qu’en parallèle Veronica, alors tout jeune, suivait des cours de piano auprès d’une professeure qui s’est rapprochée du père avant de mourir elle aussi, dans un incendie accidentel.
Chaque information factuelle dévoilée dans Guest of Honour cherche à se faire désirer par le spectateur. Elles sont toutes fruits d’un mystère bêtement posé, d’un geste incompréhensible qu’une coupure vient systématiquement expliquer, sans toutefois que le récit ne procède naturellement d’une scène à l’autre. Lorsque son père rend visite à Veronica en prison, elle lui sert cette phrase-valise : « Si c’était parce que je méritais d’être ici ? », hypothèse sur laquelle Egoyan joue, mais en refusant tout recourt à la judiciarisation de son récit. Veronica, qui était devenue professeure de musique avant d’arriver derrière les barreaux, subit les conséquences d’un crime de mœurs alors qu’elle voulait payer pour un meurtre, l’auteur s’affairant à faire de sa culpabilité le point focal d’une narration dont la complexité est censée incarner les méandres des remords entretissés par la nostalgie des souvenirs familiaux. Or en écartant toute procédure légale, Egoyan condamne son mystère à demeurer fait de sentiments vagues, de souvenirs fades entrant en compétition avec des souvenirs clichés, les deux censés nous émouvoir dans une sorte d’effet « faits vécus ».
Bien entendu, le travail d’inspecteur de restaurant de Jim tient lieu d’allégorie au mystère familial que le film construit de toute pièce, car sa structure répond moins d’une quête sentimentale que d’une décision arbitraire (« comment faire comprendre cette histoire si on la racontait à partir de ce dialogue entre cette femme et ce prêtre ? ») dont seule la finale parachutée parvient à justifier le dispositif. Les nœuds dramatiques auxquels fait face Jim n’ont eux rien à voir avec le souvenir, mais avec la réputation, qu’il est en mesure de détruire en une visite dans un restaurant qui aurait eu le malheur d’être malpropre ce jour-là. Entre la culpabilité de Veronica et ces réputations culinaires, Guest of Honour échafaude un discours confus et on ne peut plus cliché sur les apparences trompeuses et sur tout ce qui peut altérer notre perception du réel quand le cœur précède la raison ou quand la réputation précède les faits. (Mathieu Li-Goyette)

prod. Xilam
J’AI PERDU MON CORPS
Jérémy Clapin | France | 2019 | 81 minutes | Compétition internationale
Après s’être fait connaître pour ses courts métrages marqués par la solitude d’un personnage, par un sentiment de décalage par rapport aux autres et à soi-même (comme Skhizein avec son personnage en décalage qui se voit vivre à 91 cm de lui-même) ou encore par une condition corporelle contraignante (comme Histoire vertébrale avec son personnage au cou radicalement ancré vers le bas), Jérémy Clapin poursuit ses sujets de prédilection avec son premier long métrage J’ai perdu mon corps. Le film était attendu puisqu’il arrive ici suite un parcours festivalier déjà impressionnant (Grand prix de la Semaine de la critique à Cannes, où c’était la première fois qu’on remettait ce prix à un film d’animation ; Cristal du long métrage ainsi que le prix du public au Festival du film d’animation d’Annecy).
À Paris, la main tranchée d’un jeune homme s’échappe d’une salle de dissection afin de retrouver son corps à travers la ville. Parcours qui se révélera difficile et parsemé d’obstacles, il est composé de ces moments de vie antérieure avec le corps qui ponctuent le trajet. Des souvenirs, on en aura aussi à travers ces moments où Naoufel rencontre Gabrielle, tombe amoureux, et cherche à briser la trajectoire de son destin. Adaptation libre du roman Happy Hand de Guillaume Laurant, on y suit plusieurs récits en parallèle selon deux points de vue différents, celui de Naoufel et celui de sa main, passant régulièrement du présent au passé. Clapin réussit habilement à jouer avec cette narration multiforme jusqu’à éventuellement tout connecter ensemble. Il est vrai qu’une fois les pièces en place, la vue d’ensemble peut paraître plutôt simple, mais ce serait passer outre l’importance de toutes ces manipulations narratives dans ce qu’elles racontent. Ces connexions opèrent ainsi souvent sous la forme de symboles qui se font écho entre eux : cette main qui, à travers ses souvenirs, nous ramène à l’expérience du quotidien à travers son corps ; Naoufel qui cherche de peine et de misère à établir des connexions avec le monde qui l’entoure, avec Gabrielle qu’il rencontre ; Naoufel qui cherche aussi à se reconnecter à lui-même en retrouvant ses souvenirs (la perte de ses parents), ces souvenirs passant donc continuellement par une expérience corporelle ou sensorielle (le son par les enregistrements audio de Naoufel gamin, le toucher avec ce dont la main se rappelle). Autant le film évoque la (re)connexion que cette volonté de connexion fait suite à une séparation qui renvoie à la première (la main séparée de son corps, puis Naoufel séparé de ses parents, Naoufel séparé de ses rêves de jeunesse). Évoluant dans ce monde en perpétuelle transformation (jusqu’aux immeubles qui l’entourent), où les parents semblent absents (dans tous les sens possibles), et où un certain sentiment de fatalité est à son apogée, Naoufel en a marre de cette trajectoire que le destin semble lui réserver et décide, comme il le dit, de dribler le destin.
Réalisé à partir d’un logiciel libre, J’ai perdu mon corps parvient à faire de ce mélange de dessins et d’images de synthèse une animation fluide qui donne à voir des compositions souvent fortes, alliant une idée surréaliste à une histoire magnifiquement personnelle et sensible. Unique et audacieux dans sa proposition narrative et dans ce parti pris alliant quotidien et surréalisme, tantôt plein de tensions, tantôt très réflexif, J’ai perdu mon corps est une véritable proposition cinématographique sur la résilience et sur l'affirmation de soi, passant par la sensation du souvenir et sa fragilité. (David Fortin)

prod. DEEP END PICTURES
VIDEOPHOBIA
Daisuke Miyazaki | Japon | 2019 | 89 minutes | Temps Ø
Le cinéma de Daisuke Miyazaki entre en dialogue avec le présent sans pour autant imposer à son époque des thèses préfabriquées. Tourism, film précédent du cinéaste japonais, proposait une réflexion sur une certaine culture de l’image — sur une manière de se mettre en scène à l’intérieur du réel, mais quelque peu en retrait de la réalité, propre à l’âge des réseaux sociaux. Videophobia poursuit sur cette voie en s’intéressant plus spécifiquement à la notion d’identité. Quel rapport entretient-on avec notre image ? Avec notre propre corps réincarné sous forme de représentation ? Que nous reste-t-il, et que reste-t-il de nous, une fois que cette image nous a été volée ?
Ici, une jeune femme découvre avec effroi qu’une vidéo d’elle filmée sans son consentement circule sur internet, la montrant en plein ébat sexuel avec un inconnu rencontré au détour d’une soirée. Violée par image interposée, dépossédée de sa propre intimité, Ai (Tomona Hirota) en vient ainsi à prendre conscience de la précarité même de la notion de vie privée — dans un monde où la surveillance électronique est devenue aussi omnisciente qu’inévitable. Sentant que son propre corps ne lui appartient plus, Ai en viendra jusqu’à essayer d’échapper à son visage dans l’espoir de reprendre le contrôle de sa propre identité.
Une fois de plus, Miyazaki préfère poser des questions plutôt qu’offrir des réponses — sa mise en scène reposant sur une certaine liberté formelle qui informe de manière assez naturelle la structure du récit. Bien qu’il s’agisse d’un film plus « écrit » que ne l’était Tourism, ce nouveau long métrage reste très ouvert. Tant dans sa façon de faire que dans la liberté qu’il laisse au spectateur, Videophobia refuse les solutions faciles — jusqu’à cette conclusion dont l’ambiguïté met en doute la pertinence même des informations fournies par la narration. À plusieurs égards, il s’agit d’un film sur le rapport qu’entretient aujourd’hui la vérité à la réalité.
D’où la pertinence de ces renvois au jeu qui ponctuent l’ensemble et ajoutent un niveau de plus au discours du film sur l’être, les acteurs qui apprennent à interpréter n’étant pas tellement différents des individus et de leur manière de se représenter. Videophobia est un film dont les divers morceaux s’imbriquent habilement les uns dans les autres, se répondent et se questionnent sans nécessairement se résoudre — à un point tel que ses « incohérences » de surface deviennent des espaces féconds dans lesquels s’immisce un doute en parfaite résonance avec le propos. Le résultat final confirme la pertinence de l’œuvre de Miyazaki qui, de film en film, précise sa vision de l’image en tant que fondement même du réel et de sa disparition. (Alexandre Fontaine Rousseau)
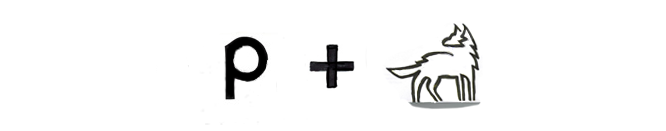
PARTIE 1
(Aren't You Happy?, Die Kinder Der Toten,
Little Joe, Ma nudité ne sert à rien)
Dieu existe, son nom est Petrunya
PARTIE 2
(Acid, Liberté, Serpentário, Soylent Green,
The Vast of Night, Wind Across the Everglades)
PARTIE 3
(Diner, 37 Seconds, Guest of Honour,
J'ai perdu mon corps, Videophobia)
PARTIE 4
(Ma nudité ne sert à rien, Bacurau,
Family Romance, LLC, , Monument, Parasite)
PARTIE 5
(A Hidden Life, Atlantique, The Halt,
Marriage Story, Raining in the Mountain,
Zombi Child)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
