

prod. Studio SLON / Kislota
ACID
Alexander Gorchilin | Russie | 2019 | 98 minutes | Panorama international
« Premièrement, tu deviens un provocateur, et ensuite un artiste riche et célèbre. C’est tout. »* Voici là l’une de ces belles maximes sentencieuses dont est couturé le film de Gorchilin, laquelle représente d’ailleurs parfaitement sa démarche, celle qui consiste à amasser du capital culturel en bousculant l’imaginaire bourgeois avec des images-chocs d’adolescents suicidaires et buveurs d’acide forniquant. « Notre problème, c’est que nous n’avons pas de problèmes » : voici une autre de ces belles maximes, qui elle cristallise tout le problème de représentation affectant l’œuvre, qui dans son évocation du nihilisme rampant d’une certaine jeunesse russe privilégie une facture hyperléchée, où la laideur n’est nulle part ailleurs que dans la tête enfiévrée de protagonistes nombrilistes, de belles personnes entourées exclusivement de belles personnes. L’horreur est telle qu’on pense automatiquement à la voix off de Pierre Falardeau dans Le temps des bouffons (1985) : « Sont riches pis sont beaux ; affreusement beaux avec leurs dents affreusement blanches pis leur peau affreusement rose. Et ils fêtent. » Sauf qu’ici, ils fêtent pour mieux oublier leurs problèmes lancinants de musiciens ratés et de fils à grand-maman. De façon grandiloquente, le film débute par un suicide à l’acide, alors qu’un jeune intoxiqué au LSD se jette en bas d’un balcon. L’action est presque télégraphiée compte tenu de l’iconographie surdéterminée du trip, composée de gros plans sur le visage rougeoyant et dégoulinant du personnage, comme en transe sous l’effet de la techno assourdie qui joue en arrière-plan. On sait bien : l’acide ça tue les jeunes ! Et comme si le message n’était pas assez clair, le film se termine avec un autre suicide à l’acide, hypothétique cette fois, alors que le protagoniste souffle sinistrement dans le goulot d’une bouteille de liquide corrosif. Encore une fois, on privilégie pour sa valeur-choc l’affectation au-dessus du réalisme, comme dans presque tous les dialogues, qui sonnent plutôt comme des proverbes lyriques que comme le propre d’une jeunesse égarée, dans les scènes de sexe sensationnalistes également, où l’indifférence d’usage pour les considérations prosaïques de protection, les effets de style et le spectacle appuyé de l’hémoglobine jaillissante l’emportent vite sur toute économie réelle de la relation sexuelle, constituant ainsi l’énième victoire diégétique de l’artifice sur le naturel. (Olivier Thibodeau)
*Critique publiée une première fois dans notre couverture de la Berlinale 2019

pord. Rosa Filmes / Idéale Audience / Audergraun Films / Lupa Film
LIBERTÉ
Albert Serra | France/Espagne/Portugal | 2019 | 132 minutes | Les nouveaux alchimistes
Niché dans la rubrique du film historique libertin, Liberté d’Albert Serra rappelle la dimension d’épreuve dont fait part Annie Le Brun lorsqu’elle explique sa technique de lecture de Sade à l’orée de l’écriture de Soudain un bloc d’abîme, Sade. Désirant se dégager des lectures historiennes, philosophiques ou par trop métaphoriques qui neutralisent le propos sadien, l’essayiste dit avoir voulu directement et corporellement se mesurer au « système de réverbération érotique » des 120 journées de Sodome, à cette littérarité en laquelle les passions se mêlent les unes aux autres, s’entrouvrent et s’examinent en se répercutant sans merci sur les nerfs du lecteur. Délibérément lent, long et posé, le film de Serra fait de façon similaire subir au spectateur l’épreuve de scènes où, plan par plan, sont épluchés les sophistiques plaisirs d’un groupe de nobles tout entièrement versés à ce qu’ils appellent spectacle. Un spectacle qui se déploie d’abord dans le récit qu’offre l’un d’entre eux dans la scène de départ, où nous est relatée avec un calme ostensible une histoire d’écartèlement sur la place publique soulevant l’admiration pour avoir été regardée sans baisser les yeux par trois femmes. Ces trois femmes doivent être honorées et retrouvées, nous dit-on, sans elles, le monde ne vaut guère.
Film sur la jouissance dans toute son étendue, la proposition est singulièrement anti-climaxique, s’attelant à rendre avec insistance le plaisir comme dispositif du regard dans la linéarité protocolaire du pacte de la débauche. Pas un mouvement de caméra ne survient, nous avons plutôt un montage de tableaux en lesquels les protagonistes, femmes jeunes et hommes variés, se toisent et se regardent, se frôlent, se meuvent, s’adressent des paroles sournoises et fines, s’insultent plus franchement, se torturent de cent manières, s’urinent les uns sur les autres et se baisent parfois. La fixité de la caméra signe la mise en spectacle de cette nocturne qui se déroule dans un seul lieu, en l’occurrence un bois où s’enchâssent et s’ébruitent les libertins en diverses stations, les champs-contrechamp des nombreuses scènes de dialogues se fondant dans des captations plus déliées où la simultanéité des ébats de petits regroupements offre toutes les occasions d’errance scopique.
De manière remarquable, les sexes montrés ne jouissent pas et les hommes ne bandent à vrai dire jamais. L’économie libidinale est d’un autre ordre, volontairement épuisante pour le spectateur qui, par son propre regard, participe au jeu de ces acteurs torturés et torturants dont on comprend qu’ils jouissent de l’intérieur, de manière paradoxalement cérébrale. À un certain moment, on parle d’une « causa », une cause qui relève de l’apprentissage, du don de soi, de la patience et du travail de l’imagination capable d’enfiler tous les fluides du corps par quelques idées insoutenables. Cela dit, le spectacle ne verse jamais dans la facilité, une forme de délicatesse prévaut à la violence et recèle un éthos qui fait de ce film une vraie proposition, mais qui fut toutefois consommée, pour notre part, sans grand plaisir, mis à part de la lumière de la photographie et de l’audace éprouvante et théorique de la lenteur imposée. (Maude Trottier)

prod. Mirabilis
SERPENTÁRIO
Carlos Conceição | Angola/Portugal | 2019 | 85 minutes | Les nouveaux alchimistes
Serpentário fonctionne exclusivement grâce à l’ambition formelle qui le structure, prenant l’allure de panoramiques gauche-droite patients qui font défiler le paysage sous les pas déterminés du jeune héros, l’alter ego du réalisateur angolais Carlos Concerção*. D’emblée, le cinéaste annonce dans les premiers titres l’axe géographique de son projet : né en Angola, ancienne colonie lusophone d’Afrique de l’Ouest, il a été élevé au Portugal. Sa mère étant demeurée là-bas, Concerção a longtemps fait une fois l’an le pèlerinage de 10 000 km qui le séparait de son pays d’origine, jusqu’à ce que sa mère, dans son âge avancé, lui fasse la proposition suivante : pour combler sa propre solitude, elle achèterait un perroquet d’une espérance de vie de 150 ans, à condition seulement que son fils lui promette de s’en occuper une fois qu’elle sera décédée. C’est sur la base de cette promesse et du retour aux sources annoncé que Serpentário s’ouvre sur de magnifiques paysages du désert angolais, captés dans une lumière dorée, enorgueillis par une trame sonore de percutants synthétiseurs. Le film cherche ainsi à évoquer une étiquette de science-fiction certes un peu forcée, mais il parvient principalement à l’adopter grâce à sa mise en métaphore de l’abandon colonial, qui se double d’un récit de migration raconté à l’envers (le fils voudrait voir sa mère et cette dernière persiste à dire qu’elle ne souhaite pas se rendre jusqu’au Portugal, c’est donc lui qui doit se rendre jusqu’à elle, répondant à l’appel du retour qui marque de nombreuses fictions africaines contemporaines).
Alors le jeune voyageur marche, marche et marche. La caméra le suit, le contemple, le traque, alors qu’il s’enfonce dans des paysages de plus en plus intriqués au désert, aux rochers, aux bâtiments abîmés qui forment ensemble un panorama post-apocalyptique érigé en allégorie du post-colonialisme en Afrique. S’arrêtant quelques fois pour échanger avec d’autres Angolais, le voyageur, plus blanc qu’il n’est noir, peine à brandir son identité maternelle dans un monde qui l’associe aux cols de fraise aristocratiques de la période des « grandes explorations ». Or si le film maintient une vitesse de croisière hypnotisante lorsqu’il parvient à nous perdre dans les paysages — c’est un pur film de paysages, de formes naturelles superposées, de textures rocailleuses et sablonneuses, et sans aucune carte postale défraîchie — les moments de halte s’avèrent moins convaincants, ne parvenant pas à remodeler le projet esthétique du trajet lorsque celui-ci cherche à reprendre son souffle. Heureusement, la finale, qui met en scène dans un émouvant jeu d’ombres l’ultime dialogue du perroquet et du fils, récupère l’ensemble des thèmes abordés à travers des questions de sphinx, donnant à cette ambitieuse exploration poétique et spatiale de l’Afrique « abandonnée » un épilogue qui soit à la hauteur de sa rigueur mécanique. (Mathieu Li-Goyette)
*Critique publiée une première fois dans notre couverture de la Berlinale 2019

prod. MGM
SOYLENT GREEN
Richard Fleischer | États-Unis | 1973 | 97 minutes | Présentations spéciales
Soylent Green, c’est un film de décors. C’est de ceux-là surtout qu’on se souvient quarante-cinq ans plus tard (et trois avant la date fatidique où se déroule l’action diégétique). Des décors et une simple idée, devenue depuis un artéfact poussiéreux de la culture américaine, mais qui à l’époque se combinait au travail impeccable de direction artistique signé Edward C. Carfagno pour former l’un des panoramas dystopiques les plus frappants jamais conçus. Malheureusement, derrière son message environnemental opportun se cache ici un conservatisme radical écœurant, qu’emblématise parfaitement le jurassique Charlton Heston qui lui sert de héros.
L’affect intemporel du film est indéniable, mais celui-ci est presque entièrement tributaire du pouvoir d’évocation des décors impliqués : l’appartement miteux de Thorn et Roth où se déploie le fétichisme nostalgique des deux hommes pour les livres imprimés et la vraie nourriture ; les escaliers du bâtiment surtout, où le protagoniste doit enjamber les dizaines de dormeurs gisant sur les marches ; le centre d’euthanasie, avec ses grands écrans muraux ; l’usine alimentaire, où les linceuls sont déversés si violemment dans les bassines ; les rues encombrées, couvertes de poussière ocre où les « scoopers » cueillent les citoyens comme des carottes et, bien sûr, l’appartement de luxe à la plus énième mode seventies où un Joseph Cotten fatigué et sous-utilisé se laisse assassiner laconiquement à la gloire de Dieu et où l’aguichante Leigh Taylor-Young pavane son cul pour le plaisir scopique masculin.
Il n’y a rien de subtil dans tout ça, et c’est sans doute pour cette raison que le film fonctionne si bien comme critique du fascisme capitaliste occidental. Il n’y a rien de subtil, ni dans le montage « historique » liminaire qui accuse l’accélérationisme industriel d’avoir causé la fin du monde, ni dans le jeu hyper-affecté d’Heston, qui nous livre ici une version clownesque d’un Sam Spade post-apocalyptique avec sa gâpette sale, son foulard de Casanova à deux sous et son machisme bourru de dinosaure. Ladite performance est d’ailleurs en parfaite adéquation avec le machisme dégoulinant du scénario, qui se complaît paradoxalement dans une misogynie qu’il dit condamner, mais rien que pour la forme, via la même posture revendicatrice molle qu’il partage avec le protagoniste.
Les décors du film sont magnifiques certes, mais ils ne sont peuplés que par des meubles, à commencer par toutes les femmes du récit qui, dans le futur imaginé par le progressiste Stanley Greenberg, sont toutes devenues des objets de consommation pour riches mâles. Les femmes de 2022 ne sont que du « mobilier », expression célébrée sans contestation par tous les personnages du film, incluant le héros qui, dans un moment d’anthologie, déclare à son amoureuse éplorée qu’elle « est un bien beau meuble ». Et c’est comme ça que se décline l’humanisme supposé des auteurs : dans une exploitation « critique » du corps féminin, dans une dramatisation de l’existence prolétaire équivalente à la glamourisation de l’existence bourgeoise, mais surtout dans une diabolisation excessive du compostage posthume des êtres au sein d’une société qui les composte déjà dès leur naissance. « Soylent Green is people! », hurle Heston dans son style criard habituel, levant le poing en l’air du haut de sa civière, « They’re making food out of people. Next thing, they’ll be breeding us like cattle for food ». Le film se termine même sur cette image de poing levé, comme pour confirmer sa propre position révolutionnaire, celle d’un croisé gisant qui, en criant sa peur de devenir bétail, oublie le fait qu’il a toujours été bétail, bétail d’une élite dont il subit chaque jour la violence, mais dont il envie néanmoins la place parmi les pitounes dociles et les grands salons de garçonnières exclusives. (Olivier Thibodeau)

prod. GED Cinema
THE VAST OF NIGHT
Andrew Paterson | États-Unis | 2019 | 90 minutes | Temps Ø
Sur un écran noir, la voix d’un inconnu, transmise par un appareil téléphonique, nous raconte son histoire, son explication pour la provenance d’un bruit énigmatique, capté par la radio, et semblant provenir d’au-dessus de nos têtes. Ancien militaire, ce qu’il nous confie devait rester top secret : l’absence d’images, pas même celle d’un interlocuteur qui écouterait avec nous ce récit, renforce alors ce sentiment de s’enfoncer au cœur d’un mystère, si épais, si dangereux, qu’il ne peut pas être illustré. À ce point du film, la mise en scène nous a habitués à nous placer ainsi dans une posture d’écoute attentive — et c’est à ce niveau que ce premier film d’Andrew Patterson excelle, à multiplier les manières de porter notre attention vers le son (par l’insistance sur les micros, la radio, nos deux héros qui s’amusent à enregistrer des voix, de longs plans sur des personnages qui tendent l’oreille, ou par ces écrans noirs qui nous laissent seuls avec la bande sonore). En jouant sur les signaux, la transmission, ceux de la radio et de la télévision (le film se présente comme un épisode d’une émission à la Twilight Zone), Patterson relie les espaces (on pense aussi à ce plan-séquence qui traverse une ville déserte en s’enfonçant dans la nuit, partant d’un personnage pour en rejoindre un autre, s’arrêtant au passage dans un match de basketball), et fait de son cinéma une autre sorte de signal, envoyé du passé (le récit se déroule dans les années 1950, dans une petite communauté américaine) pour se rendre jusque dans notre présent de spectateur. Le tout tient un peu de la gimmick, cette mise en scène, aussi habile soit-elle, ne parvenant jamais à gagner une véritable densité, les personnages demeurant trop peu développés au-delà de leur fonction narrative, mais Patterson maintient l’atmosphère conspirationniste jusqu’à une finale surprenante, le son laissant alors place à l’image, le temps d’une séquence d’émerveillement proprement spielbergienne. Il en résulte une œuvre remarquable, dont la plus grande prouesse ne réside pas tant dans sa caméra par moments virtuose, mais plutôt dans cette audace de faire confiance au pouvoir d’évocation de la parole — au sein de la nuit, semble dire Patterson, il n’y a que nos voix pour nous guider. (Sylvain Lavallée)

prod. Warner Bros.
WIND ACROSS THE EVERGLADES
Nicholas Ray | États-Unis | 1958 | 93 minutes | Présentations spéciales
Présenté dans le cadre du cycle de films écologiques du FNC, cet étrange film de Nicholas Ray ne ressemble à nul autre, même si nous reconnaissons aisément la patte de son auteur (pourtant chassé de la production avant la fin du tournage). Dans ce western troquant le désert pour les Everglades floridiens au début du vingtième siècle, un nouveau garde-chasse, Walt Murdoch (Christopher Plummer, dans son premier rôle principal), s’oppose aux activités d’un braconnier, Cottonmouth (Burl Ives), régnant dans les marais avec sa cohorte (dans laquelle nous retrouvons entre autres un jeune Peter Falk dans son premier rôle au cinéma) : reprenant les thèmes de la frontière, de la civilisation et du territoire sauvage encore à conquérir, le film les redistribue en mettant l’accent sur la préservation, la beauté naturelle d’un territoire et de sa faune qu’il faut laisser en l’état. Après une première partie plutôt décousue, les séquences et les personnages s’empilant de manière confuse (par exemple une déclaration d’amour, belle en soi tant elle est portée par le romantisme échevelé typique de Ray, mais qui surgit de nulle part et ne mène nulle part), le film trouve sa raison d’être dans le dernier tiers, lors d’un face-à-face entre les deux protagonistes, cherchant leur voie à travers les marais. Mais le conflit n’est pas si simple, tant Ray semble fasciné par Cottonmouth, et sa liberté de rebelle sans cause, vivant dans les marges du monde, tout comme sa caméra s’ajuste au regard de Walt, trouvant dans les marais une beauté sans pareil. Pour Ray, cette nature est libre parce qu’indomptée, belle parce que sauvage, d’où ces plans quasi documentaires ponctuant le récit, s’attardant à la vie animale, et tout particulièrement aux oiseaux exotiques ; une fois abattus, leurs plumes servent d’apparat aux chapeaux des nobles de Miami, et la vraie beauté devient alors un ornement de pacotille. La splendeur du Technicolor n’est donc pas ici qu’une joliesse technique, elle est l’argument même du film, l’arme par laquelle le cinéma peut s’opposer aux mécanismes destructeurs du capitalisme : « regarde comment le soleil frappe le plumage des oiseaux », comme le dira Walt. Devant les sublimes images de Ray, aux couleurs rayonnantes, difficile de ne pas s’émouvoir avec le personnage ; le cinéma devient le dernier refuge pour contenir la beauté du monde, sa fragile liberté, condamnée à disparaître sous la violence indifférente de la société humaine. (Sylvain Lavallée)
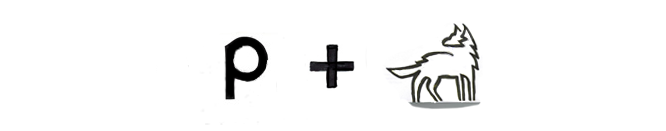
PARTIE 1
(Aren't You Happy?, Die Kinder Der Toten,
Little Joe, Ma nudité ne sert à rien)
Dieu existe, son nom est Petrunya
PARTIE 2
(Acid, Liberté, Serpentário, Soylent Green,
The Vast of Night, Wind Across the Everglades)
PARTIE 3
(Diner, 37 Seconds, Guest of Honour,
J'ai perdu mon corps, Videophobia)
PARTIE 4
(Ma nudité ne sert à rien, Bacurau,
Family Romance, LLC, , Monument, Parasite)
PARTIE 5
(A Hidden Life, Atlantique, The Halt,
Marriage Story, Raining in the Mountain,
Zombi Child)
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
