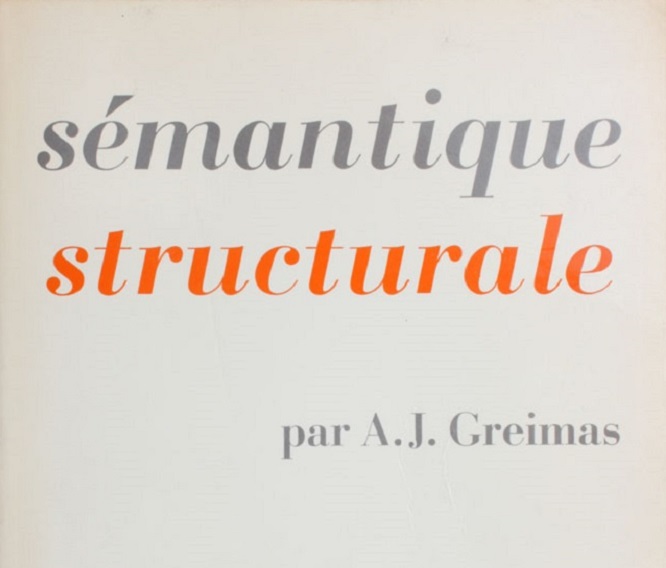L'anatomie de L'anatomie du scénario
L'anatomie de L'anatomie du scénario
À mon ami Stéphane Tremblay
Peut-être est-ce parce qu’il critique, dès le premier chapitre, la fameuse composition « en trois actes » (avec un début, un milieu et une fin) que
John Truby nous épargne une introduction et une conclusion. Ce livre commence donc «
in media res » (comme disaient les Romains) et se termine aussi en «
queue de poisson » (comme aurait dit ma grand-mère). Et là est bien la seule entorse que Truby fait subir aux modèles, puisque tout le reste de son essai n’est que redite, nous prouvant de cette façon que si, depuis les Grecs, toutes les histoires ont été racontées, toutes les poétiques ont, elles aussi, été répétées. Et le scénariste en herbe pourra, certes ingérer ce livre « organique » qui lui prescrira des « marches à suivre » et des « exercices d’écriture », mais tout aussi bien retourner aux sources et s’abreuver des classiques. Sinon, qu’il se sustente de ce modeste résumé, en neuf points.
1° Comment écrire une bonne histoire ? La question mérite d’être posée. Mais la réponse avait déjà été donnée. Trouvez une bonne prémisse, une prémisse qui vous tienne à cœur, qui vienne du plus profond de vous, qui traduise, en somme, la frustration de ne jamais avoir lu ou vu l’histoire tant désirée. N’est-ce pas ce que Rainer Maria Rilke enseignait à son jeune poète, quand il lui écrivait qu’une « œuvre d’art est bonne quand elle naît d’une nécessité » ? On peut douter que l’essai de Truby fût nécessaire.
2° Résumez ensuite cette prémisse en trois étapes (mais je croyais que… !?) : équilibre, déséquilibre, rééquilibre. On pourra aussi tenter de la découper, selon son appétit, en quatre (
Greimas), en cinq (
Larivaille) ou en trente et une (
Propp). Truby lui, propose de le faire en sept, puis en vingt-deux. Du reste, cette prémisse ne doit contenir qu’une seule action. Or, cette « unité d’action » a été acceptée par tous les poéticiens qui l’ont devancé, d’Aristote (que Truby rejette pourtant) à Victor Hugo (qui pourtant rejetait tout).
3° Élire le « héros » et répondre à la question : « Qui combat qui pour quoi ? » Qu’on se le dise, c’est là l’embryon du fameux schéma actanciel d’A.-J. Greimas. Mais Truby rebaptise les « actants » pour faire croire au lecteur peu versé dans le structuralisme français qu’il innove : le « sujet » devient donc le « héros », l’« objet » devient le « désir », l’« adjuvant » devient l’« allié », l’« opposant » devient l’« adversaire », le « destinateur » devient la « motivation » et le « destinataire » ne devient rien du tout, sinon que le héros lui-même, à qui, par nature égoïste, la quête profite. Au reste, Truby opère, en n’y inscrivant que des personnes, une réduction du schéma, lequel avait au moins la souplesse d’accueillir dans ses boîtes, tantôt des objets, bien matériels, tantôt des abstractions, comme des qualités ou des défauts. Truby anthropomorphise — et donc atrophie — cette syntaxe narrative.
4° Le récit doit donner à voir une transformation : le personnage doit avoir des faiblesses (« Des héros de roman fuyez les petitesses : / Toutefois aux grands cœurs donnez quelques faiblesses. », comme le chantait Boileau) qui l’empêchent d’atteindre son but et trouver les forces qui lui manquent afin de réussir. Or, cette transformation est aussi le pivot de tout récit, et ce, dès Aristote, qui maintenait, quelque part avant Jésus-Christ, que tout héros doit passer d’un état à un autre (du bonheur au malheur ou du malheur au bonheur). Et le chemin pour y arriver se trouve dans le « programme narratif » élaboré, encore une fois, par A.-J. Greimas (bien après J.-C.) : la manipulation (rien de tel chez Truby), la compétence (l’« établissement du plan », selon Truby), la performance (la « dynamique du récit », selon Truby) et la sanction (la « résolution morale », selon Truby).
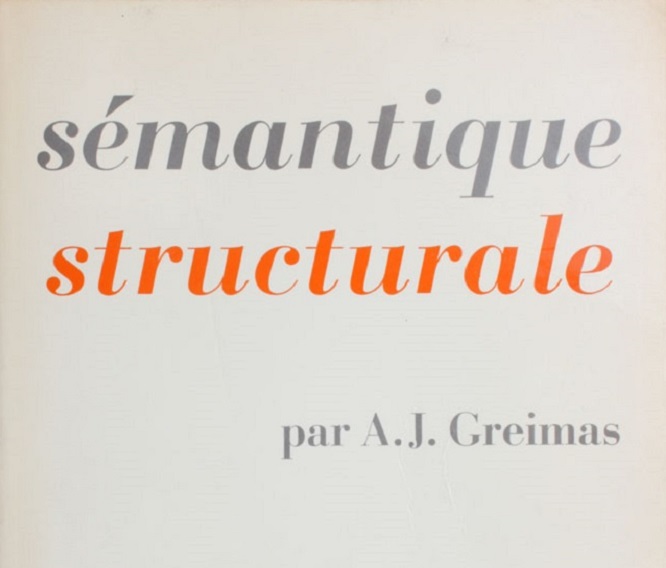
5° Commencez par la fin. Établissez ce que votre personnage — et ce que votre public — doit apprendre, et donnez-lui, ensuite, les faiblesses qu’il devra surmonter. C’est aussi ce que
Gérard Genette, dans
Figures II, exposait : tout récit doit être écrit « en fonction de la fin » et ses déterminations sont « rétrogrades ». Et c’est aussi ce que
Roland Barthes expliquait, dans l’« Introduction à l’analyse structurale des récits », quand il maintenait que ceux-ci doivent donner l’illusion d’une chronologie, voire d’une causalité, en cela que ce qui « vient
après [est] lu [...] comme
causé par ». Truby commence bien en amont, sans jamais remonter en aval.
6° Puisque l’œuvre d’art — qu’elle soit tragédie grecque ou drame hollywoodien — permet à chacun « d’apprendre par imitation » (
dixit le philosophe grec), il est important de prendre le soin de toujours placer votre personnage dans un conflit moral… entre « l’amour et l’honneur » (par exemple). Mais ne serait-il pas aussi important d’avoir lu Racine et Corneille (par hasard) ?
7° Faites évoluer vos personnages dans des endroits (maison, désert, forêt, océan, espace) et des moments (le jour, la nuit, sous le soleil, sous la pluie, à travers les saisons) qui nous en apprendront plus sur eux qu’eux-mêmes. En cas de panne, ouvrez le catalogue d’équivalences que vous propose Truby (pluie = tristesse, soleil = gaité, etc.) et utilisez ces symboles
sciemment. On renverra le lecteur intéressé aux pénétrants travaux de
Gaston Bachelard (que Truby a tout de même le mérite de citer) ou encore à ceux de
Carl Gustav Jung, de
Mircea Eliade ou de
Gilbert Durand. Ainsi, il pourra explorer et mieux comprendre les diverses manifestations symboliques et autres grands archétypes dont tous les récits de l’humanité se sont nourris et que tous les grands auteurs ont mis en scène — car c’est le propre des symboles —
inconsciemment.
8° Construisez votre intrigue. Nommez vos scènes. Résumez-les. Mettez-les dans l’ordre chronologique (de l’
histoire), puis déplacez-les pour en faire un
récit (ordre dans lequel l’histoire sera révélée au public). Truby réalise, à la toute fin de son livre, un renversement inattendu. Lui qui avait renié d’emblée les préceptes « dénués de sens » (p. 7) du Stagirite y revient contre toutes attentes, dans une forme de « révélation » (concept qui lui est cher) et qui trahit, au fond, ses propres « faiblesses » (autre cher concept). D’abord, quand il suggère de se demander « si la longueur de chaque scène est adaptée à celle de la scène qui l’a précédée et bien proportionnée en termes d’importances » (p. 360), il redit, moins laconiquement que le philosophe, que la beauté de l’œuvre réside dans « l’ordre et l’étendue ». Ensuite, quand il nous met en garde contre « une scène [qui] n’apporte rien au développement du héros [et qu’il] il vaut mieux […] couper » (p. 329), il nous ressert, bien évidemment, une définition du « nécessaire » aristotélicien.
9° Enfin, écrivez des dialogues qui rendent compte des différents points de vue moraux de chacun des personnages. Ce conseil nous replonge au cœur du dialogisme — ou du plurilinguisme — bakhtinien qui permet (comme cet article d’ailleurs) de faire entrer quelques dissonances au sein de tout système établi.
* * *
Un auteur qui prétend nous montrer à écrire une bonne histoire (« organique ») et à captiver son auditoire devrait aussi s’ingénier à soigner la cadence de sa démonstration, l’organisation de sa poétique (pourquoi, par exemple, aborder des notions aussi lourdes que « Le narrateur » ou « Les genres » à l’intérieur d’un chapitre titré « L’intrigue » ou pourquoi aborder un sujet aussi important que les « symboles » dans un
autre chapitre que celui titré « Le réseau de symboles » ?). Au mitan de l’ouvrage, le rythme s’essouffle, l’intérêt diminue, on attend quelque renversement, quelque « révélation », mais non, on s’enfonce plutôt et on s’ennuie profondément (de tous ces grands textes qu’on musèle). On émettra aussi quelques réserves quant à l’importance, trop grande, que l’auteur voue au « message », à la
réponse que doit offrir toute œuvre d’art. L’art, comme disait l’autre, ne consiste-t-il pas à poser les bonnes questions, non à y répondre ? Si vous voulez des réponses, faites-vous verbicruciste, non pas scénariste.
On peut aussi lui reprocher, par ailleurs, de passer sous silence des notions importantes pour quiconque veut bien raconter : le vraisemblable (essentiel pour qu’on puisse croire à l’histoire), les péripéties (qu’il renomme et réduit à des « révélations »), les changements de registres et de tonalités (pensons au mariage « du grotesque et du sublime »), les livraisons et les rétentions d’informations (qu’il résume et esquive en une phrase : « C’est la façon dont on fait découvrir des informations au héros et au public qui fait l’intrigue », p. 313), la supériorité, l’équivalence et l’infériorité cognitive dans laquelle on place le spectateur par rapport aux personnages (qu’il aborde expéditivement en parlant du « dévoilement public »), les moyens grâce auxquels on peut susciter l’empathie, la sympathie, l’identification et la projection en regard du héros (qu’il évoque sans s’y arrêter), etc. On s’étonnera également de ne retrouver aucun développement sur des concepts pourtant essentiels à l’art de la scénarisation (on excusera ici ma prononciation) : «
hook », «
tag », «
pinch », «
break », «
implant », «
capper », «
back story » (qu’il rebaptise « spectre »), «
cliffhanger », «
read hearing », «
fish out the bowl », etc.
En bref, si Truby critique, dès le départ, le tâcheron qui a « une idée d’histoire qui est une vague copie d’une histoire déjà existante » (p. 18), sous-entendant par là qu’un bon film n’est pas constitué des meilleurs passages de films préexistants, on pourrait arguer qu’une bonne poétique n’est pas constituée des meilleurs passages repiqués à Aristote, Corneille, Boileau, Diderot, Hugo, Propp, Bakhtine, Greimas, Larivaille, Todorov, Barthes, Genette et consorts. On suggérera aux scénaristes d’ouvrir leurs classiques qui ont au moins le mérite, sinon d’être mieux racontés, du moins d’être mieux écrits et de faire toujours une jolie impression quand on les cite dans une conversation.
Truby, John. 2010. Anatomie du scénario : Cinéma, littérature, séries télé. Paris : Nouveau Monde Éditions.