Luis Schubert est un cinéaste allemand prometteur, chapeauté par la célèbre école DFFB de Berlin où il a réalisé Blinde Flecken dans le cadre de ses études. Le film, une réflexion ouverte sur le métier encore méconnu de coordinatrice d'intimité, a été l'occasion pour nous de discuter de l'évolution de la communication et de l'éthique des cinéastes sur les plateaux de tournage. Un entretien sur son cinéma, mais surtout sur la manière dont il le fait.

Mathieu Li-Goyette : Blinde Flecken porte sur une altercation entre un réalisateur et une coordonnatrice d’intimité sur un plateau ; un sujet, disons, bien d’actualité. Qu’est-ce qui t’intéressait davantage ici, d’articuler, de présenter un métier, ou de faire une parodie bien contemporaine des plateaux de tournage ?
Luis Schubert : L’impulsion première n’était pas d’être parodique, c’était plutôt de poser la question : jusqu’où un∙e cinéaste (m’incluant au premier chef) peut-il ou elle aller sans blesser ou abuser de ses collaborateur∙rice∙s, sans que personne ne soit en danger. En me posant ces questions, j’étais en train d’écrire une scène de sexe pour un séminaire dans mes études à l’école de cinéma et je ne savais pas trop comment m’y prendre... Je lavais la vaisselle, en réfléchissant à ces questions, et c’est là qu’à la radio j’ai entendu une entrevue avec Julia Effertz, qui est la coordinatrice d’intimité dans le film et qui joue aussi le rôle principal — elle a donc fini par cumuler les deux rôles pendant le tournage. Donc à l’entendre, j’ai tout de suite réalisé que c’était un angle beaucoup plus intéressant, puisque son métier est une réflexion incarnée sur la manière de tourner une scène de sexe. Ça a fait une espèce de « clic » dans ma tête et on s’est ensuite rapidement rencontrés dans un café où on a discuté pendant trois heures. Il n’était pas encore question qu’elle joue dans le film, c’était surtout pour discuter de son métier, mais plus la conversation avançait et plus j’étais électrisé, parce que je ressentais bien que c’était un thème important dont on ne parle pas assez. En plus, comme Julia Effertz est la première coordonnatrice d’intimité en Allemagne, je savais que c’était un thème qui était en train de naître encore, que c’était le bon moment de faire un film là-dessus.
MLG : J’imagine que Julia Effertz a dû s’impliquer dans la scénarisation ?
LS : En fait, Julia a tout de suite été d’accord pour jouer dans le film et c’était important pour nous deux, pour tout le monde, d’essayer de représenter son métier de la manière la plus réaliste possible. Donc oui, elle a été fortement impliquée dans le scénario, parce que je ne connaissais pas exactement le processus de tournage avec une coordinatrice d’intimité. Comment ça marche ? Comme se fait la vérification avant le tournage, comment établit-on les safe words comme « pineapple » dans le film ? On voulait particulièrement bien faire aussi parce qu’on savait que le film avait le potentiel de faire connaître le métier en Allemagne, où ça serait peut-être, pour certaines personnes, la première fois qu’ils en entendraient parler. C’était une grosse responsabilité et on tenait à l’assumer.
En même temps, quand je fais un film, j’essaie toujours de ne pas trop prendre parti, mais de laisser justement au spectateur un espace d’ouverture ou il se questionne lui-même. Je voulais éviter aussi d’en faire une publicité du métier et laisser justement l’espace de pouvoir se demander si la coordinatrice ne va pas un peu trop loin elle aussi. C’est ce qui était intéressant dans notre travail, à Julia et moi, de nous demander comment représenter ce métier de la manière la plus réaliste sans prendre trop clairement position afin de ne pas être didactiques non plus.

:: Blinde Flecken (Luis Schubert, 2021)
MLG : En regardant le film, ça me faisait penser au fait qu’une coordinatrice d’intimité est un des rares nouveaux corps de métier sur un plateau de cinéma — outre pour des raisons techniques ou technologiques, il y en a eu somme toute assez peu depuis l’arrivée du sonore —, si bien qu’à chaque fois cela annonce une sorte de tournant, accompagné d’une prise de conscience où le public et la critique se mettent à être attentifs à de nouvelles dimensions de la pratique du cinéma.
LS : Absolument, et je pense qu’il y a un travail énorme à faire encore sur la manière dont on réalise des films et sur la manière dont on comprend ce qu’est un artiste ou un artiste spécifiquement dans le cadre du cinéma. Il y a vraiment une prise de conscience qui s’opère autour de ce qu’est une voix de réalisateur ou de réalisatrice forte ; on s’éloigne de plus en plus de cette figure de génie, de ce Kubrick qui veut 500 figurants, ou ce Fritz Lang qui en veut 5000 pour sa scène. Ces 5000 figurants se trouvent dans une hiérarchie très clairement inférieure à Fritz Lang et si ces 5000 figurants se blessent durant une scène d’inondation, à l’époque, on s’en fout [NDLR : dans Metropolis (1927)]. Pour rester en Allemagne, on peut aussi penser à un Werner Herzog où, pire encore, des indigènes meurent pendant un tournage pour qu’il réalise ses ambitions [NDLR : dans Fitzcarraldo (1982)]… Bien sûr, il y a toujours, et j’avoue que je ne peux pas complètement m’en détacher, une certaine fascination pour ces histoires et pour ces poursuites impossibles… C’est difficile, mais je pense que cette prise de conscience qui a lieu est plus importante, d’autant qu’elle se construit à travers des dynamiques de consentement. Il faut dire aussi que la majorité des acteurs et des actrices que j’ai rencontré∙e∙s sont souvent, aussi, des gens qui ont un goût pour l’extrême ou pour l’excès… Enfin, c’est justement là que la coordinatrice d’intimité intervient, dans le consentement, la communication. Cela ne veut pas dire qu’on ne fera que des films purement soft maintenant, mais c’est plutôt que la communication doit être perçue comme une valeur fondamentale sur un plateau.
MLG : C’est complexe, parce qu’effectivement, comme tu le dis, ces histoires de tournage, de Kubrick, Lang ou Herzog… Il n’y a pas si longtemps on prenait encore Hitchcock en exemple, quand il disait que ses acteurs étaient pour lui du bétail. Il y a cette espèce de position du cinéaste démiurge, comme si c’était partie prenante de l’auteurisme au sens classique. Si je me fais l’avocat du diable un instant, as-tu peur qu’on perde à travers ça une sorte de péril qu’il y a dans le tournage et qui a justement tant plu à ces cinéastes qu’on évoque ?
LS : Je ne peux que parler de ce que j’ai expérimenté jusqu’à présent. Par exemple, sur le tournage de Blinde Flecken, qui présente des scènes de sexe à deux reprises et qui sont censées représenter un accident ou justement un moment où quelqu’un va trop loin. Ces scènes à mon avis fonctionnent très bien, elles sont réalistes, mais elles ont pourtant été chorégraphiées minutieusement à l’avance. Dans un de mes films suivants, qui est présentement en postproduction, il y a un porno qui a été tourné et, si on le regarde, il a l’air d’un porno très cru et direct, mais il a aussi été complètement chorégraphié avec une actrice. Je pense qu’à l’époque des tournages fous de Werner Herzog, on aurait tourné avec cette même actrice une scène telle quelle et elle en aurait probablement souffert par la suite. Alors que dans ce cas-ci, cette actrice, qui est assez jeune — elle a 20 ans —, a appelé ses parents après le tournage en disant fièrement : « j’ai tourné cette scène ! ». On l’a tourné avec Julia Effertz aussi, qui était juste derrière la caméra et j’ai senti une sorte d’empowerement chez l’actrice. Et ça, de travailler dans un écosystème de cinéma qui fonctionne comme ça, c’est largement plus… Comment dire... C’est beaucoup mieux que de vivre avec un Marlon Brando et un Bertolucci qui traumatisent Maria Schneider à vie [NDLR : dans Last Tango in Paris (1972)]. Donc voilà, je pense qu’il faut justement travailler à se détacher de cette peur, de l’idée que la communication pourrait nous empêcher d’aller au bout de nos ambitions. Moi aussi je pense que j’ai changé à ce sujet en arrivant à l’école de cinéma. C’est une école de cinéma assez sélective et, d’un coup, ayant été choisi tu te dis « Woah! Apparemment, j’ai du talent » et c’est facile de tomber dans ces idées de démiurge qui sont souvent toxiques, et particulièrement chez les hommes cinéastes.
MLG : En rétrospective, ça nous en dit aussi long sur l’histoire du cinéma, de sa cinéphilie, du rapport collectif qu’on a au cinéma et à ces histoires de tournage. Pendant très longtemps, les cinéphiles, on a collectivement chéri des histoires qui étaient parfois de pures histoires d’exploitation.
LS : Tout à fait.

:: Sur le tournage de Metropolis (Fritz Lang, 1927)

:: Fitzcarraldo (Werner Herzog, 1982)
MLG : Au niveau de la mise en scène, est-ce que c’était plus difficile ou plus facile pour toi de faire un métafilm, de donner cette impression d’un film en activité, avec plein de choses qui se passent, des gens qui crient, qui se déplacent rapidement ?
LS : Je dirais que c’était pour moi plus facile, parce que le monde des tournages est quelque chose de très connu par toutes les personnes qui font partie de l’industrie du cinéma. Donc les acteurs qui sont devant la caméra autant que tout le monde derrière la caméra sont très familiers avec les dynamiques d’un tournage. Donc ça, ça aide déjà. De deux, au niveau des décors, s’il y a une lumière dans l’image, ce n’est pas grave — ça ne veut pas dire qu’on fait n’importe quoi ! (rires) On reste précis sur le positionnement, mais ça enlève une sorte de séparation entre le monde fictif qu’on raconte et le monde derrière la caméra. Les deux se mélangent alors d’une manière assez intéressante. On a tout fait en deux ou trois nuits de tournage assez chargées, en prenant soin de s’amuser et d’instaurer une certaine liberté dans tout ça. C’était donc plus simple que mes tournages précédents, aussi car c’était mon premier film sans trépied, alors qu’avant je n’avais presque jamais bougé ma caméra — peut-être au nom d’idées un peu trop académiques — et là je me suis détaché de ça et c’était une vraie découverte pour moi parce que j’ai remarqué que ça me correspond plus finalement.
MLG : As-tu rangé ton trépied aussi pour le film suivant ?
LS : Oui, en fait, mon film suivant, c’est carrément un plan séquence de six minutes qui est en caméra à l’épaule. Bien sûr un plan séquence a d’autres contraintes… J’ai remarqué après avoir regardé beaucoup de Cassavetes en parallèle que pour lui c’est une question de hiérarchie entre les interprètes et la caméra, une lutte pour notre attention. Avec un trépied, l’image prend tellement de place et je trouve que l’acteur ou l’actrice se soumet en quelque sorte à ce cadre fixe. Enfin, bien sûr, il y a des cinéastes qui réussissent à combiner en préservant une certaine liberté dans les cadres fixes et je trouve ça extrêmement fort. Pour moi, ça a souvent été une contrainte et donc j’ai pris cette décision de mettre en valeur le jeu, que la caméra suive le jeu plutôt que l’inverse.
MLG : On parlait de péril tout à l’heure, puis d’improvisation et de création collaborative sur tes plateaux. N’y a-t-il pas des risques, pour préserver le safe space de tes interprètes, à encourager des tournages plus « chaotiques » ?
LS : Le fait est qu’il y avait déjà Julia Effertz en tant qu’actrice et coordinatrice d’intimité en même temps, ce qui n’était d’ailleurs pas forcément simple pour elle tout le temps. C’est ça aussi l’avantage d’avoir une coordinatrice d’intimité sur un plateau. Parce que bien sûr, elle est là pour une scène de sexe, mais elle est là aussi pour une scène qui peut être un câlin un peu intime entre deux amis. Elle pourrait être là aussi et rien que la présence d’une telle personne, peu importe pour quelle scène, ça pourrait n’être rien d’intime, mais ça crée immédiatement une espèce de safe space, parce qu’on sait qu’il y a une personne à laquelle on peut parler si un truc ne va pas. En plus de ça, comme je disais, je suis très ouvert à un travail participatif où tout le monde peut proposer ses idées. Du coup, j’essaie de pas trop de coller à cette idée de génie solitaire, de genius — je préfère le terme de Brian Eno, qui parle de scenius pour parler d’écosystème créatif autour de lui. Ce mot m’aide à réfléchir le travail collaboratif.

:: Blinde Flecken (Luis Schubert, 2021)
MLG : Tu as fait Blinde Flecken dans le cadre de tes études. Ici, on connaît assez peu les programmes de l’école publique allemande en matière de cinéma, et particulièrement celui de la DFFB. Ta scolarité va se conclure par la réalisation d’un long métrage, c’est bien ça ?
LS : Exact. Donc la DFFB (Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin — l’Académie allemande du film et de la télévision de Berlin) est une école publique de Berlin, de l’ouest de Berlin. Il y en a une à Potsdam aussi, qui était celle de l’Est. La DFFB, c’est un peu l’école la plus « cinéma d’auteur » en Allemagne. Elle est très politique et se démarque par un important engagement des étudiants qui y construisent leurs propres cursus d’études. Il y a peu de différences entre étudiants et professeurs, car il y a un dialogue très fort et ce sont des études assez longues et libres qui sont hors du système classique des études supérieures avec des baccalauréats et des maîtrises qui mènent à des diplômes. Donc ce n’est pas rare qu’un réalisateur ou une réalisatrice étudie douze ans jusqu’à son film de fin d’études, qui est effectivement un long métrage.
MLG : Ce qui est assez unique quand même.
LS : Oui, je pense que c’est assez unique et c’est une grande chance d’étudier là-bas, parce qu’en fait d’avoir une place là-bas… En gros on te dit : « Voilà, t’as dix ans maintenant, à pouvoir faire des courts métrages, et à la fin tu vas sortir un long métrage ». Blinde Flecken, par exemple, a été créé au sein d’un séminaire de caméra à la base, avec un chef opérateur qui s’appelle Reinhold Vorschneider, qui a tourné énormément de films de la Berliner Schule (« école berlinoise » [NDLR : les films de Christian Petzold, Maren Ade ou Angela Schanelec]), un courant de cinéma allemand des années 2000 et qui a fait ce séminaire qui s’appelait Copy/Paste, où on avait dix films avec un langage cinématographique unique et il fallait choisir un de ces styles et le copier-coller sur un scénario qu’on avait écrit nous-mêmes. À vrai dire, moi j’avais ce scénario et je n’avais pas envie de me laisser influencer par ce séminaire pour faire le film autrement… Donc on a essayé avec Giulia Schelhas, la chef opératrice, de prendre le film qui correspond le plus à notre idée, soit Rosetta des frères Dardenne (1999), parce que c’est aussi à l’épaule et on est très proche du personnage principal… mais on voulait quand même faire notre truc ! Heureusement personne n’a posé trop de questions. (rires)
C’est ce qui est beau à la DFFB, c’est que c’est très libre. Évidemment, rien n’est parfait et il y aurait aussi des choses à critiquer de ce système, mais au fond, je suis surtout très content d’avoir cette chance et de pouvoir avoir autant de temps pour créer. C’est ça qui est précieux.
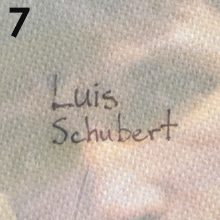 |
luis schubert |
photo : Mathieu Li-Goyette
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
