Partie 1 |
Partie 2
Lui, il s’est trempé dans le cinéma de genre italien dès son enfance. Elle, elle s’est nourrie de films expérimentaux durant son adolescence. Deux univers cinéphiliques à première vue étanches. Et pourtant, ils se sont rencontrés, un soir, à Bruxelles, autour d’un plat de pâtes au pistou et de
Profondo rosso (Dario Argento, 1975), un monde dans lequel chacun allait pouvoir se retrouver et découvrir un peu celui de l’autre : « Un style de cinéma avec une mise en scène libre, audacieuse, qui essayait plein de choses, folles, de manière décomplexée… », s’exclame-t-elle. « … tout en étant divertissant ! », apporte-t-il comiquement comme conclusion. Lui, il projetait des films. Elle, elle vendait des livres. Ils fantasmaient ensemble de faire des films, des courts métrages au moins. Puis, au tournant du millénaire, ils se sont décidés : une fin de semaine, avec trois amis et trois fois rien, ils ont entrepris de tourner un scénario «
gore » qu’il avait écrit, une histoire d’autodestruction. Mais elle, elle ne s’y embarquerait qu’à condition de tenter du même coup une recherche formelle, esthétique. Ce fut
Catharsis (2001). «
The rest is history… », comme on dit.
Le duo bruxellois (né en France) était de passage à Montréal pour y dévoiler, à L’Impérial, son dernier film :
Laissez bronzer les cadavres (2017). Ce fut aussi l’occasion, pour le Festival du nouveau cinéma, de présenter une rétrospective de leurs œuvres :
Amer (2009),
L’étrange couleur des larmes de ton corps (2013) ainsi que leur poignée de courts métrages. Et pourquoi ne pas leur donner également une carte blanche grâce à laquelle ils pourraient nous partager quelques-uns de leurs films préférés :
Faccia a faccia (Sergio Sollima, 1967) et
Keoma (Enzo G. Castellari, 1976). Il ne restait plus qu’à offrir aux fans qui courraient d’un événement à l’autre une classe de maître, à la Cinémathèque québécoise, animée par le sympathique et nonchalant Julien Fonfrède. Enfin, après plus de deux heures d’échanges avec un public avide et enthousiaste, l’inséparable duo, mû par une générosité sans bornes, a accepté de suivre
Panorama-Cinéma dans les studios de CHOQ.ca pour
continuer la discussion.
 Thérapie de couple
Thérapie de couple
Leur dynamique est fascinante. Bruno parle sans arrêt, gesticule à outrance, rigole à gorge déployée, enfile les titres des innombrables films qu’il a vus. Hélène cafouille, esquisse des sourires timides, évoque de vagues souvenirs et s’empresse de redonner la parole à son conjoint. Elle l’affirme sans ambages lors de la classe de maître : « Je ne suis pas très à l’aise avec le langage verbal. Le cinéma, c’est ce qui me permet de m’exprimer, de dire des choses très personnelles que je ne pourrais pas dire autrement. J’ai découvert qu’il y a une façon d’utiliser le matériel cinématographique de manière assez libre pour pouvoir exprimer mes idées. J’ai voulu faire du cinéma pour expérimenter moi-même. J’aime expérimenter la matière. Repousser les limites techniques. Apprendre des choses en tournant. » Et c’était le défi qu’elle avait lancé à Bruno lors de leur tout premier court métrage : « Faire un film de genre, soit ! Mais j’ai besoin aussi de dire des choses personnelles. » Désirant tourner en 35 mm, mais n’ayant pas le budget pour ce faire, elle propose de photographier le tout en diapo, dont le grain rappelle celui de la pellicule. Situant l’action dans son sous-sol, le couple doit recourir aux gros plans pour gommer l’absence de décors. Tournant du même coup sans son (et sans dialogues), ils doivent travailler la bande-son en postproduction. C’est toute leur grammaire — et leur façon de faire — qui est mise en place : éclairages colorés, gros plans, absence de dialogues, conception sonore…
Heureux de cette première expérience, Hélène et Bruno se donnent comme défi de mettre de l’argent de côté tous les mois pour, à la fin de l’année, réaliser un autre court métrage. Chaque fois, ils se heurtent à des problèmes techniques dû au budget ridicule dont ils disposent. Qu’à cela ne tienne ! Ils trouvent dans cette difficile contrainte de quoi stimuler leur imagination et peaufiner leur savoir-faire. « Chaque fois, on rencontrait des problèmes techniques qu’on essayait de dépasser. », dit-elle avec économie. Ainsi, après
Catharsis (2001), ce sont
Chambre jaune (2002),
La fin de notre amour (2003),
L’étrange portrait de la dame en jaune (2004),
Santos Palace (2006)… un court métrage par année, toujours marqué par les codes du cinéma de genre italien des années 1970 – le giallo, surtout, et le western, ensuite – et dans lesquels le couple se montre comiquement « pour l’égalité des sexes dans le meurtre ».
Nous reviendrons à Montréal…
Leurs petits films courent modestement les festivals de films de genre. On les boude un peu en Belgique. Ils ne font pas du « cinéma social » à-la-frères-Dardenne. On les boude aussi en France. Ils ne font pas du cinéma « à l’américaine ». Ils persistent néanmoins. Mitch Davis, qui affectionne particulièrement ce type de cinéma, les rencontrera lors du Festival international de cinéma fantastique à Sitges, en Catalogne. Il y voit
Catharsis. Il est subjugué. Il les pousse, les soutient, les invite à Montréal. Présenté à Fantasia, lors d’une soirée de courts métrages, leur premier opus remporte le Prix du public, le premier prix de leur vie, le jour de l’anniversaire d’Hélène. La joie — et l’étonnement — était à son comble. Ils reviendront chaque année.
C’est d’ailleurs lors de ce premier séjour chez nous qu’ils voient
Sadistic and Masochistic (Hideo Nakata, 2000), un documentaire sur la
soft-porn japonaise — dont ils allaient oublier le titre — dans lequel une scène hantera Hélène longtemps. « C’était une femme qui marchait devant une rangée de yakuzas… Ça m’avait marquée… mais je me souvenais vaguement de la scène… Peu importe, je voulais réaliser un film dans lequel une femme passait devant une rangée de motards et devait subir leur regard… »
[1] Ce souvenir vague devait être le point de départ d’
Amer, leur premier long métrage, lequel allait gagner, lors de sa présentation au FNC en 2009, un autre Prix du public. Le couple s’en montre, encore aujourd’hui, profondément ému.
Après la réalisation de
Santos Palace — leur premier court métrage réalisé avec un producteur qui, ne comprenant pas leur démarche, leur fit passer quelques mauvais quarts d’heure —, le couple fait la rencontre d’Eve Commenge qui, fascinée par leur univers, deviendra leur productrice attitrée, à laquelle se joindra sous peu François Cognard, en France. C’est l’aventure du long métrage qui se dessine alors.
 Du court au long
Du court au long
Hélène et Bruno en étaient venus à la conclusion : « C’est tellement de travail, tellement de problèmes, toute cette coopération avec un producteur… Il faut tellement faire preuve d’acharnement… On s’est dit que, si on veut faire un autre film, pour que ça en vaille la peine, autant faire un long métrage. » Mais on leur répétait que, si leur univers tenait dans les courts métrages, il ne tiendrait pas dans les longs métrages. Faisant fi des mauvaises langues et n’écoutant que leur envie de repousser les limites, les voilà lancés dans leur nouveau projet. Elle veut parler du désir, de l’éveil sensoriel d’une jeune fille, de la découverte de son corps, de ses pulsions sexuelles. Elle est toujours hantée par cette image de femme qui doit déambuler devant une armée d’hommes virils tout de cuir vêtus et qui la scrutent de leurs regards cachés derrière des verres fumés. Elle est aussi habitée par une phrase du
Bal d’Irène Némirovsky dans laquelle il était question d’une mère qui donnait une gifle à sa fille. Elle élabore alors un scénario de court métrage : ce sera la séquence centrale d’
Amer.
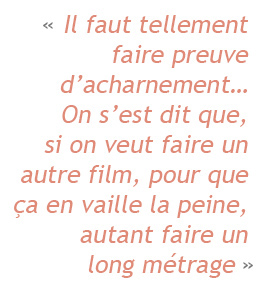 Amer
Amer est en effet construit comme un triptyque. Pour ce duo qui avait fait ses armes dans le court métrage, la structure seyait comme un gant. Il s’imagine alors raconter l’éveil de cette femme à trois étapes de sa vie : l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte. Non seulement, ils entreprennent de mettre en scène ces trois étapes en trois styles différents. « Comme on voulait faire un long métrage, explique Bruno en entrevue, on s’est dit qu’on allait traiter de ce thème dans trois styles différents, chacun lié à une époque de la vie de ce personnage. » Ainsi ont-ils offert à l’enfance un traitement gothique (entièrement tournée dans une vieille maison), à l’adolescence un traitement pinku (tourné sous le soleil du Sud) et à l’âge adulte un traitement giallo (tourné dans la pénombre la plus inquiétante). En somme, et même si leur cinéma est éminemment formel, Hélène et Bruno ont d’abord en tête leur thématique, le sujet dont ils veulent parler, et cherchent, ensuite, la meilleure façon d’en rendre compte. Le fond vient avant la forme. La matière avant la manière.
Du fond à la forme
« On veut
d’abord parler d’un sujet (très souvent d’un sujet intime)… puis on se demande
ensuite quelle sera la meilleure façon d’en parler. », insiste-t-il. « Et puis… nous privilégions le ressenti, bien plus qu’une approche explicative. », relance-t-elle. Du coup, leur scénario tient sur bien peu de chose. Et son traitement ne ressemble en rien à ce qu’on enseigne dans les écoles de cinéma. Leurs dialogues ? Une dizaine de lignes tout au plus. Comment scénarisent-ils ? « En fait, nos scénarios ressemblent beaucoup plus à un découpage, développe Hélène. Nous décrivons chaque plan : son cadrage, sa couleur, nous parlons de l’ambiance sonore… nous savons exactement ce que nous voulons faire… nous voulons arriver sur le plateau entièrement préparés. C’est aussi une conséquence du mince budget qui nous est alloué. » Et Bruno conclut en riant : « Et ça nous empêche de nous disputer devant tout le monde. »
Mais cette façon de présenter les choses dans des documents totalisant près de mille pages ne plaît pas aux financiers. On ne comprend pas leur délire technique pourtant décrit avec minutie. Du coup, ils ont dû, pour les séduire, apprendre à « noveliser » leurs scénarios, à les rendre plus littéraires, plus descriptifs. Leur acharnement leur permet ainsi d’obtenir du budget, et le budget d’obtenir des lieux. « C’était nouveau, pour nous, les lieux. Avant, on tournait dans notre chambre. Maintenant, on a accès à des lieux. Ça permettait d’en faire des personnages. Le lieu créé même le désir du film. », apprend Hélène au public de la Cinémathèque. Arrivé dans cette immense maison située dans le sud de la France, leur directeur artistique leur fait part d’une crainte : « On n’aura jamais assez d’argent pour tout faire ! » Ce qu’il ne comprenait pas, c’est que, fidèles à leur grammaire, ils allaient tout filmer en gros plans… comme dans le giallo, dont ils se plairaient maintenant à détourner les codes.
 Violence textuelle
Violence textuelle
Pour le couple, qui désirait parler d’un éveil érotique nimbé de pulsions sadomasochistes, le giallo, avec sa sexualité latente et sa violence explicite, s’imposait d’emblée. Mais il ne s’agissait pas d’en reprendre bêtement et platement les codes. Il fallait s’en servir pour dire autre chose. «
Amer, c’est un giallo raconté du point de vue de la femme. Il me semblait intéressant d’explorer, d’une part, les fantasmes féminins du cuir, de la violence, de la soumission/domination et de voir, d’autre part, un homme se faire mutiler à l’écran. », répond Hélène avec un sourire gêné.
Ce qui leur plaît, dans le giallo ? L’érotisation de la violence, le mariage d’Éros et de Thanatos, son traitement formel : couleurs baroques, musique psychédélique, vues subjectives, images mentales, mélange du rêve et de la réalité… même leurs interminables titres et leurs superbes affiches les fascinent. Ils aiment ce cinéma notamment parce qu’il leur permet de dire des choses très personnelles, très intimes, et de le faire dans un traitement formel esthétique. En somme, ils s’inspirent de films d’exploitation – mélange de grotesque (vulgarité, sexualité) et de sublime (beauté, raffinement) – pour cristalliser, dans des films d’art et d’essai, d’inconscients
leitmotiv : cuir noir, arme blanche, relation sado-masochiste…
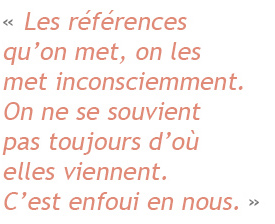 Compétence spectatorielle
Compétence spectatorielle
Le couple avoue en entrevue écrire à partir des
souvenirs qu’ils ont des films plus qu’à partir des films eux-mêmes. Ils élaborent même leurs scénarios en écoutant en boucle les trames sonores — souvent géniales — qui hantent les
giallis qu’ils ont vus. Cette musique devient la base de leur création, si bien que, s’ils n’obtiennent finalement pas les droits pour la musique qu’ils avaient envisagée, le film risque d’en souffrir. Même si l’on comprend que leurs nombreux renvois ne sont pas intellectuels mais sensoriels, s’imaginent-ils écrire pour des spectateurs « compétents », capables de saisir chaque renvoi ?
En entrevue, Bruno clarifie : « Il y a des spectateurs qui connaissent les codes et qui ne voient rien d’autre que les codes. En revanche, il y a des spectateurs qui ne connaissent pas les codes et qui voient plein de choses. Il se peut qu’un spectateur qui connaît le giallo ne comprenne pas notre film parce qu’il s’arrête aux codes sans voir ce que le code permet de raconter. Il y a différentes façons d’appréhender nos films selon ton bagage. Et de toute façon, on travaille la polysémie dans l’image, ce qui fait que tu peux avoir plusieurs interprétations différentes. Il n’y a pas qu’une façon de comprendre nos films. » Hélène insiste : « Les références qu’on met, on les met inconsciemment. On ne se souvient pas toujours d’où elles viennent. C’est enfoui en nous. On a même découvert des films auxquels on faisait référence
après avoir sorti le nôtre ! »
Soit ! Mais dans quelle mesure ce cinéma, construit sur des
souvenirs de films et fait de façon plus sensorielle ou pragmatique (ne cherchaient-ils pas à faire beaucoup avec peu de moyens ?) qu’intellectuelle, demande-t-il un spectateur compétent, dont l’encyclopédie personnelle recouperait la leur. Dans quelle mesure le spectateur doit-il connaître les films auxquels ils font — consciemment ou non — allusion pour les comprendre ? Dans quelle mesure ce savoir joue-t-il avec (ou déjoue-t-il) leur horizon d’attente ? Quand ils précisent que le premier segment d’
Amer renvoie au segment intitulé « La goutte d’eau » tiré des
Trois visages de la peur (Mario Bava, 1963) et qu’on leur rappelle que l’actrice qui y tenait le rôle principal — Jacqueline Pierreux — était la mère de Jean-Pierre Léaud qui fut d’abord connu par sa prestation remarquée dans
Les quatre cents coups (François Truffaut, 1959), film dans lequel il reçoit une gifle mémorable, et que cette scène ne pouvait pas ne pas annoncer la gifle qu’allait recevoir l’adolescente dans le segment central de leur film, le couple éclate d’un rire tonitruant. Jamais ils n’avaient pensé à ça. Et pourtant… ça fonctionne.
 Amer et après… ?
Amer et après… ?
Amer sort. Il remporte des prix, dont le Prix du public, à Montréal, au FNC, en 2009. Gaspar Noé les remarque et en parle en bien. Quentin Tarantino intègre le film dans son Top 20 de l’année. On les prend alors au sérieux. Ils croient à une farce. Ceux qui avaient prévu arrêter de faire des films après cette aventure, décident alors de poursuivre. Ils se mettent à leur prochain projet.
Page suivante >>


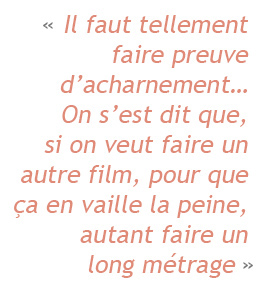 Amer est en effet construit comme un triptyque. Pour ce duo qui avait fait ses armes dans le court métrage, la structure seyait comme un gant. Il s’imagine alors raconter l’éveil de cette femme à trois étapes de sa vie : l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte. Non seulement, ils entreprennent de mettre en scène ces trois étapes en trois styles différents. « Comme on voulait faire un long métrage, explique Bruno en entrevue, on s’est dit qu’on allait traiter de ce thème dans trois styles différents, chacun lié à une époque de la vie de ce personnage. » Ainsi ont-ils offert à l’enfance un traitement gothique (entièrement tournée dans une vieille maison), à l’adolescence un traitement pinku (tourné sous le soleil du Sud) et à l’âge adulte un traitement giallo (tourné dans la pénombre la plus inquiétante). En somme, et même si leur cinéma est éminemment formel, Hélène et Bruno ont d’abord en tête leur thématique, le sujet dont ils veulent parler, et cherchent, ensuite, la meilleure façon d’en rendre compte. Le fond vient avant la forme. La matière avant la manière.
Amer est en effet construit comme un triptyque. Pour ce duo qui avait fait ses armes dans le court métrage, la structure seyait comme un gant. Il s’imagine alors raconter l’éveil de cette femme à trois étapes de sa vie : l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte. Non seulement, ils entreprennent de mettre en scène ces trois étapes en trois styles différents. « Comme on voulait faire un long métrage, explique Bruno en entrevue, on s’est dit qu’on allait traiter de ce thème dans trois styles différents, chacun lié à une époque de la vie de ce personnage. » Ainsi ont-ils offert à l’enfance un traitement gothique (entièrement tournée dans une vieille maison), à l’adolescence un traitement pinku (tourné sous le soleil du Sud) et à l’âge adulte un traitement giallo (tourné dans la pénombre la plus inquiétante). En somme, et même si leur cinéma est éminemment formel, Hélène et Bruno ont d’abord en tête leur thématique, le sujet dont ils veulent parler, et cherchent, ensuite, la meilleure façon d’en rendre compte. Le fond vient avant la forme. La matière avant la manière. 
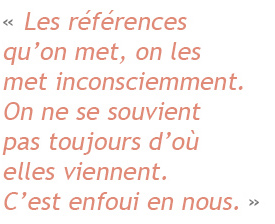 Compétence spectatorielle
Compétence spectatorielle


