Partie 1 |
Partie 2

Expérience sensorielle
En s’attelant à
L’Étrange couleur des larmes de ton corps, le couple désire pousser encore plus loin sa recherche esthétique. « Notre conception de la narration au cinéma est plus sensorielle que didactique. On veut raconter l’histoire par les sensations, faire
vivre l’aventure du héros au spectateur, et non pas lui
montrer quelqu’un vivre une aventure. », déclare Bruno lors de la classe de maître. Ils ne désirent pas donner à voir aux spectateurs des personnages vivant une histoire, mais donner à vivre l’histoire des personnages aux spectateurs. Il poursuit : « Comme le disait Roland Lethem, un cinéaste expérimental belge, le spectacle n’est pas sur l’écran mais dans la salle. Pour nous, c’est comme si le film était un monstre qui entrait dans la salle pour faire suffoquer les gens. » Et sa compagne nuance : « Il s’agit de communiquer viscéralement avec le spectateur. Le gros plan, c’est une tentative de rentrer dans le personnage pour
vivre ce qu’il vit, plutôt que d’
expliquer ce qu’il vit. On veut faire vivre cette expérience au spectateur en recourant à tous les moyens que la réalisation nous offre : les plans, les couleurs, le montage, la musique… On veut communiquer ce que ressent le personnage… le faire
ressentir… et non pas le faire comprendre. » Il conclut : « Du coup, c’est exigeant pour nous aussi, de travailler sur le film puisque nous essayons également de vivre ce que vivent les personnages. »
Tout ce travail passe beaucoup par la bande-son. « Dès l’élaboration du scénario, poursuit Hélène en entrevue radiophonique, on a des idées sonores. Puis, quand on tourne, on tourne sans son direct… avec uniquement un preneur de son pour les dialogues… Ça nous permet de tourner plus vite, de faire plus de plans. C’est en postproduction que ça se complique. On fait d’abord un montage-image muet, puis, avec un bruiteur, on fait un tournage sonore qui dure environ trois semaines. On recrée tous les sons du film et on décide si on veut des sons aigus ou bas, selon l’émotion que l’on veut faire vivre au spectateur. Pour un verre que l’on pose sur une table, par exemple, il y plusieurs couches de sons. Puis, on a trois mois de montage sonore pendant lesquels on synchronise et balance le tout avec le monteur son, plus un mois de mixage pendant lequel on spatialise tous les sons. Enfin, on expérimente le film en salle, de façon à entendre comment les sons voyagent dans l’espace. » Cette importance accordée à la bande-son constitue d’ailleurs une de leur « marque de commerce » les plus manifestes et les plus efficaces. « La création sonore devient pour nous de l’acousmatique. On a une conception rythmique du son. On n’essaie pas de recréer les sons de la réalité. Le son nous permet plutôt de toucher l’inconscient du spectateur, de l’immerger et de le manipuler. », conclut son conjoint.
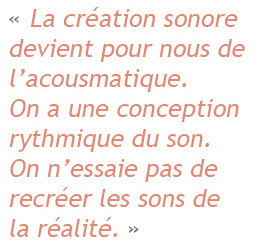
Enrichissement du réel
Ce cinéma sensoriel nous oblige en quelque sorte à voir leurs films en salle. Comme le disait laconiquement Bruno à Julien Fonfrède : « En salle, c’est le live, sur ta télé ou sur ton ordi, c’est l’album. » Il file ensuite la métaphore : « Il y a des spectateurs qui, lors de la projection de nos films, se précipitent sur les premiers sièges, comme ceux qui se mettent tout devant, pendant les concerts rock, pour en prendre plein la tronche. » En effet, faire l’expérience de leur cinéma, c’est faire une expérience sensorielle : l’image, grâce au son, devient pratiquement une matière tactile, les aiguës nous transpercent les oreilles et les basses nous traversent le corps. Sans doute victimes de synesthésie, Cattet et Forzani nous apprennent que les sensations émettent des couleurs, que la lumière même émet des sons. C’est notre réalité, ou notre rapport à la réalité, qui se trouve du même coup transformé.
Après avoir plongé dans l’univers de L’étrange couleur, après avoir baigné dans cette esthétique composée de couleurs criardes, de gros plans (visuels et sonores), de montage hachuré, il faut le dire, nous sortons de la salle ébranlés nous aussi et nous ne voyons plus notre monde de la même façon (qualité consubstantielle, il nous semble, à toute œuvre d’art). Appréhendant notre monde avec un regard neuf et des oreilles nouvelles, on remarque que les couleurs sont amplifiées, que la lumière est aveuglante, que les détails sont agrandis, que les sons sont décuplés et que chacun de nos moindres gestes, mentalement découpé, semble être dicté par une intensité dont on ignore la cause. Oui, ce cinéma sensoriel joue sur nos sens, nous habite longtemps après la projection et donne une étoffe insoupçonnée à notre quotidien.
Au public de la Cinémathèque québécoise, Bruno raconte avec émotion comment, après le visionnement de Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000), il sortit du cinéma, encore imprégné des images du film, observait les gens qui marchaient nonchalamment dans la rue, constatait l’écart entre l’univers dans lequel il venait d’être plongé et l’insouciance des quidams dans cette cohue… et comment il fondit en larmes sur le trottoir. C’est ce genre d’émotions que le couple voudrait générer chez son public. Plus que l’histoire alambiquée dont il serait vain de se souvenir, c’est plutôt une surabondance d’impressions qui nous taraudent. Le spectateur est ainsi invité à s’asseoir et à se laisser imprégner par les sensations, à se laisser habiter par elles.
La place du spectateur
Quand on leur demande, en entrevue, de résumer l’histoire complexe de L’Étrange couleur, le couple s’esclaffe d’une seule voix et refuse systématiquement. Bruno : « Résumer l’histoire, ce serait comme te donner le plan du labyrinthe. Ce serait fermer toutes les portes. Et il n’y aurait plus de place pour l’imagination du spectateur. » Hélène explique comment, devant un livre, elle a de la place, comme lectrice, pour imaginer. Elle a aussi besoin de cette place devant un film. C’est pourquoi ils cultivent les zones de non-dit, les flous, de façon à ce que le spectateur puisse avoir sa place. Quand on leur demande, une fois de plus, de nous dire ce que raconte L’étrange couleur, Bruno détourne de nouveau la question, et rappelle simplement la prémisse : « C’est l’histoire d’un homme qui rentre chez lui. Sa femme a disparu. La porte est fermée de l’intérieur. Il mène l’enquête dans la maison où il habite. » Hélène précise : « C’est l’histoire d’une enquête qui devient une quête. C’est l’histoire d’un personnage qui cherche quelqu’un, au début, et qui, à la fin, se cherche lui-même. » Et Bruno reprend la parole pour clore habilement la discussion : « C’est un Whodunit qui devient un WhoamI. »
Dès lors, on pourrait comparer la structure labyrinthique de L’étrange couleur des larmes de ton corps à L’année dernière à Marienbad (Alain Resnais, 1961), comme si celui-là était une version psychédélique et haute en couleur de celui-ci. Un peu comme dans le scénario d’Alain Robbe-Grillet, les lectures du film de Cattet et Forzani se ramifient au hasard des portes que l’on ouvre. Du coup, trois attitudes possibles, pour le spectateur. La première, pourrait-on dire, consiste à démissionner d’emblée en se disant qu’il n’y a rien à comprendre. La seconde, pourrait-on poursuivre, consiste à jouer le rôle du flic, à tenter de résoudre l’enquête, à mettre le doigt — sinon la main — sur le coupable, bref, à trouver une réponse, attitude qui risque toutefois de susciter de violentes frustrations. La troisième, la plus judicieuse selon nous, consiste à explorer et à recenser les diverses possibilités offertes par le film, sans en exclure une au profit de l’autre. Le plaisir spectatoriel pourra ainsi sourdre de la mise au jour de ces multiples couches narratives sur lesquelles le film semble construit.
Les cinéastes l’ont dit et redit ; ils jouent avec nous — avec nos nerfs, avec notre sensibilité, avec notre inconscient… mais aussi avec notre savoir, notre mémoire, notre intelligence. Plutôt que de faire suffoquer un personnage, ils feront suffoquer leurs spectateurs. Plutôt que d’en montrer l’angoisse, ce sont les spectateurs qui la vivront. Un personnage peine à l’écran pour comprendre l’inextricable dédale dans lequel il s’enfonce, c’est le spectateur qui verra poindre en lui mille questions. Et si les personnages cherchent dans leurs souvenirs pour mieux comprendre leur présent, les spectateurs chercheront eux aussi dans les leurs, pendant le film, pour mieux comprendre ce dont ils sont témoins. « Où ai-je déjà vu cette scène ? Où ai-je entendu cette musique ? Dans quel film se trouve ce plan ? » Ce sont aussi les souvenirs du spectateur lui-même, son bagage cinéphilique, qui seront mis à contribution pour donner du sens à ce cinéma sensoriel, certes, mais aussi intertextuel. La recherche d’indices qui habite les personnages taraude ainsi les spectateurs qui se disent que, s’ils peuvent répondre à ces questions, ils auront au moins un avantage cognitif sur ceux-là.

Gain signifiant
Le spectateur qui a une idée du bagage référentiel de Cattet et Forzani voudra sans doute poursuivre le jeu : trouver, dans son encyclopédie personnelle, la scène à laquelle le tandem fait référence et revenir à leur film avec, en poche, un « gain signifiant », une sorte de « plus-value sémantique ». Prenons, par exemple, l’arrivée de Dan, au début de L’Étrange couleur… Atterrissage à l’aéroport. Bagages. Taxi. La caméra est posée sur la banquette arrière, à sa gauche, et le filme de profil, nous donnant du même coup à voir les éclairages baroques qui défilent à l’extérieur. Il arrive chez lui, un immense immeuble à appartements aux vitraux imposants. Toute cette entrée en matière, c’est Suspiria (Dario Argento, 1977). Dès lors, le spectateur compétent déploie une grille lecture : il y aura sans doute une présence maléfique dans cet immeuble. Au reste, les asticots qui tomberont sur le journal intime, plus tard dans le film, permettront de confirmer cette hypothèse.
Et le spectateur compétent poursuit sa lecture, passant d’un texte à l’autre. Si la femme de Dan, Edwidge (Fenech ?), est noire, c’est parce qu’on fait référence à Carlat Brait dans Torso (Sergio Martino, 1973), et qu’elle se fera sans doute saucissonner, comme elle, par un sadique qui s’est entiché d’elle. Tout le rituel érotique qui se déroule dans la chambre du haut — avec la sensuelle Barbara (Bouchet ?) et son vinyle translucide, son encens et ses éclats de verre —, n’est pas sans rappeler le rituel (satanique, quant à lui) de Toutes les couleurs du vice (Sergio Martino, 1972). La façon dont est filmée la gamine au travers la voilette que porte la mystérieuse femme en rouge évoque évidemment la façon dont on filmait les enfants dans Qui l'a vu mourir ? (Aldo Lado, 1971). Or, quand on sait qu’il s’agissait, dans ce film-ci, d’un homme déguisé en femme, on peut commencer à douter de la véritable personnalité de celle-là.
Idem pour la séquence — cauchemardesque — pendant laquelle Dan, se faisant sans cesse réveiller par sa tonitruante sonnette, en vient à se lever, à voir son double, à se faire entrer chez lui, à se tuer lui-même… On ne peut pas ne pas penser à cette mémorable séquence où Giacomo Rossi Stuart, dans Opération peur (Mario Bava, 1966), se court inlassablement après dans une angoissante boucle temporelle. Dès lors, celui qui se souvient de cette séquence pourra pressentir que le secret que Dan cherche à résoudre remonte très loin dans le temps. Sentiment peut-être confirmé par l’apparition des jouets d'enfant, et notamment de la poupée (dont on éclabousse les vêtements de sang — et qui évoquent ceux que porte la jeune Laura dans le dernier plan) qui rappelle celle de Torso (Sergio Martino, 1973). Encore une fois, un spectateur percevant le renvoi confirmera que le problème qui ronge le personnage vient sans doute de son enfance.
Même chose pour la façon dont on filme la lame pénétrer dans l’entrejambe de ces femmes sans visage. Le spectateur compétent pensera immédiatement au plan similaire dans Mais... qu'avez-vous fait à Solange ? (Massimo Dallamano, 1972), film dans lequel on a fait subir à ladite Solange un cruel avortement maison. Or, fort de ce savoir, comment interpréta-t-il le sang – les « larmes » à l’« étrange couleur » lui coulant sur le « corps » — qui descend sur la cuisse de la jeune Laura, à la toute fin du film ? Ce sang est-il le résultat de ses menstruations, d’un viol… ou d’un avortement ?
Le journal intime autour duquel tourne le récit évoque le journal intime de Six femmes pour l'assassin (Mario Bava, 1964). La façon dont on filme les deux cheveux blancs que tient Dan entre ses doigts rappellent la façon dont on filmait les sourcils arrachés à Jean-Louis Trintignant dans La Mort a pondu un œuf (Giulio Questi, 1968). La façon dont on filme l’assassin ressemble à la façon dont on filmait l’assassin de L’Oiseau au plumage de cristal (Dario Argento, 1970). Or, quand on connaît l’issu de ce film-ci, on prendra garde de sauter trop vite aux conclusions devant ce film-là.
Et ce va-et-vient cinéphilique pourrait continuer longtemps. Cependant, quand on énumère au couple ces multiples renvois d’un film à l’autre, il ne peut s’empêcher de rire. Hélène tente de reprendre la balle au bon : « En fait… on pourrait même dire que le spectateur compétent, parce qu’il perçoit un renvoi (que nous avons peut-être mis inconsciemment, que nous n’avons peut-être même pas voulu mettre), se fait des attentes qui ne seront pas nécessairement satisfaites. Du coup, parce qu’il a un savoir que le spectateur non compétent n’a pas, il peut se trouver encore plus perdu. » Et voilà comment le gain peut engendrer une perte.

Faculté d’adaptation
C’est en 2005, alors qu’elle tourne Santos Palace avec Bruno, qu’Hélène lit le roman policier de Jean-Pierre Bastid et de Jean-Patrick Manchette : Laissez bronzer les cadavres (1971). Au moment même où le couple explore un autre genre — Santos palace nous offre un inventif, poignant et mémorable duel d’yeux —, l’esthétique du western italien s’impose à elle. « Le siège, notamment, m’a beaucoup fait penser au western. », révèle-t-elle en entrevue.
Préférant l’action à la psychologie — ou disons, la psychologie par l’action —, elle trouve de quoi se sustenter dans ce récit où les personnages agissent sans cesse et se définissent par ce qu’ils font. Le roman est franc, sec, direct, sans flafla, comme leur cinéma. De plus, le roman exploite ses notions d’espaces avec lesquelles ils sont familiers. En revanche, le roman, chapitré en heures, impose d’emblée une narration chronologique à laquelle le couple, habitué aux récits dédaléens, est étranger. À L’Impérial, après la première du film, Bruno avoue au public qu’il se disait « moins chaud », au départ. Il avait envie de continuer à explorer ce type de « récit gigogne », de « narration labyrinthique ». Or, dès qu’il se lança dans l’adaptation, il eut, pendant les trois semaines qu’a duré l’exercice, un « plaisir fou… ça s’est fait tout seul ». Il allait s’agir d’un nouveau défi à relever, d’une démarche entièrement différente à explorer.
« Pour Amer et L’étrange couleur, nos démarches étaient déjà différentes, rappelle-t-il en entrevue. Pour Amer, le point de départ était une phrase (tiré du Bal) et une image (tirée de Sadistic and Masochistic)… Alors que dans L’étrange couleur, notre point de départ c’était plutôt de déconstruire le whodunit… non pas faire un giallo, mais un jazzlo. Dans le premier cas, on partait d’un thème, dans le second, d’une structure. Ici, on partait d’un roman qu’il fallait adapter. » De plus, confessait Bruno à la Cinémathèque, « après Amer et L’étrange couleur, qui sont deux films très intimes, on est allés à l’extrême limite de notre relation. On s’est dit qu’il ne fallait plus faire de film intime tous les deux parce qu’on ne pourrait plus travailler ensemble. Ainsi, le livre était un matériau neutre qui nous a permis de retravailler ensemble de façon joyeuse… et non plus dans le conflit. » Aurions-nous été à deux doigts de voir le couple se séparer et de nous voir privés de leurs films ?
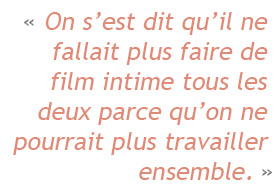 Couple fidèle
Couple fidèle
Comment Hélène et Bruno allaient-ils s’y prendre pour adapter une œuvre qui n’était pas la leur tout en respectant ce qu’ils avaient déjà fait ? « Il fallait être fidèle au roman tout en étant fidèle à nous-mêmes. », établit-il. Dans le roman, il y a seulement deux petites phrases qui évoquent le passé de Luce. Un passé lors duquel elle s’éclatait comme artiste de happening. On apprend qu’elle faisait des « jeux olympiques du sexe », qu’elle baisait dans l’or devant public. Après la première, à L’Impérial, il explique ainsi les nombreux
flash-back du film : « Pour nous, ces deux phrases étaient comme une porte d’entrée grâce à laquelle on pouvait continuer à explorer les fantasmes sadomasochistes que l’on trouvait dans nos précédents films. » D’où les scènes de bondages et d’urophilie, d’ailleurs magnifiquement tournées.
Et puis, même s’ils reprennent le chapitrage du livre — qui se marque en heures —, ils se sont aussi permis de jouer avec cette chronologie. Jouant avec le temps dans les intertitres, mais aussi entre eux, les cinéastes n’éprouvent aucun problème à présenter deux policiers démarrer leurs motos et, en un coup de pédale sur lequel ils coupent, à nous les montrer en descendre à leur point d’arriver. Voilà comment on ellipse un voyage qui n’apporte rien au récit. Voilà comment on continue de jouer avec le temps. « Comme dans le roman, il y a de ponctuels retours en arrière qui nous permettent de revoir une même scène d’un autre point de vue, mais dans le dernier tiers du film… », ils laissent tomber ces intertitres temporels pour continuer d’explorer une autre de leur obsession : l’onirisme qui s’immisce dans le réel. La dernière partie est hallucinatoire.
Cependant, le couple se reconnaissait aussi dans le traitement thématique que Bastid et Manchette donnaient à leur polar, lequel allait leur permettre d’explorer une autre facette de leur double personnalité. « Dans le western classique à l’américaine, on est toujours du côté du shérif. Là, dans le roman, on est contre la loi et l’ordre. Leurs romans contiennent cette dimension politique anarchiste post-soixante-huitarde qui fut cependant édulcorée dans les autres adaptations, notamment avec Alain Delon, dont les opinions politiques sont à l’opposé de celles que l’on trouve dans les romans. », apprend Bruno lors de la classe de maître. « La dimension politique, subversive, a été évacuée. » Ils voulaient la lui redonner. Et c’est pourquoi l’idée d’adapter le roman à la façon du western spaghetti s’imposait et les stimulait.
Il poursuit : « Dans le western italien, nous ne sommes plus du côté du shérif, nous sommes, au contraire, très souvent du côté des truands, contre la loi et l’ordre. » Cet esprit anarchiste demandait d’ailleurs à être urgemment réactivé. Bruno se rappelle avec émoi : « Au moment où on faisait l’adaptation, la tuerie de Charlie Hebdo a éclaté. Bastid et Manchette gravitaient dans ce milieu-là. Pour la première fois, on attaquait, dans notre société, cet esprit anarchiste qui, dans le roman, s’effondrait aussi. Tout d’un coup, il devenait urgent de faire ce film. Et nous ne voulions surtout pas trahir cet esprit-là, mais le revendiquer. » Luce, l’artiste cinquantenaire au passé jonché de happenings (admirablement campée d’ailleurs par Elina Löwensohn), le dira sans ambages au flic amoché de l’histoire : « Je n’aime pas les flics. Je n’aime pas la société. »
 Se peinturer dans le coin
Se peinturer dans le coin
Même s’ils allaient continuer à explorer l’érotisme et l’onirisme, n’y avait-il pas un risque, pour le couple, de passer d’un genre à l’autre. Ne s’étaient-ils pas fait connaître au public par le détournement de codes propres au giallo ? N’allait-il pas être prisonnier de leur « marque de commerce » ? Dès la première scène, les cinéastes semblent faire le point, offrir un «
statement » (comme on dit en anglais) : nous quittons clairement le giallo pour le western. Coup de feu. Soleil plombant. Coup de feu. Ciel bleu. Coup de feu. Sable brûlant. Coup de feu. Les malfrats tirent, en gros plan. Mais sur qui ? Sur quoi ? Coup de feu. Déboîtement. Une immense toile sur laquelle viennent d’être lancées toutes les couleurs du genre précédemment exploré : rouge, bleu, jaune, vert. Et Luce de laisser tomber son verdict avec aversion : « Trop symétrique. » On n’aurait su avoir meilleur règlement de compte. Fini les couleurs criardes et la plastique giallesque ! Les cinéastes vont se perdre sous le soleil de la Corse et nous offrir un superbe film en bleu et or.
Dans quel esprit ont-ils écrit le scénario ? Avaient-ils des appréhensions quant à ce changement de registre ? Se demandaient-ils comment allait être reçu ce film nouveau genre ? Comment ont-ils composé avec les attentes que leur public se faisait ? On leur pose la question en entrevue. « En fait, quand on écrit, on essaie d’oublier ce qu’on a fait avant… et on essaie de ne pas penser à ce qu’on attend de nous, nous explique Bruno. On ne se dit pas “je vais m’empêcher de faire ceci ou de faire cela parce que je l’ai fait avant”. On essaie d’être le plus sincère possible… d’être le plus organique possible… » Et puis Hélène ajoute : « On veut toujours apprendre et essayer de nouvelles choses… on ne reste jamais sur nos acquis… on veut toujours trouver de nouvelles associations. Du coup, ça nous empêche de nous répéter. » Et Bruno relance : « On est des débutants. C’est vrai. On a tourné au total 120 jours dans nos vies. On est toujours en train d’apprendre. »


 Comment diriger des stars sous le soleil
Comment diriger des stars sous le soleil
Toujours désireux de repousser les limites et, voudrait-on dire, de se mettre des bâtons dans les roues, Hélène et Bruno quittent leurs somptueux intérieurs gothique ou Art nouveau pour le torride soleil de la Corse. Ils trouvent une piaule un peu déglinguée sise tout au haut d’une montagne au sommet de laquelle on ne peut arriver qu’après une trentaine de minutes de marche et où l’on doit déposer — et reprendre — le matériel à l’aide d’un hélicoptère. Ils racontent l’anecdote à L’Impérial. Il y a eu plusieurs accidents pendant le tournage, plusieurs blessures. On était habitué de nous voir arriver à l’hôpital. Mais l’ensemble c’est fait dans la joie et le plaisir.
On sue sous ce climat sec. Et on cadre chaque goutte de très près. « Quand on a commencé, raconte Hélène, les acteurs n’aimaient pas trop notre façon de faire. Ils se disaient qu’ils n’étaient que des pantins entre nos mains. Qu’ils n’avaient pas trop de place pour le jeu. Au contraire ! Ils doivent faire passer tout leur jeu dans un tout petit cadre. On cadre leur œil, leur bouche… On est même parfois obligé de tenir leur tête pour ne pas qu’ils sortent du cadre. Et puis, puisqu’on ne filme jamais avec le son direct, on leur parle, on leur donne des indications, on cherche à les mettre dans l’état souhaité. Dans ce film, les comédiens nous ont fait entièrement confiance. »
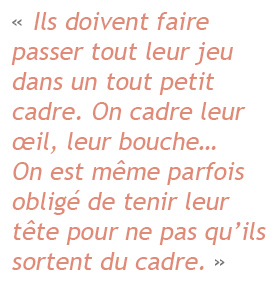 Détournements mineurs
Détournements mineurs
Laissez bronzer les cadavres est une œuvre prenante, captivante, fascinante. Comme l’or qu’ils filment, c’est une réalisation brillante, éclatante, éblouissante. Le couple, toujours désireux de faire les choses comme elles ne se sont jamais faites, filme tout ce qui n’est pas propre au western comme un western et tout ce qui est propre au western autrement que comme un western. Ils ne sont jamais là où on les attend. Contrairement à leurs personnages, ils évitent de tomber dans les pièges. Des exemples ? Avec eux, allumer un briquet n’est plus un geste banal, mais devient, grâce au traitement sonore, un geste épique qui évoque le maniement du révolver. Avec eux, les discussions les plus anodines prendront l’allure, grâce à d’inventifs travelings latéraux, de véritables duels. Avec eux, l’arrivée des truands à contre-jour dans la poussière dorée ne se fera pas lors de l’incontournable combat final, mais lors des happenings de Luce, pendant lesquels se sont les spectateurs qui s’avancent vers l’artiste. Toujours là où on ne les attend pas. Et puis, quand ils filment une scène où les malfaiteurs s’emparent de leurs mitraillettes, Cattet et Forzani ne peuvent s’empêcher de la filmer comme celle dans laquelle le tueur de
L’Oiseau au plumage de cristal (Dario Argento, 1970) choisissait son rasoir.
Récupérant toujours les codes des films d’exploitation italiens, le duo continue de puiser dans l’imaginaire de Sergio Leone, Corbucci ou Solima, dans l’univers de Castellari et consorts. Il repique et détourne même l’univers musical. Ce qu’il y a de fascinant, dans la façon dont il repique et détourne, c’est que, là encore, les musiques explicitement tirées de westerns —
Faccia a faccia (Sergio Sollima, 1967),
¡ Mátalo ! (Cesare Canevari, 1970) — sont celles qui en évoquent le moins l’univers alors qu’ils nous font découvrir la « westernité » de la musique des films qui n’ont rien à voir avec le genre :
Sur la route de Salina (Georges Lautner, 1970),
Journée noire pour un bélier (Luigi Bazzoni, 1971),
Nuits d'amour et d'épouvante (Luciano Ercoli, 1971),
L'Étrange vice de madame Wardh (Sergio Martino, 1971),
Qui l'a vu mourir ? (Aldo Lado, 1972),
La Terreur des zombies (Marino Girolami, 1980). En bref, mettre de la musique de western qui n’a pas l’air de musique de western sur des scènes de western afin de les vider de leur westernité et mettre de la musique qui n’est pas de la musique de western sur des scènes qui ne sont pas des scènes de western afin de leur injecter de la westernité. Il s’agissait, résume Bruno, de « miser sur le contrepoint genresque ».
 La suite
La suite
Le cinéma de Cattet et Forzani fait non seulement du neuf avec du vieux, mais dépoussière le vieux, nous permet de revoir, non seulement notre monde avec plus d’acuité, mais les vieux films avec un nouveau regard. En cela, il est fascinant. Mais leur cinéma est aussi fascinant en cela qu’il atteint le parfait équilibre entre un cinéma narratif et expérimental, entre un cinéma sensoriel et intellectuel, entre un cinéma d’art et d’essai et un cinéma de divertissement. Et cet équilibre, ils l’atteignent peut-être grâce à leurs univers respectifs bien différents dans lesquels chacun invite invariablement l’autre. Bruno offre peut-être la clé de cet équilibre en entrevue : « Il y a des choses qui sont évidentes pour moi et pas assez pour Hélène ou encore évidentes pour Hélène et pas assez pour moi. » C’est sûrement grâce à cette intime collaboration que leurs films sont si finement polysémiques, si inexplicablement captivants et qu’ils arrivent à se tenir en équilibre sur le fil (du rasoir) entre le « vouloir dire quelque chose » et le « ne pas dire n’importe quoi ».
Que nous réservent ceux qui n’entrevoyaient plus faire de films après leur premier long métrage ? Un troisième volet à
Amer et
L’Étrange couleur… Mais aussi, l’adaptation d’un roman érotico-pornographique qu’un producteur montréalais (tiens, encore Montréal !) leur a mis entre les mains. Peu inspirés de le faire en prises de vue réelles, le couple, qui ne recule devant aucune difficulté et n’hésite jamais à se mettre en situation où ils ont tout à apprendre, envisage de le faire en animation, façon
Belladonna de la tristesse (Eiichi Yamamoto, 1973). Ce sera alors l’occasion d’un voyage au Japon, question d’en faire l’adaptation dans le style
pinku.
En attendant leurs prochains films, on offrira ce petit Top 5 offert par le couple à ceux qui veulent explorer l’univers du giallo. Outre les incontournables
La Fille qui en savait trop (1963) et
Six femmes pour l'assassin (1964) de Mario Bava, citons :
°
Profondo Rosso (Dario Argento, 1975)
°
Ténèbres (Dario Argento, 1983)
°
Le Venin de la peur (Lucio Fulci, 1970)
°
L'Étrange vice de madame Wardh (Sergio Martino, 1970)
°
Qui l'a vu mourir ? (Aldo Lado, 1972)
<< Page précédente

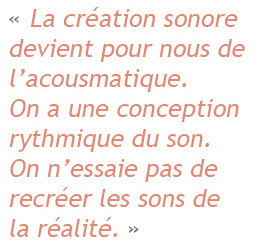


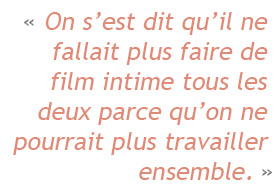 Couple fidèle
Couple fidèle 



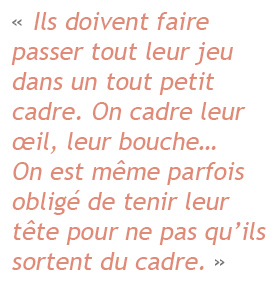 Détournements mineurs
Détournements mineurs


