
CITY HALL
Frederick Wiseman | États-Unis | 2019
À 91 ans, avec plus de 45 films derrière lui, Frederick Wiseman impressionne dans l’ardeur, la compétence et l’aisance avec laquelle il poursuit sa radiographie du monde et plus régulièrement celle de l’Amérique. Avec City Hall, Wiseman propose une observation détaillée de la gouvernance de Boston en y suivant le maire Marty Walsh et son équipe dans ce documentaire épique de 4h30. S’intéressant à des problématiques aussi larges que le racisme, l’habitation, l’environnement, la diversité, l’accès à la culture, l'équité, le développement urbain et plusieurs autres, le film de Wiseman réussit à détailler durant près d’une année la complexité des défis auxquels l’administration d’une ville américaine peut faire face, tout en démontrant de véritables exemples de démocratie en action. Pour s'intéresser à l'impact social du travail municipal, Wiseman privilégie la captation des dialogues entre citoyens et politiciens, faisant voir des gens engagés dans leurs communautés et usant de leur droit de parole pour questionner et influencer les décisions. L’équipe démocrate élue est d’ailleurs régulièrement captée dans une posture d’écoute et de dialogue ouvert, donnant à voir une gouvernance à l’opposé de celle de Trump qui dirige alors le pays (Walsh critique d’ailleurs occasionnellement les stratégies de ce dernier). Wiseman a su organiser adéquatement les nombreuses heures d’images par la clarté de son montage alternant les fonctions municipales dans une évolution narrative qui construit un portrait positif d’une démocratie possible. Surtout, malgré sa durée qui pourrait paraître rébarbative (mais qui peut se regarder parfaitement en épisodes), City Hall offre un spectacle fascinant de la démocratie au quotidien, donnant par le fait même envie de s’engager dans ses discours qui nous touchent de près. En choisissant Boston et son maire, Wiseman ne fait pas que montrer la fonction publique à l’œuvre, il démontre spécifiquement que la démocratie est possible dans son exécution quotidienne, une réussite plus que bienvenue dans cette année sombre de la politique américaine. En guise d’épilogue au film de Wiseman, notons qu'il fut enfin annoncé dans les dernières semaines que le nouveau président américain Joe Biden a choisi Marty Walsh pour occuper le poste de secrétaire au Travail (United States Secretary of Labor) dans sa nouvelle administration.
Texte : David Fortin

NOMADLAND
Chloé Zhao | États-Unis | 2020
Brillamment interprété par Frances McDormand, le personnage de fiction, Fern, tiré tout droit des anecdotes du livre Nomadland écrit par Jessica Bruder, nous prend par les sentiments tant sa vulnérabilité, sa sensibilité et son côté récalcitrant nous agrippent le cœur. À soixante-quatre ans, elle a tout perdu : son mari, Beau, son emploi en tant qu’enseignante suppléante à Empire, une cité ouvrière de mine de gypse au Nevada, là où travaillait également son compagnon. Au centre local d’emploi, la seule perspective proposée est la retraite anticipée. Rebutée par cette éventualité, elle insiste en proclamant qu’elle aspire plus que tout à travailler. Empire, qui autrefois lui a procuré sûreté et subsistance, est en plein déclin et rien de bon ne l’y attend. Rassemblant le strict nécessaire, elle décide de partir dans l’ouest au volant d’une vieille camionnette qu’elle a aménagée au mieux pour son nouveau départ. Loin de se considérer comme une itinérante, une homeless, elle préfère le terme de houseless, qui reflète bien mieux sa situation nomadique avec sa maison mobile qu’elle a surnommée avec humour vanguard. Goûtant ainsi par la force du destin à la liberté, elle savoure ces instants, seule pour la première fois depuis de nombreuses années, mettant à rude épreuve son autosuffisance. Décontenancée, désespérée parfois, elle attrape tout ce qui lui tombe sous la main : invitations, rencontres, labeurs saisonniers, avec l’espoir de jours meilleurs. Comme un passage rituel animé par le besoin fondamental d’incarner pleinement ce que nous sommes, Fern se cherche, se réinvente, toujours prête à profiter du moment présent tout en étant proactive dans ses choix. Confrontée à la vraie vie, elle s’observe et entreprend un voyage autant intérieur qu’extérieur. Au-delà de l’étiquette politico-sociale que l’on pourrait attribuer à ce film si proche de la réalité, Chloé Zhao nous transmet des valeurs, celles d’une indépendance d’esprit assumée et d’une identité réaffirmée par l’authenticité d’une existence réduite à son essence. La réalisatrice dépeint avec finesse des effets bienfaiteurs d’une solitude retrouvée au travers d’une nature réparatrice ainsi que de la force résidant dans la richesse de possibilités s’offrant à nous.
Texte : Claire-Amélie Martinant

NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS
Eliza Hittman | États-Unis | 2020
Le rideau se lève d’abord sur les années 50, et il s’agit déjà là d’un tour de passe-passe génial. Nous assistons à un spectacle scolaire où les adolescents de Shamokin (Pennsylvanie) effectuent des imitations d’Elvis Presley, d’harmonies Barbershop et autres chorégraphies rockabilly. L’illusion est bluffante. Jusqu’à ce qu’Autumn (Sidney Flanigan), la protagoniste, entre en jeu, avec une chanson folk déchirante qui relate assez explicitement les abus qu’elle subit aux mains de son amoureux. Mais tout le monde s’en fout. Un garçon anonyme se permet même de lui lancer lâchement un retentissant « salope » (slut). C’est ainsi, après tout, qu’on qualifie encore les victimes de viol dans les États-Unis d’aujourd’hui, où les femmes vivent encore à l’époque du maccarthysme. Dur, donc, pour elles de trouver des ressources, voire un soupçon d’empathie quand vient le temps d’interrompre une grossesse non voulue, épreuve qui forcera Autumn à entreprendre un douloureux voyage vers une clinique d’avortement new-yorkaise avec son unique complice, Skylar (Talia Ryder).
Never Rarely Sometimes Always, avant d’être une histoire de ventre, est une histoire de yeux et de mains, et en cela, elle est incroyablement perceptive. Pensons d’abord aux mirettes mémorables des deux actrices, celles de Flanigan particulièrement, qui scrutent désespérément le hors-champ à la recherche d’une aide élusive, mais à l’affût aussi des prédateurs mâles. Il s’agit là de mirettes exemplaires, vecteur d’une interprétation sensible et évocatrice d’un personnage fragile, fragilisé encore davantage par la violence avec laquelle on tente de la contraindre à la maternité. Il y a aussi l’œil complice et perspicace de la directrice photo Hélène Louvart, qui capture sans effort un florilège de moments cruciaux, adoptant la perspective de l’héroïne avec un lyrisme prosaïque parfaitement ad hoc. Il y a finalement l’ineptie du regard masculin, son égocentrisme surtout, insensible à la détresse féminine tant il est obnubilé par ses propres intérêts. Les mains agissent à l’écran de manière analogue. Celles de Théodore Pellerin, excellent en rapace ordinaire, est sournoisement possessive, tandis que celle des femmes est beaucoup plus interactive, quémandeuse et pourvoyeuse d’une chaleur salutaire dans le monde froid du dogme patriarcal.
Texte : Olivier Thibodeau

SOUND OF METAL
Darius Marder | États-Unis | 2019
Faire entendre la surdité au cinéma est un pari drôlement risqué, car peu importe si le film coupe sa bande-son, le spectateur n’entendra jamais rien d’autre que le silence, expérience tout à fait distincte de l’absence de son, pour celui qui en est complètement privé. Mais l’intelligence de Sound of Metal réside d’abord en ce que Darius Marder utilise le son comme une ressource expressive proprement cinématographique, et non comme une simple adhésion à la subjectivité de son protagoniste : quand Ruben, batteur dans un duo de musique métal, perd graduellement l’ouïe, cette expérience est vécue comme une pure perte engendrant une crise existentielle, mais distordre, atténuer ou couper le son au cinéma se ressent plutôt comme un gain expressif. En jouant de ce contraste, en choisissant soigneusement les moments où travailler le son pour nous faire entendre la perspective de Ruben, Marder parvient à garder la juste distance entre le spectateur et le personnage, pour chercher avec lui une manière de reconnecter avec le monde en acceptant la perte de sens (de façon littérale et figurée) pour l’accepter et la transformer peu à peu : Ruben perd le son du métal, sa musique, mais retrouve le son du métal d’une glissoire dans un parc, sur laquelle il tambourine en utilisant ces vibrations pour communiquer avec un enfant sourd. Tout perdre pour essayer de se retrouver, de renouveler son rapport au monde, ce type de mélodrame nous est bien familier, mais il est toujours émouvant de le retrouver lorsque traitée de manière aussi juste, tenu aussi par la performance magistrale de Riz Ahmed. Et il va sans dire que dans ce 2020 qui a été aussi vécu par plusieurs comme une perte de repère, une rupture radicale avec ce que l’on croyait acquis, un tel film sur l’acceptation de la perte venait apporter un peu d’espoir.
Texte : Sylvain Lavallée
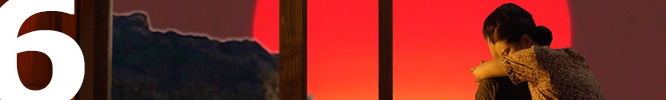
LABYRINTH OF CINEMA
Nobuhiko Ôbayashi | Japon | 2019
« L’homme a du génie lorsqu’il rêve ». L’adage célèbre d’Akira Kurosawa résonne du fond jusqu’aux combles de l’ultime film de Nobuhiko Ôbayashi, ce Labyrinth of Cinema à l’inventivité cruciale, à la folie faite pierre ; film de pauvre se tenant comme un film de fou, chef-d’œuvre fauché fait d’une esthétique monumentale plus naïvement inventive que le plus millénarial des millénariaux, il donne à voir une perception haptique de l’histoire du cinéma, où l’inventivité formelle se couche dans un rapport frontal à l’histoire du Japon et sa mémoire de la guerre, une couchette qu’Ôbayashi, fidèle de Kurosawa l’ayant filmé dans un beau making-of de Rêves (1990), sait avoir à faire advenir encore. Le Japon d’après-guerre ayant refusé d'accepter qu’il s’éternisait, qu’il fallait continuer d’excaver le passé pour comprendre comment culture et militarisation ne sont pas si faciles à décrotter l’une de l’autre, Ôbayashi doit trouver des manières de superposer le symbolique (le Soleil rouge, la Bombe) et la vie grouillante (les souvenirs, la nostalgie, les instantanés inter et intra que l’Histoire ignore même quand elle dit s’intéresser à la culture), dans un vaste exercice de scrapbooking où l’impressionnante trajectoire du cinéma japonais d’après-guerre se fait fil conducteur idéal et idéalisé.
Car Ôbayashi, décédé en avril 2020 à l’âge de 82 ans, signe un film de l’acabit de ceux des vieux sages, faisant preuve une dernière fois de sa dévotion totale à la puissance du cinéma, au fait que « tout peut s’y produire », qu’ils « sont des rêves » au même titre que les « rêves sont du cinéma », une prise de position réversible et fondamentale à la tendance humaniste d’après-guerre du cinéma japonais, où prospective sociale et réconciliation des traditions cherchaient à consoler un peuple humilié par la défaite et traumatisé par le double bombardement atomique. « Les films aideront les jeunes à bâtir le futur », dit le vieux projectionniste de la salle de cinéma qui semble contenir tout le film, où se croisent les genres, les styles, les caméos improbables mais avérés (comme celui de John Ford, qui a réellement croisé Kurosawa sur son plateau en 1945 quand les Américains visitèrent la Toho), les références aux cauchemars militaristes de Masaki Kobayashi, aux complaintes mélodramatiques de Keisuke Kinoshita, ces cinéastes au cœur meurtri et de qui Ôbayashi, malgré ses atouts expérimentaux et psychédéliques, était en quelque sorte le dernier héritier.
En ouvrant cette porte redécorée pour les nouvelles générations de spectateurs qui découvrent à leur rythme la riche histoire de la cinématographie japonaise et de son dialogue avec sa société, Ôbayashi nous livre avec Labyrinth of Cinema un authentique labyrinthe mnésique, un jeu à visiter et à revisiter, à la fois comme le nouveau maître-livre du cinéma japonais et comme son épilogue inattendu, un dernier hommage aux géants de l’après-guerre, à ce cinéma qui me semble encore être le plus beau jamais tourné et qui peut enfin, avec ce film-testament, se clore en paix.
Texte : Mathieu Li-Goyette

SHIRLEY
Josephine Decker | États-Unis | 2020
Adaptation de Shirley, A Novel (Susan Scarf Merrell), Josephine Decker (Madeline's Madeline [2018]) interpole une couche de complexité à cette fiction écrite par une autrice sur une autrice. À l’automne 1964, lorsqu’un jeune étudiant diplômé et sa femme enceinte emménagent dans la maison de la romancière d’horreur Shirley Jackson (Elisabeth Moss) et de son imparable mari Stanley Edgar Hyman (Michael Stuhlbarg), la fascination qu’inspire la femme enceinte se marie à la terreur qu’exerce rituellement la femme d’expérience non conventionnelle. Leur alliance irrésistible, à l’érotisme émoustillant, voit affleurer un autre duo amour-haine brillant, quelque part entre Mulholland Drive, Persona, et lointainement Thelma & Louise, au bord du gouffre. Car Shirley est également un film sur le désir d’autodétermination des femmes, dans un milieu intellectuel machiste où l’approbation de ces messieurs finit par faire l’affaire de toutes. La maternité, qui couve ou brille par son absence volontaire, en demeure omniprésente, et protéiforme, état de toute puissance, aboutissement physique et cérébral de la fertilité du corps ou de l’esprit. La relation échafaudée entre ces dames, condition de réussite sine qua non du récit, — et de l’histoire dans l’histoire —, n’est autre que la conjecture astucieuse de Shirley dont la fin justifie les moyens. Après tout, « les femmes comme Shirley n’ont pas d’ami.e.s », dit-on. Avec sa caméra épaule virtuose, et sans scrupules, qui rehausse magnifiquement chaque plan et aiguise les sens, Shirley redonne en prime du souffle à la carrière de Moss qu’on n’avait pas sentie renouvelée et si bien mise en valeur depuis The Square et sa révélation dans Mad Men.
Texte : Anne Marie Piette

DWELLING IN THE FUCHUN MOUNTAINS
Gu Xiaogang | Chine | 2019
Premier film d'une trilogie annoncée intitulée « A Thousand Miles Along the Eastern Yangtze », inspirée du shanshui chinois, Dwelling in the Fuchun Mountains est un film visionnaire en ce qu’il dynamise le portrait de famille en le réinscrivant formellement, naturellement, dans cette tradition de peintures sur rouleau — de montagnes et de lacs — que l’on reconnaît comme la plus emblématique des iconographies chinoises. Portrait émouvant et immensément juste d’une famille sur quatre saisons, tout le projet de Gu Xiaogang repose sur cette logique de portraiture latérale : une caméra en alternance aérienne et intime, qui capture le lent foisonnement de la vie au fil d’un « rouleau » d’images que l’on observe se dérouler devant nos yeux, de droite à gauche, ou de gauche à droite, telle une réinvention, aussi simple que tétanisante, du plan-séquence autrement ostentatoire. Surtout, cette démarche permet d’inscrire les personnages dans le territoire, pour mieux en dramatiser leurs enjeux et ainsi juxtaposer le micro du caractère familial au macro du « caractère national » ; de même, d’inscrire le portrait d’une ville, Fuyang, aux abords du Yangtze et des monts Fuchun, dans une tradition millénaire de l’histoire de l’art chinois. Gu met également en équation le sort d’un clan — et du clivage générationnel qui se dresse entre les divers frères et cousins — avec le virage capitaliste de la Chine de Xi Jinping ; ses traditions de piété filiale métastasées avec le temps en relations économiques, telle une logique d’investissement, voire de gambling, qui sous-tend les interactions du corps social de même que celui de l’État (État qui cherche, par exemple, à investir le territoire en y construisant de nouveaux logements que les générations subséquentes ne pourront monnayer). Une trouvaille formelle vertigineuse d’ambition qui aplatit donc, en un seul « plan » d’activité infiniment complexe, le récit d’une famille, pour qu’il devienne celui de la vie humaine au 21e siècle : « les mœurs et les coutumes du temps ».
Texte : Ariel Esteban Cayer

SMALL AXE
Steve McQueen | Royaume-Uni | 2020
Le projet avait germé depuis au moins une décennie dans la tête de Steve McQueen, mais le cinéaste anglais aurait difficilement pu imaginer moment plus cathartiquement propice pour le voir enfin prendre forme. 2020, on le saura, n’a pas été une année facile pour personne en raison de la pandémie, mais elle aura aussi été l’année où le mouvement Black Lives Matter aura pris, bien malgré lui, une envergure mondiale. Et même si une portion encore beaucoup trop grande des populations planétaires s’évertue toujours à nier le racisme systémique de nos sociétés, une portion heureusement plus imposante de celles-ci a enfin commencé à comprendre que ce racisme insidieux est malheureusement loin d’être mort et enterré. Bien que rien ni personne n’aurait pu prévoir que la sortie des cinq films formant le corpus Small Axe coïnciderait avec l’irrésistible montée de BLM, il est impossible de regarder ces œuvres en faisant abstraction des événements de 2020 : à leur visionnement, on ne peut ignorer le fait que ces films éblouissants pourtant historiques s’avèrent d’une actualité toujours aussi déchirante. C’est littéralement à en hurler. Mais sans le savoir-faire exceptionnel, l’œil incroyablement précis, l’oreille musicale si parfaitement sensible de McQueen, leur impact n’aurait jamais pu être aussi puissant, peu importe le contexte de leurs sorties. Tous les films ne sont pas égaux, mais, dans son ensemble, Small Axe propose une incroyable plongée d’une redoutable cohérence et d’une remarquable complexité dans la vie des communautés afro-caribéennes du Londres des années 70 et 80. Et McQueen réussit ce tour de force cinq fois plutôt qu’une ! Comment ? En s’intéressant du plus près aux textures et aux couleurs et pratiquement même aux odeurs, au propre comme au figuré — celles des peaux noires dans toutes les nuances imaginables, celles éclatantes des étoffes des vêtements et des intérieurs tapissés, celles mornes des coulisses du pouvoir blanc aveugle ou corrompu, celles des rues de la ville, de la piquante nourriture caribéenne, des steel drums qui résonnent, des voix qui chantent dans la nuit. De Mangrove, aussi percutant qu’enrageant, à Lovers Rock, ode à la sensualité musicale et libératrice de ces communautés, en passant par les magistraux et bouleversants portraits sociopolitiques Red, White and Blue, Alex Wheatle et Education, Small Axe pénètre la tête et le corps non pas tant comme une leçon d’Histoire trop longtemps négligée, mais plutôt comme un incontournable et juste retour à l’avant-plan de la multitude d’histoires occultées de ces communautés.
Texte : Claire Valade

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
Céline Sciamma | France | 2019
Il faudra voir ou revoir le dernier film de Céline Sciamma en deçà ou en dehors de la polémique dont il fut l’objet, polémique qui le charge d’un voile potentiellement inhibiteur. Car Portrait de la jeune fille en feu est, avant d’être le film du scandale des César 2020, une véritable œuvre où c’est la notion même d’œuvre qui est interrogée et distillée au prisme de la relation qu’entretient le cinéma avec la peinture, mais de façon plus resserrée, de ce que la relation entre muse et créateur, ici créatrice, offre de plus sensible. Campé dans un dix-huitième siècle dont le néoclassicisme affectif contrecarre subtilement les attentes outrancièrement romantiques qui sont les nôtres, modernes têtus, Portrait… renoue avec le grand cinéma de la mise en scène et l’on aura tôt fait de penser à La belle noiseuse (1991) de Jacques Rivette. Le style est autre, bien entendu, mais l’exigence est la même, portée par la question par excellence qui est celle du regard, telle qu’elle ne se laisse pas réduire au concept possiblement plaqué de gaze issu des Cultural Studies, mais telle qu’elle s’ouvre plutôt à la richesse de ce que le cinéma est à même de lui apporter, en ce que précisément, il permet de poser ce regard comme quelque chose qui soit partagé, épluché, sublimé.

Si le film nous fait tant de bien, c’est que le monde d’aujourd’hui fait trop mal, dans sa laideur obscène, et que nous chérissons toute occasion d’imaginer une existence plus simple, plus paisible, mais surtout plus concrète. Voici exactement ce que nous propose Reichardt, usant pour son film d’un format 1,37:1 qui respire admirablement (grâce à l’infinité sauvage du hors-champ), et constitue à ce titre l’antithèse du cadre restreint d’un Mommy (2014), qui, lui, servait à incarner le caractère suffocant de la demeure banlieusarde. L’œuvre de Reichardt, d’une langueur cathartique, permet surtout au spectateur de retrouver son lien perdu, pas seulement avec la nature, son berceau méprisé, mais avec la vie terrestre dans tous ses paramètres les plus immédiats. Le déroulement naturel du temps pour commencer, exemplifié par des plans d’une longueur salutaire, qui servent d’antidote à la fragmentation médiatique violente qui le menace de plus en plus chaque jour.
L’œuvre s’affaire surtout à la restitution du rapport direct entre les hommes et les fruits de la terre, à laquelle tous ses éléments contribuent. Le travail sonore minutieux est précieux à cet égard puisqu’il permet d’établir une relation sensuelle entre chaque être diégétique, entre les champignons et le protagoniste par exemple, qui les cueille et les croque d’une manière infiniment aguichante. Même les instruments utilisés sur la bande sonore sont tous matériels, des guitares surtout, faits de matériaux prosaïques, de même que les cabanes où vivent les personnages, la monnaie qu’ils utilisent et les outils dont ils se servent pour cuisiner. Le film, en mettant aussi l’emphase sur les ingrédients qui entrent dans la composition des pâtisseries que confectionne le protagoniste (le lait des beignes, les bleuets du clafoutis), ravive surtout la relation la plus sournoisement abstraite par le capitalisme, soit celle entre le consommateur et la source première de ses produits, le matériau primaire (la vache, les baies, le bois), dont il laisse aujourd’hui l’exploitation et la transformation aux bons soins d’individus sans scrupules qui n’ont cure de leur pérennité. First Cow est en cela la chronique nostalgique d’un écosystème décédé, vaincu par les industrialistes et les banquiers dans le sillon des Lumières.
L’accélération a désormais fait dérailler le train, qui poursuit sa course vers le vide avec à bord des milliards de passagers insouciants ou inféodés, dont les corps disciplinés se retrouvent partout dans les films de notre palmarès. La pandémie ayant aujourd’hui confirmé la faiblesse de notre système social, qui ne tient à rien sauf le contrôle constant et l’aliénation de ces corps, notre sélection donne aussi à voir de ces façons de repenser le monde, en réaffirmant l’importance de la communauté, du rapport au temps, à la terre et à l’autosuffisance, remède ultime contre les maux du capitalisme. S’il importe cette année aux Indiens de massacrer les cowboys, à la poétesse de conter le fleuve et au prolétariat d’abolir la sédentarité, il importe surtout à la vache de quitter l’enclos et aux gens de travailler ensemble, question d’imaginer une forme de subsistance primaire, faite de miel, d’écureuils et d’amitié.
Texte : Olivier Thibodeau
| Présentation | 30-21 | 20-11 | 10-1 | Palmarès individuels |
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
