
Pour une troisième année consécutive, Panorama-cinéma célèbre l'Halloween en se livrant à l’exercice infernal qu’est de produire une liste de films. Pour suivre la tendance que nous avions amorcée depuis nos premières sélections, nous vous proposons de sortir des sentiers battus en nous penchant sur quelques (re)découvertes moins évidentes ou des classiques approchés d’un angle inhabituel ou personnel. Aboutissant sur une liste aussi variée qu'intime, les suggestions offertes représentent la diversité cinéphile de la revue qui vous offre... Encore treize films pour l'Halloween.

THE CREMATOR
Juraj Herz | Tchécoslovaquie | 1969 | 100 minutes
Si l’on jouait trop strictement le jeu de la catégorisation, on hésiterait sans doute à inscrire The Cremator (L’Incinérateur de cadavres) dans le genre horrifique. On lui reprocherait les relents comiques qui embaument sa satire politique ou l’importance qu’il accorde à la psychologie au détriment du surnaturel, mais on négligerait ce faisant le potentiel d’évocation de l’une des expériences cinématographiques les plus poignantes, morbides et oppressantes de tous les temps. On se priverait, en cette période bénie de tarentelle thanatologique, d’une métaphysique impressionniste de la crémation à l’aube de la Solution finale, mais surtout d’une expérience immersive de la folie meurtrière telle qu’on l’a rarement vue à l’écran, fruit d’un travail éditorial digne des plus célèbres artisans de l’art du montage, soviétique et français, mais svankmajérien également, dont l’héritage commun s’incarne dans la valse lancinante qu’effectuent Éros et Thanatos au cœur de la Tchécoslovaquie assiégée de la fin 1930.
Narrativement, le film s’intéresse à la déliquescence psychologique et l’endoctrinement nazi du personnage titulaire, praticien enthousiaste de l’art crématoire, dont les connotations historiques funestes infectent tranquillement la diégèse jusqu’à leur expression flamboyante sur fond d’icônes boschesques. Il dresse ainsi par la bande un portrait d’époque cruel et perspicace, accusant ferme l’empressement des Tchèques d’origine allemande à se ranger du côté hitlérien après l’envahissement de la Bohême, situant le spectateur dans un entre-deux étrange, à mi-chemin entre le Prague bourgeois d’alors et l’esprit enfiévré du protagoniste, dont la mise en scène, incroyablement imaginative et fluide, s’efforce de démontrer les mécanismes opératoires. Chaque séquence est ainsi dotée d’un impressionnant potentiel expressif, exacerbé par le recours à une photographie noir et blanc archi-contrastée et l’usage savant de gros plans, allusifs ou asymétriques, qui servent d’interjections brutales à la narration chronologique des événements. C’est un film impressionniste en somme, que signe Herz, en faisant le pari de traduire les propensions fascistes d’une société tout entière via l’introspection d’un seul esprit, susceptible, arriviste et lubrique, obsédé par les blonds pubis des prostituées allemandes.
Ici, même les événements les plus anodins (visite du zoo ou de la fête foraine) sont l’occasion des montages les plus extravagants, ponctués de ruptures spatiales et temporelles constantes, ainsi que d’une multiplication fongique des raccords allégoriques. On reste donc campés presque exclusivement dans le monde des idées, même lors des scènes d’exposition banales comme la scène d’ouverture, où la caméra s’attarde aux caractéristiques funèbres des personnages (dents noires, yeux noirs, cheveux noirs, habits noirs dans une économie narrative du noir) plutôt que de se contenter de la description des faits pourvue par la voix anesthésiante et omniprésente du protagoniste, outil impressionniste lui aussi, à l’instar de la musique classique et des cantiques qui nous bercent à travers les méandres sordides de la pensée proto-fasciste redevenue depuis l'air du temps. (Olivier Thibodeau)




NEXT OF KIN
Tony Williams | Australie | 1982 | 89 minutes
Après avoir souffert d’une distribution quasi inexistante en dehors de son pays outre une VHS sortie sur le tard en Amérique du nord, Next of Kin a tout récemment eu droit au travail de restauration qu’il méritait afin d’être enfin redécouvert. Sortant de la nouvelle vague australienne et flirtant avec le sous-genre de la ozploitation, Next of Kin n’est pas non plus évident à catégoriser tant il ne s’ancre pas totalement dans ces mouvances. Il démontre plutôt des influences évidentes du cinéma d’horreur européen, tant par sa construction et son style très proches du giallo, que par l’aspect gothique de son lieu et de son récit. Alors que suite au décès de sa mère, une femme retourne au vieux manoir utilisé comme centre de repos pour personnes âgées dont elle vient d’hériter, elle y retrouve son passé, le personnel qui y travaille, les habitants qui y demeurent... Ainsi que les phénomènes étranges qui semblent s’y dérouler.
Malgré un récit plutôt conventionnel, c’est par sa façon de le mettre en scène que le film de Tony Williams se démarque grandement, grâce à la force stylistique et l’atmosphère onirique qui s’en dégage. Williams a su composer un rythme qui se développe lentement, introduisant les moments de choc comme des ruptures douces, presque fantasmées, s’inscrivant naturellement dans le quotidien, à l'usure. Ces moments sont déclenchés entre autres par une utilisation intelligente des ralentis, peuplant la réalité immanente de visions cauchemardesques, en grande partie aussi grâce à la force d'un travail visuel qui épate à coup de mouvements maîtrisés, d'une aisance de la caméra qui se déplace dans tous les recoins d'un lieu qui n’en devient que plus énigmatique. Ces jeux de caméra stylisés s’ajoutent à d’autres caractéristiques qui rapprochent le film du giallo (et particulièrement des premiers films de Dario Argento), telle son utilisation des couleurs, ses compositions et l’enquête personnelle menée par sa protagoniste, déroutant par la même occasion la stabilité de la réalité qui l’entoure autant que sa propre stabilité psychologique.
Autre grand apport au film, la trame sonore électronique de Klaus Schulze (ex-membre de Tangerine Dream) qui ajoute à son atmosphère déstabilisante et onirique. S’appuyant plus sur la création d’ambiance et la déroute que sur la logique narrative, Next of Kin vient enfin à surprendre par son dernier acte, qui fait éclater ce qu’il a construit durant sa première heure pour nous catapulter dans une direction inattendue, à l’image de la protagoniste qui construit lentement un château de cubes de sucre avant de le voir s’effondrer brutalement dans une scène qui démontre en somme l’exercice du film. (David Fortin)




THE WITCHES
Nicolas Roeg | Royaume-Uni | 1990 | 92 minutes
Le film s’ouvre sur une grand-mère qui raconte à son petit-fils une histoire de son enfance, celle du sort terrible réservé à son amie Erika enlevée par une sorcière, puis enfermée par celle-ci à vie dans une peinture. Tel qu’illustré par Nicolas Roeg, le récit de la grand-mère puise à même les deux côtés du monde du conte et du folklore : la peur et le merveilleux. Il installe ainsi d’emblée le climat inquiétant et effrayant qui planera sur le film, tout en restant fermement ancré dans la fantaisie et la féérie. L’humour plutôt noir de Roeg rejoint de façon idéale celui de Roald Dahl, à qui l’on doit la version originale de ce conte drôle et méchant mettant en scène le combat d’un jeune héros transformé en souris contre une délirante Grandissime Sorcière et sa horde de sorcières sanguinaires dans leur croisade pour éliminer tous les enfants d’Angleterre. C’est avec délectation qu’on découvre une Angelica Huston complètement débridée incarnant cette Grandissime avec un sens jouissif de l’excès ostentatoire. Quant à la légendaire Mai Zetterling, elle apparaît réconfortante en grand-maman gâteau, mais demeure drapée de mystère par ses connaissances d’une mythologie immémoriale. Roeg, lui, s’amuse à accentuer dans ses moindres choix de réalisation et de mise en scène l’aspect horrifique du conte de Dahl : les couleurs vives et contrastées, les crânes dégarnis et pustuleux des démones, le terrifiant masque de chair de la Grandissime Sorcière, les angles de caméra tordus, les très gros plans déformants, la composition chaotique des images, le ridicule condescendant du directeur d’hôtel, le snobisme à vomir des Jenkins, la fumée d’un vert malade et nauséabond des métamorphoses en souris, etc. Si on avait pu se demander au départ ce que Nicolas Roeg, le controversé et sulfureux cinéaste de Don’t Look Now (1973) et Bad Timing (1980), pouvait bien faire aux rênes d’un film pour enfants, il faut bien se rendre à l’évidence : la rencontre Roeg-Dahl est un mariage parfait. Qui mieux, en effet, que Roeg le non-conformiste, avec son style visuel saisissant, pour emmener les enfants sur les chemins d’un genre qui leur est si peu souvent réservé, soit celui du cinéma d’horreur, par l’entremise d’un écrivain qui sait parfaitement doser l’effrayant à hauteur de bambin ? (Claire Valade)




A NIGHTMARE ON ELM STREET 3 : THE DREAM WARRIORS
Chuck Russell | États-Unis | 1987 | 96 minutes
Je ne saurais dire quel âge j’avais lorsque je vis pour la première fois le troisième volet d’A Nightmare on Elm Street, sans trop savoir encore qui était Freddy Krueger. Mais je me rappelle ma terreur lors de la scène de la marionnette, lorsque Freddy s’empare d’un adolescent, lui ouvre les bras et les jambes pour en extirper les veines, et les utilise pour manipuler sa proie, la faisant marcher tel un pantin à cordes jusqu’à la précipiter vers sa mort. Je n’arrive pas à me souvenir si j’osai poursuivre mon visionnement, ou si j’allai me réfugier dans les bras d’une insomnie, mais cette scène m’a hanté pendant longtemps, comme Freddy en général, que j’ai toujours trouvé particulièrement terrifiant dans son concept.
Dream Warriors exploite cette terreur mieux que tous les autres films de la série (l’original y compris), en mettant en scène des adolescents suicidaires, incompris, délaissés par leurs parents, résidant dans un service de psychiatrie. Ces personnages n’ont déjà rien, ils sont déjà vulnérables, et les voilà assaillis jusque dans leurs rêves, d’ordinaire le seul moment de repos face au monde qui les rejette. L’image de la marionnette humaine me terrifiait, mais je n’ai jamais réellement compris pourquoi (au-delà du gore) avant de revoir le film des années plus tard, adulte : comment mieux exprimer le terrible sentiment d’impuissance de ces personnages, leur impression d’être invisible aux yeux des adultes (quand il est manipulé par Freddy dans son rêve, l’ado passe devant les infirmiers dans le réel, qui ne le voient pas avancer jusque vers une fenêtre ouverte sur le vide), ou comment mieux traduire ce que peuvent être les idées suicidaires, une sorte de monstre résidant en soi, que nous ne savons trop comment combattre, comment y échapper, et qui nous pousse vers l’inéluctable, malgré notre terreur face à la mort ? Bien plus que le grotesque sanguinolent, c’est ce qui effraie dans cette image, la détresse totale qui la soutient, l’horreur familière qu’elle traduit (plus familière, du moins, que celle engendrée par un démon sardonique).
Tout le film est particulièrement abouti, autant dans son allégorie sur le suicide (pour vaincre Freddy, les ados doivent être solidaires et faire appel à leur force intérieure pour retourner leurs faiblesses en puissance) que dans l’esthétique, la logique du cauchemar étant mise en scène avec une folle inventivité. Avec en plus la musique d’Angelo Badalamenti, les noms de Wes Craven et de Frank Darabont au scénario, des rôles pour Patricia Arquette, Laurence Fishburne et John Saxon, et avec le retour de Nancy, la final girl de l’original, Dream Warriors demeure l’un des plus surprenants films de la franchise, et sans doute le seul qui m’effraie tout en me laissant étrangement ému. (Sylvain Lavallée)




Un épisode de TWILIGHT ZONE : « Night Call »
Jacques Tourneur | États-Unis | 1964 | 25 minutes
Il y a généralement beaucoup à apprendre des derniers films, des derniers tours de piste de ces auteurs vieillissants à qui l’on demande pour une dernière fois de faire ce qui les a fait ; quelque chose comme une dernière pensée, un dernier repas, faisant de ces cinéastes approchant la mort (d’une carrière à tout le moins) un thème on ne peut plus digne de l’Halloween.
Dans le cas de Jacques Tourneur, ce « dernier film » (qui n’est pas le dernier des derniers mais plutôt son dernier film d’horreur) prend les allures d’un épisode assez discret de la cinquième saison de Twilight Zone, « Night Call », une histoire en 24 minutes bien serrées, scénarisées par le grand Richard Matheson (The Incredible Shrinking Man [1957], Pit and the Pendulum [1961] ou The Last Man on Earth [1964]) et mises en scène avec cet inimitable sens de l’espace qui fait de Tourneur un des cinéastes les plus sous-estimés de l’âge d’or des studios.
On y retrouve donc une femme âgée, seule, à peu près isolée du monde, incarnée avec une détresse qui déborde des yeux de Gladys Cooper, ancienne starlette des planches et des écrans britanniques des années 1910 et 1920 et qui connaîtra un second souffle dans d’innombrables rôles de marâtre pincée (du Rebecca [1940] d’Hitchcock au My Fair Lady [1964] de Cukor), Gladys Cooper donc, dont le visage ridé est déjà un cimetière de rôles, a peur au bout de son combiné noir, répondant à chaque sonnerie, à toute heure de la nuit, subissant les hantises d'un esprit qui syntonise, n’ayant comme secours possible que l’arrivée au matin des préposés et comme intervention que celle de la standardiste qui n’en croit pas ses oreilles téléphoniques. Rien de compliqué : du hors-champ instigué par l’appareil, un jeu de béances qui se remplissent progressivement, une voix lointaine qui s’installe dans le grésillement du silence, une héroïne comme Tourneur en a si souvent représentée lors de ces marches nocturnes dont il avait le secret (Tourneur, avec Mikio Naruse, a capté les plus belles marches du cinéma) et qui se retrouve ici pour la première fois alitée, immobilisée par la vieillesse, une « vieille » filmée par un « vieux », du cinéma gériatrique peut-être, qui fait encore plus peur aujourd’hui à l’ère pandémique qu’en 1964 à l’heure atomique, mais du cinéma tout de même, même à la télévision, du cinéma de maître qui épate au seuil de sa fin, pas tant dans la sagesse d’une épure que par son sens frappant de la mesure, de ce qu’il faut d’expression pour marquer une image. La leçon apparaît comme la suite de celle de Cat People (1942), qui professait la peur par la noirceur du hors-champ. Une carrière et des douzaines de merveilleuses séries B plus tard, Tourneur revient à sa première Idée avec sa dernière : la noirceur du hors-champ visuel n’est pas aussi terrifiante que l’abstraction d’un hors-champ sonore, que la communication aérienne des esprits au temps des téléviseurs et des ondes (Kiyoshi Kurosawa confirmera), que la plongée stricte dans cette ligne téléphonique qui ne connaît pas de fond, pas de passage au jour, qui n’ouvre que sur la terreur individuelle qui concerne celle au bout du fil, une terreur jamais montrée, fondée dans l’amour de la caméra pour le seul visage de Gladys Cooper, allégorie des regrets dont on se laisse posséder, ceux qui rampent le jour pour nous réveiller dans la nuit. (Mathieu Li-Goyette)




« The Raft » dans CREEPSHOW 2
Michael Gornick | États-Unis | 1987 | 92 minutes
Alors que la première mouture de Creepshow assume pleinement l’influence de EC comics, sa suite rejette curieusement cet héritage. Elle délaisse l’esthétique bédéesque du film de Romero pour se contraindre dans un régime réaliste plus sage. Ne reste de l’original qu’une poignée de séquences animées unissant les trois sketches. Le résultat déçoit. Il s’agit d’ailleurs de l’unique long métrage réalisé par Michael Gornik, plus louable en tant que directeur de la photographie des grands Romero, de Martin (1977) à Day of the Dead (1985).
Un récit se démarque néanmoins du lot. Adolescent, il avait suscité en moi un profond malaise. Je me croyais, à l’époque, capable d’en prendre. Peu de films d’horreur réussissaient à m’impressionner. C’est avec fierté que je relevais le défi qu’ils m’imposaient, les visionnant jusqu’au bout sans nécessiter de veilleuse. S’ouvrant avec un segment bébête digne d’Are You Afraid of the Dark ?, l’anthologie Creepshow 2 me semblait plutôt inoffensive. Un petit moment de rigolade conçu pour vaincre l’ennui du vendredi soir. Qu’est-ce que je pouvais être naïf ! Le film, en vérité, prenait l’apparence d’une plaisanterie ringarde pour me tendre un piège. Surgit alors sa seconde offrande, ce conte horrifique qui m’a pris au dépourvu.
« The Raft » suit le cauchemar de quatre ados prisonniers d’une minuscule plateforme de bois sur un lac tranquille. Quelques mètres les séparent de la berge, mais ils ne peuvent l’atteindre à cause d’un curieux prédateur. Une sorte de masse noire gloutonne, probablement un cousin aquatique du Blob, les guette en encerclant le radeau. N’ayant aucune échappatoire, les quatre amis sont condamnés à attendre une mort certaine.
Plusieurs années m’ont été nécessaires pour saisir l’impact de ce film sur mon esprit juvénile. L’efficacité de « The Raft » découle d’abord de son indéniable crédibilité. Sa prémisse appartient à cette rare catégorie de récits surnaturels auxquels on adhère naturellement, sans contester leur véracité. Comme exemples, pensons à la vidéocassette maudite de Ringu ou encore à l’inoubliable scène du téléphone dans Lost Highway. Des histoires d’épouvante qui, en s’ancrant dans notre quotidien, se rapprochent de la légende urbaine.
Il est également possible que « The Raft » éveille certains traumas en s’inspirant d’images réelles. Ce plan d’une femme hurlante recouverte d’une boue noire n’est pas sans rappeler celle d’un goéland sous le pétrole qui a tant circulé durant la Guerre du Golfe. Deux visions pétrifiantes — c’est le bon mot — qui expriment l’angoisse de l’étouffement liée à la perte du contrôle de soi. En bon petit universitaire, je sais bien qu’il faut être prudent avec ce type d’analogie. Elle me paraît néanmoins juste, ne serait-ce parce qu’elle renvoie au thème central de cette adaptation de Stephen King. Diabolique, ce sketch synthétise en vingt minutes une perte irrationnelle d’espoir, ce moment où l’on s’abandonne à la fatalité du monde en se résignant à n’être plus qu’un corps au soleil.
Certains souvenirs sont indélébiles. Pour le besoin de ce texte, je n’ai pas revu « The Raft ». J’aurais pu le faire sans problème, il se trouve aisément sur YouTube. Je n’en étais tout simplement pas capable. (Simon Laperriere)




SEASON OF THE WITCH
George A. Romero | États-Unis | 1972 | 89 minutes
Parmi les films les moins souvent cités de Romero, The Season of the Witch a eu une drôle de vie. Initialement intitulé Jack’s Wife par le cinéaste, il porte pour titre à sa sortie sur grand écran Hungry Wifes, remanié par un distributeur qui voit en lui une potentielle production pornographique soft. Ce n’est que dans les années 80 que le titre du film se stabilise en The Season of the Witch, d’après la chanson de Donovan qui accompagne l’une de ses scènes, lors des rééditions faisant suite au succès de Dawn of the Dead (1978). C’est donc dire qu’avant d’être un film d’Halloween — ou du moins Criterion l’a-t-il inclus dans ses classiques de l’horreur des années 70 —, The Season of the Witch en fut un de Saint-Valentin, destiné à sortir un 14 février, et que ses obliques flirts avec quelques thèmes et façons de faire de l’horreur furent sans nul doute perçus comme une possibilité de pimenter les sensations de l’auditoire, à l’issue du désir féminin qu’il met en scène. Pourquoi dès lors l’inclure dans ce petit répertoire thématique ?
On a déjà rendu hommage au féminisme franc de The Season of the Witch, lequel raconte l’histoire d’une femme au foyer, incarnée par l’inhabituelle et attrayante Jan White. Muselée dans une vie où elle se sent à l’étroit, avec un mari peu présent, sinon paternaliste à souhait, cette banlieusarde assommée par sa vie se montre néanmoins à l'écoute de sa petite voix intérieure qui, pas à pas, la guide vers l'aventure émancipatrice et sexuelle de la sorcellerie. Si cette ligne narrative peut sembler intéressante, quoique tout à fait classique, j’aimerais plutôt pour ma part souligner la façon dont Romero sait mettre en scène ses sujets. D’une part, disons-le encore, les corps chez lui ne sont jamais atones : ils respirent, étouffent, vivent, giclent, meurent et revivent, rêvent, hallucinent, fument, se consument, bref s’éprouvent eux-mêmes en tant que poreux à leur environnement, capables non seulement de se contaminer entre eux, mais de couler leur charge dans le corps du spectateur. D’autre part, c’est une façon de situer, d’entourer et d’inscrire les corps dans l’espace qui parvient à saisir une double dimension de vie, intérieure et environnementale, et charrie de la sorte du frisson, de l’effroi, du suspense, du désir, de l’attrait. Cela est absolument patent et précis dans The Season of the Witch où, de la maison en banlieue aux rêves et hallucinations de la protagoniste, c’est toute une intelligence de l’espace qui s’orchestre, épluchant et liant le réel, le mental, l’onirique, l’hallucinatoire, le fantasmé, en partant du corps (féminin). Parallèlement à une façon de se positionner — caméras objectives et subjectives, toujours de près —, de montrer de manière récurrente les objets (figurines, statuettes, rideaux) ou par exemple d’ouvrir la porte et de faire tourner les têtes en direction de la caméra, ce sont, ce faisant ou en même temps, de virtuoses opérations du montage qui infligent à l’espace et ses corps une pulsation qui s’active en décharges ponctuelles. Cet art du montage secoue pour ainsi dire tout sur son passage. Faisant sauter la successivité platement logique des images, il crée, de par ses ruptures rythmiques et raccords déstabilisants, des sensations tantôt soudaines et courtes — ces petits chocs assénés aux nerfs —, tantôt longues et réflexives — ces résonances qui imprègnent l’esprit —. Il me semble aussi que l’on pourrait parler d’une qualité chorégraphique de l’écriture chez Romero, laquelle révèle toute la portée sociale, physique, énergique des êtres et génère une efficace corporelle hors-norme en phase avec une pragmatique de l’horreur, même lorsque le film sort du genre. (Maude Trottier)




BLOOD BEACH
Jeffrey Bloom | États-Unis | 1980 | 92 minutes
Bruxelles, le 6 mars 2020. Nous allons être confinés dans quelques jours, mais nous n’en savons toujours rien. Le festival Offscreen, sorte de Fantasia local, bat son plein et aujourd’hui, c’est la soirée thématique « Beach Horror », où l'on offre une vraie programmation, formellement éclectique (complétée par The Horror of Party Beach [1964] et Shock Waves [1977] sous-titré en Québécois), avec un bar tiki en bonus et un dude coiffé d’un chapeau de paille vintage venu présenter des collections de bandes-annonces délirantes à la façon DJ XL5. À 23h30, c’est Blood Beach, sur support 35mm grafigné avec son cacanne. Un de mes coups de cœur du festival, un de ces rares vrais « bons mauvais films », comme Halloween III (1982) ou Samurai Cop (1991). Un mauvais film qui prend presque des airs de bon film avec ses dialogues savoureux, à mi-chemin entre le camp et la poésie lyrique et ses effets magnifiques de succion monstrueuse.
Inutile de le mentionner, les plans subjectifs à ras le sable sous le quai de Venice Beach le confirme d’emblée, mais Blood Beach est une contrefaçon grossière de Jaws (1975), produite par Run Run Shaw (rien de moins), où le monstre recule de quelques mètres vers l’intérieur des terres afin de menacer non seulement les baigneurs hardis, mais tous les vacanciers réunis sous le soleil, un monstre qui happe les jambes de ses victimes et les aspire vers son repaire troglodyte où il collectionne des parties sectionnées de leurs corps. C’est ce que confirme d’ailleurs le slogan du film, chipé sans gêne à Jaws 2 (1978) : « Just when you thought it was safe to go in the water… you can’t get to it », livré à l’écran avec un flegme glorieux par un John Saxon en très grande forme. Parce que c’est ça aussi, le film de Bloom, au-delà de ses amusants effets pratiques et du design impeccable de sa créature, aperçue trop brièvement malheureusement puisque dynamitée avec empressement par le personnage de Burt Young : c’est une distribution de série B qui travaille vraiment, vraiment fort pour accoter les prouesses de Schneider, Shaw et Dreyfuss avec, en bouche, des mots dont on s’étonne qu’ils puissent les débiter sans jamais s’esclaffer. Young est fidèle à lui-même en vieux grincheux caractériel et cynique, un flic de Chicago dans les bas-fonds de la Californie, mais c’est vraiment Saxon qui décroche la Palme en tant que chef de police, grâce à une poignée de scènes mémorables où il débite sans broncher des monologues jubilatoires, mi-satyriques, mi-solennels, avec toute la fougue d’un Clint Eastwood de seconde catégorie. Son florilège de jurons à l’endroit des politiciens locaux nous fait presque mouiller nos sous-vêtements…
En somme, Blood Beach a beau être un clone de Jaws, il exhibe de trop nombreuses protubérances délectables pour qu’on s’en passe : les envolées lyriques de personnages survitaminés, incluant le jargon jouissif du médecin légiste, aussi pratique, selon le personnage Saxon, que « des moustaches sur une saucisse », une poignée de scènes d’anthologie méconnues (la description vestimentaire d’une des victimes justifie presque à elle seule le visionnage du film), ainsi qu’un bien beau monstre d’allure végétale, la bite tranchée d’un violeur puni poétiquement et la perche, cette fameuse perche qui s’immisce trop souvent dans le haut du cadre, et dont on voudra peut-être ponctuer chacune des apparitions d’une bonne gorgée de bière à la citrouille ! (Olivier Thibodeau)

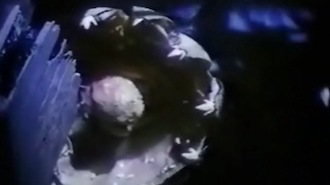


THE SEPARATION
Robert Morgan | Royaume-Uni | 2003 | 10 minutes
C’est en 2003 que j'ai découvert Robert Morgan, alors qu'il se bâtissait déjà une petite réputation dans le monde de l'animation et que je visionnai pour la première fois un de ses meilleurs film, The Separation. En parcourant un épisode halloweenesque de la défunte émission de CBC, Zed, je découvris le court métrage qui était alors présenté aux côté d’autres courts qui collaient bien à l’ambiance terrifiante propre à tout mois d'octobre. La découverte fut un choc et m’a amené à suivre les productions de Morgan, souvent accomplies dans l'indépendance, comme son déjanté et jouissif Bobby Yeah (2011). Quant à The Separation, il dresse un portrait de frères siamois qu’on suit à travers trois moments importants de leur vie, avec à mi-parcours leur séparation chirurgicale et les effets dévastateurs qu'elle aura sur leur corps et leur psychée. Aussi dérangeant que déchirant, le film de Morgan exploite parfaitement l’aspect inquiétant et mécanique que peut procurer la technique du stop motion, soulignant cet aspect de plus belle en plaçant ses protagonistes dans une fabrique de poupées, entourés des morceaux servant à leur fabrication autant qu’aux machines servant à les assembler. La photographie sombre et l’éclairage stylisé viennent contraster avec les visages déchirés des personnages, révélant déjà la signature du cinéaste, avec ses visages et ses corps texturés, au rendu presque malade, leur donnant un aspect organique, hachuré, auquel contribue un travail sonore aux vombrissements industriels qui en ajoute une couche à l’angoisse ambiante. Rappelant parfois le travail des frères Quay dans son esthétique, The Separation démontre aussi un souci du travail des corps qui le rapproche de l'horreur corporelle, notamment de certaines oeuvres cousines comme celles de Cronenberg (Dead Ringers, 1988) ou de Lynch (Eraserhead, 1977). Sombre, grotesque et mélancolique, The Separation est aussi chargé en émotions, malgré tout le drame et la tragédie qui étouffent son atmosphère dérangeante et de laquelle parvient parfois à s'échapper le filet d'une odeur de fleur. (David Fortin)




PULSE
Kyoshi Kurosawa | Japon | 2001 | 119 minutes
Pulse aurait pu être sévèrement limité par son époque, avec son sentiment d’horreur branché sur les angoisses du moment, sur l’inquiétude face à l’essor soudain d’Internet, présenté comme une technologie nous permettant de communiquer avec une masse anonyme, des fantômes vivant à l’autre bout du câble optique. Nous connaissons bien ce discours, sur les écrans qui nous isolent du monde, qui nous promettent une forme de communauté alors qu’en réalité ils ne peuvent pas nous offrir plus que des contacts virtuels, éphémères, lointains, et qui renforcent au final cet isolement dont ils semblent nous extirper. Mais Pulse évoque ce discours pour montrer qu’il s’agit d’une sorte d’épouvantail, comme si nous accusions la technologie de créer une bien bête et banale solitude, que l’on pourrait facilement chasser en reprenant contact avec le « vrai » monde, ce qui nous permet de nous cacher d’un autre sentiment, la terreur existentielle devant notre solitude métaphysique, un isolement dont ne nous pouvons pas sortir puisqu’il fonde notre condition humaine.
En abattant cet épouvantail, Kurosawa nous laisse donc devant l’idée que nous sommes déjà en voie de devenir des fantômes, flottant dans le monde sans attache, effroyablement seuls. Même la mort n’offre aucun repos, car comme le craint un personnage, dans l’au-delà rien ne change; nulle rupture dans la mort, mais l’aboutissement logique de notre condition, non pas la fatalité du néant mais celle de notre présent de solitude, qui se perpétue pour l’éternité. Les fantômes se déversent dans notre réalité depuis un au-delà trop plein, et peu à peu notre monde se vide, il ne reste que des ombres sur les murs, s’effritant en cendres, une image foudroyante évoquant l’horreur de la bombe atomique, s’infiltrant dorénavant par les réseaux sociaux. Empli de telles images angoissantes, avec des fantômes s’avançant lentement, comme le sentiment d’une mort inévitable, des danses macabres au ralenti, des taches inquiétantes captées par des caméras lo-fi et des suicides filmés avec une force viscérale, avec son atmosphère troublante, menaçante, mais aussi mélancolique, Pulse nous laisse moins sur la peur que sur un sentiment de détresse morale. Certes, les vieilles disquettes et le son des modems téléphoniques tentant de se brancher sur les réseaux trahissent cette époque pas si lointaine, mais si nous voyons au-delà de l’apparence de cette technologie, de la forme qu’elle prenait en 2001, ce film reste l’une des plus saisissantes visions de notre modernité, et du devenir-fantôme qu’elle nous promet. (Sylvain Lavallée)




BRIMSTONE AND TREACLE
Richard Loncraine | Royaume-Uni | 1982 | 87 minutes
C’est l’heure des aveux. Adolescente, comme toute bonne jeune fille de mon époque, je découvrais la musique de The Police et, forcément, je craquais pour Sting. Au début des années 80, alors que celui-ci se lançait dans une carrière d’acteur, je m’étais juré de voir tous ses films. C’est ainsi que je suis tombée sur Brimstone and Treacle. Mais si c’est bien Sting qui m’a amenée vers le film, le film, lui, m’a donné bien plus qu’une occasion de reluquer mon idole de l’époque dans toute sa splendeur : il m’a fait découvrir le génie du scénariste anglais Dennis Potter. Si ce dernier est, depuis, surtout connu pour son chef-d’œuvre, The Singing Detective, qui entremêle drame, rêve et comédie musicale, Brimstone and Treacle demeure emblématique de son doigté dans l’écriture et du raffinement de son esprit tordu. Sans donner dans l’horreur à proprement parler, mais plutôt dans l’effroi psychologique, le film s’intéresse aux malheurs d’une famille déjà dysfonctionnelle lorsqu’un esprit malin y pénètre et en manipule les membres avec une malveillance jouissive et inquiétante. Un père hypocrite et faible, une mère dévote et crédule, une jeune femme catatonique et vulnérable, voilà le terrain de jeu idéal pour le fauteur de trouble parfait imaginé par Potter, aussi séduisant que dérangeant, aussi sinistre que galant, aussi calculateur que vicieux. Ce pourrait-il qu’il s’agisse du diable en personne ? Qui sait ? La scène finale de viol, véritable catharsis de perversion, alors que l’acte abject libère enfin la jeune femme de sa catatonie et fait exploser la famille et ses secrets, apparaît comme un triomphe de malaise et de dégoût entremêlé de volupté coupable et de félicité enfin affranchie. Entre les mains du maître Potter, cette troublante fable d’épouvante gothique embrasse un humour noir jubilatoire pour jouer avec les thèmes du Mal et de la perversité, et offrir un commentaire aussi percutant que divertissant sur la religion, la dévotion aveugle, le désir effréné et l’innocence menacée. Quant à Sting, il n’aurait plus jamais l’occasion de montrer la mesure de ses talents dramatiques dans un rôle aussi fort et aussi parfaitement moulé pour lui que celui de cet ange maléfique. (Claire Valade)




Le montage dans TEXAS CHAIN SAW MASSACRE
Tobe Hooper | États-Unis | 1974 | 90 minutes
The Texas Chain Saw Massacre est peut-être le plus cinématographiquement effrayant film d’horreur qui soit. Pas de théâtre de l’hors-champ, pas de littérature des lieux, pas de sculpture des corps sinon celle des vrais os qui décorent le cadre, pas de mascarade même si on y voit le plus terrible des masques, le premier film de Tobe Hooper est un film cinglé, un chef-d’œuvre macabre, d’abord et surtout par son montage, la vélocité qu’il sous-tend, l’espoir qu’il nous refuse. Son impitoyable succession d’images soumet l’ensemble de l’attirail du film à une cruauté qui pousse à l’extrême les rêves kinétiques des monteurs soviétiques ; canalisant l’énergie des performances, leur ton, leur intensité plutôt que leur jeu, le rythme des coupes se fait au gré d’une odeur de peur que le film renifle sur nous, à notre insu, plantant dès ses premières intermittences de plans cadavériques l’appréhension du déchaînement à venir : les vrombissements de la tronçonneuse lumineuse de Hooper, de son moteur au réveil.
Le court piétage du film en lui-même est effrayant. 83 minutes. Qu’est-ce qu’il s’en passera des choses en 83 minutes. Sans arrêt. Pas même l’arrêt au bord d’une route pour se relâcher n’est une pause. Le montage donne des coups de lame dans sa première scène, il charcute dans la continuité spatiale des cinq adolescents en vacances embarqués à bord de la camionnette, rapprochant les distances, nous concentrant sur une immense focale qui écrase leurs silhouettes contre les poids lourds autoroutiers. Ça commence, d’ailleurs, quand ce camion les frôle, qu’il est à dix mètres de Franklin et qu’il frisonne quand même, pas à cause du camion mais à cause des coupes — des jump cuts tonals —, à en débouler de sa chaise roulante jusque dans un pré sans horizon. Pas de vraie pause non plus à la station-service, plutôt le début de la fin, avec la ligne de battue de l’implacable tempo accrochée à la marque ensanglantée que le fils maniaque a tamponnée sur la voiture.
La voiture avance en même temps que son réservoir s’épuise, son incapacité à avancer sera bientôt un des deux centres de gravité du délire, l’autre étant la maison de la famille cannibale, avec entre les deux des touffes denses d’arbres secs ; l’image-peau du film est une création terrifiante, bluffante, un mélange d’os, de cuir humain, de végétation impénétrable et de soleil brûlant, rapiécée des tonalités du montage qui crée des prisons atmosphériques, bordées de longueurs indues, de gros plans invasifs, d’une ouverture comme celle de la porte laissée battante lorsque Sally se croit tirée d’affaire dans les bras du pompiste. La seule ellipse où reprendre son souffle fait surtout montre de politesse à l’égard de l’effroyable clan : c’est le temps qu’il faut pour mettre la table avant le repas infernal. La texture de l’image s’accorde tout ce temps à la trame sonore, ces cris d’abattoir — un acte de montage plus qu’un acte musical —, pour empêcher quiconque d’échapper à l’état d’épuisement que le film génère, ce trop tard qui gère la construction temporelle de toutes ses fuites perdues d’avance.
À ces longueurs tonales interviennent de travers des coupes rapides, des rapprochements qui nous précipitent dans l’horreur par des effets de toiles sinistres, d’un gothique de fond de campagne qui s’empare de tout le cadre — une occupation profane de l’espace par le mortuaire. Son image-peau s’étend à mesure qu'on la déchire, car le coup de coupe du montage est la vraie tronçonneuse du titre — de toute façon Leatherface ne fait qu’une victime à la scie —, il soumet Sally la survivante à ces horribles contrechamps — Hooper est bien un ami de Spielberg parce qu’ils pratiquent tous deux un cinéma du contrechamp —, des plans qui se cognent de plus en plus fort contre son visage hurlant, ses yeux exorbités : A Clockwork Orange (1971) sans dispositif, Un chien andalou (1929) avec plus qu’un rasoir. The Texas Chain Saw Massacre gruge l’œil à coup de dents de scie. Son montage est sa brutalité, sa machine de mort, ce qui le rend impitoyable, l’éloigne au possible de toute humanité commune, comme un précurseur rural à Tetsuo (1989), un autre grand film en forme de moteur qui soumet la chair et la mute, à même le cinéma. (Mathieu Li-Goyette)




DEATH WARMED UP
(alias « LES CERVEAUX MÉCANIQUES » [Québec])
David Blyth | Australie/Nouvelle Zélande | 1984 | 82 minutes
Death Warmed Up, ça ressemble drôlement au chaînon manquant entre Mad Max (1979) et le cinéma de Peter Jackson, mais avec un peu (beaucoup) d’influence raimienne et cronenbergienne – l’empreinte de Scanners (1981) est partout : dans le concept de cortex explosif, mais aussi dans le personnage de l’antagoniste neurochirurgien (Gary Day), atteint d’un cas très grave de Michael Ironside-itis. Death Warmed Up, c’est une histoire de punks mutants, éructant de l’écume verdâtre, en cuirette noire sur des bécanes crades à la poursuite d’un jeune blondinet traumatisé venu envahir le laboratoire du méchant Dr Archer Howell, responsable de la mort de ses parents. Une histoire délirante ponctuée d’effets gore complaisants et d’une impressionnante direction artistique artisanale, mise en scène comme dans un cyclone par une caméra hyperactive, lancée dans le sillon des personnages comme sous l’impulsion d’une forme créative de TDAH.
La réalisation est fort imaginative et enlevante, et elle compense allègrement pour le manque de moyens de la production, ainsi que le caractère dérivatif d’une prémisse qui amalgame tant bien que mal le récit de vengeance shakespearien, le film de savant fou, le film de zombies et le cinéma d’action océanien. Le ton est glauque, trop glauque malheureusement – le méchant est trop méchant et les corridors de béton qui forment les artères de son repaire troglodyte sont trop claustrophobes, ainsi d’ailleurs que la cellule d’isolement encrassée de sang et de merde où est enfermé le protagoniste à la fin de la séquence d’ouverture. Heureusement, les effusions caricaturales d’hémoglobine donnent un relief comique à l’ensemble et les scènes de chirurgie, teintées d’un érotisme sordide qu’incarnent les éclaboussures vermeilles qui maculent sporadiquement le visage des assistantes sexy du Dr Howell, revêtent ainsi un caractère satyrique qui vient court-circuiter leur posture machiste et leur mesquinerie apparente. Ça prend un drôle d’humour pour apprécier pleinement la proposition de David Blyth, c’est sûr, mais c’est le cas également pour Bad Taste (1988), quoique ce dernier s’enorgueillisse d’une distribution autrement plus sympathique d’andouilles héroïques.
Il y a de bien belles scènes d’action également, et c’est là que l’influence de Sam Raimi se fait sentir le plus explicitement, lui qui se révèle en fait comme un réalisateur d’action déguisé en réalisateur d’horreur, influencé dans son style par le cinéma de genre asiatique. Il y a des scènes mémorables de rixe à moto dans des corridors industriels et des scènes de course-poursuite dans des corridors d’hôpitaux : autant d’occasions de réitérer la perspective extravagante des auteurs sur leur matériau de travail via des scènes d’explosion flamboyante qui viennent faire écho aux scènes d’explosion corticale de l’acte précédent. Du vrai bonbon, bref, confis de sang et de sueur, embaumé des relents fétides et délectables d’un piège à pervers. (Olivier Thibodeau)



Panorama-cinéma vous souhaite une terrifiante Halloween !
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
