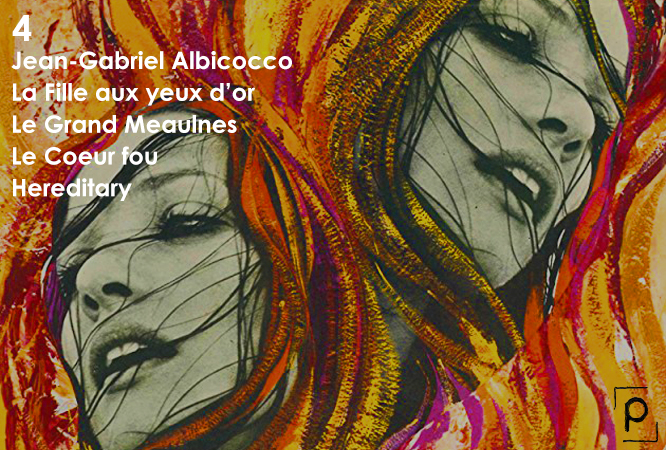|
LE GRAND OUBLIÉ
Albicoquoi !? Voilà ce qu’on nous répond quand on lance le nom d’Albicocco. Même chez les cinéphiles les plus aguerris, le nom demeure un mystère.
Et pourtant… tout semblait prédestiner Albicocco au cinéma. D’abord, il est né à Cannes le 15 février 1936. Ensuite, son père, Quinto Albicocco, est un directeur photo reconnu ; il œuvrera d’ailleurs sur tous ses films. Il tourne son premier court métrage à 12 ans. Il travaille avec Ichac, Coustaud, Dassin, le jeune Louis Malle… Il pratique tous les métiers du cinéma : machino, script, directeur de la photographie, assistant-réalisateur, monteur, dialoguiste, producteur… En 1968, il co-fonde (et s’implique dans) la Société des Réalisateurs de Films, puis la Quinzaine des réalisateurs. Il réalisera huit courts métrages, puis cinq longs métrages, à peu près tous descendus par la critique. Au début des années 1980, il quitte la France pour le Brésil, un pays qu’il affectionne particulièrement. Là-bas, il continuait de vivre pour le cinéma, en étant le contact obligé pour tout cinéaste français qui voulait y tourner ou y projeter ses films. Ce « gaillard joufflu » meurt à 65 ans dans l’indigence la plus complète et l’oubli le plus total à Rio de Janeiro, le 10 avril 2001.
Pourtant… en 1961, il avait déjà réalisé son premier long métrage — une adaptation de La fille aux yeux d’or de Balzac —, film dans lequel il faisait preuve, âgé d’à peine 24 ans, d’une indéniable maîtrise technique. Deux ans plus tard, en 1963, il s’envole pour l’Amérique du Sud afin d’y réaliser son second long métrage, Le rat d’Amérique — une adaptation du roman de Jacques Lanzmann —, et mène son équipe au sommet de la Cordillère des Andes où chacun souffrira du froid, du manque d’air et de l’altitude. En 1965, il rencontre Isabelle Rivière, la sœur d’Alain-Fournier, l’auteur du Grand Meaulnes, prématurément mort lors de la Première Guerre mondiale, un roman qui ne cesse de le hanter depuis sa première lecture et dont aucun cinéaste n’a réussi à obtenir les droits. Il n’a pas trente ans, elle est presque octogénaire. Le courant passe. Elle les lui donne. En 1967 sort donc sur les écrans Le grand Meaulnes, son chef-d’œuvre. Beaucoup lui reprocheront — tout en admettant la fidélité de l’adaptation — d’avoir mis des images sur ce roman intouchable. En 1970, il réalise son unique scénario original — Le cœur fou – film dans lequel il investira « une grande part de [s]es obsessions, de [s]es impulsions, de [s]es psychoses aussi ». Doit-on vraiment comprendre, dans l’histoire de ce photographe raté, ayant par le passé contribué à faire d’une jeune inconnue une star adulée de tous, qui plaque tout pour suivre dans son délire une pyromane impétueuse, qu’Albicocco fait le point sur sa vie et se lance dans la critique du star-système et de cette société qui brime l’imagination et la liberté de tous ? L’année suivante, il présente ce qui sera son dernier film, une adaptation du roman de Christine de Rivoyre racontant les sombres heures de la France sous l’Occupation, Le petit matin. Le film sent la fatigue, le dégoût, le ras-le-bol… comme si Albicocco avait baissé les bras et voulu donner raison aux critiques qui lui ont reproché, pendant 10 ans, son « maniérisme », son « gongorisme », son « baroquisme ».
Certes, Albicocco ne semblait pas de son temps. Au moment où il sort La fille aux yeux d’or, la Nouvelle Vague déferle sur la France. Qu’à cela ne tienne, il tourne en studio, place savamment ses éclairages, soigne sans relâche ses cadrages, installe ses personnages à l’extérieur de toute ligne de tiers, les coince dans le cadre, pose sa caméra sur des rails, la déplace sans cesse, capte tout grâce au grand angle, coupe abruptement ses scènes… nous sommes loin de la fraîcheur d’un Truffaut ou de la légèreté d’un Godard. Albi semble engoncé dans un formalisme tape-à-l’œil, chargeant chacun de ses plans d’une tonne d’éléments esthétiques. Il arrive à la mauvaise place au mauvais moment. La presse le critique ; le public le boude. Il se démène. Il n’en fait qu’à sa tête. Il persiste et continue de signer. On aura eu raison de lui, lui qui, pourtant… s’était battu toute sa vie : « Je me bats, et c’est bien le mot, pour mener à bien la production d’un film qui me tient à cœur. Je veux dire qu’il s’agit là d’intentions très personnelles et sans compromis. C’est pour cela que je me bats. » (Cahiers du cinéma, n° 161-162, janvier 1965).
Quand on regarde sa feuille de route, on s’attriste d’y trouver plus de films à faire que de films faits. Il aurait voulu adapter Georges Bernanos, Romain Rolland (Jean-Christophe, 1904), Raymond Radiguet (Le Bal du comte d’Orgel, 1924), Jean Giraudoux (Ondine, 1939), Pierre Rossi (Un Soir à Pise, 1971). Il semblait très avancé sur l’adaptation de Joana Maluca (Jeanne la folle, 1940), de l’écrivain brésilien Osvaldo Orico, et avait mis sur pied un autre film, qu’il aurait tourné au Brésil, basé sur la méthode de la « commedia dell’arte » : Polichinelle. Il songeait aussi à porter à l’écran un scénario de James Jones, East African Safari, de même qu’un scénario de Chris Bryant et de David, Cage d’eau, qui aurait donné la vedette à Robert Mitchum. Il avait encore en tête un scénario original intitulé l’Auto-stoppeur, qu’il aurait tourné avec Ewa Swann et Philippe Noiret et un autre encore, intitulé La Tendresse, qui aurait mis en vedette Eva Swann (toujours) et Marisa Berenson (qui venait de débuter dans Mort à Venise).
Soixante ans après son premier film, il serait temps de redonner la place qui revient à ce cinéaste incomparable.
Dossier dirigé par
Jean-Marc Limoges
|
|




|