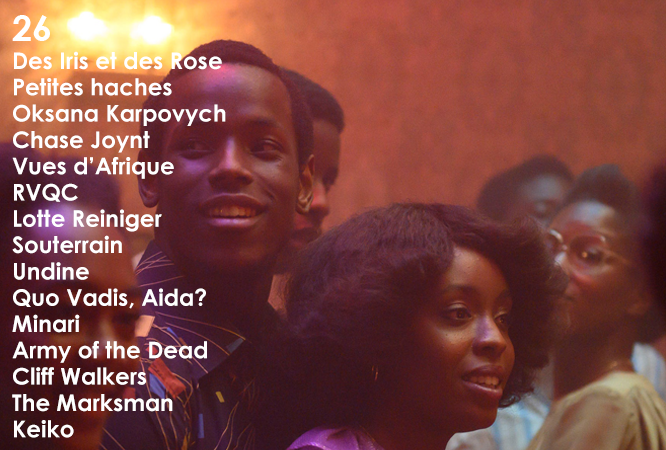Des Iris et des Rose
À deux reprises dans les dernières années, j’ai eu le privilège de servir sur un des comités de sélection de Québec Cinéma. La première fois, sur celui qui allait déterminer les finalistes parmi les courts métrages d’animation ; la seconde, pour voter les lauréats des Iris décernés dans les catégories Court métrage d’animation, Court métrage de fiction et Documentaire.
Il faut savoir que les lauréats de pratiquement toutes les catégories des prix Iris sont choisis par vote du milieu et de l’industrie, qu’on demande ainsi l’avis de quelques milliers de personnes pour décerner l’Iris de la Meilleure coiffure, mais que, dans le cas des prix consacrés à l’animation, au court de fiction et au documentaire, on se contente d’une dizaine de personnes pour cerner les finalistes et voter pour les lauréats. En effet, seules ces dernières catégories (y compris le montage, la direction photographique et le son, en plus du meilleur film et meilleur court film, dans le cas du documentaire) voient leurs finalistes et leurs lauréats déterminés par petit comité d’une dizaine de personnes tout au plus — un jury de pairs qui se réunit une seule fois pour débattre des prix à donner. Ces débats ne sont pas particulièrement réglementés et, comme c’est le cas dans n’importe quel jury, une dynamique interne finit par se dégager de l’exercice de groupe et certaines considérations s’installent.
Dans ce cas comme dans celui d’un jury festivalier, certains s’entendent pour voter sur le sujet (« c’est un film sur X, alors il faut le récompenser »), d’autres pour voter sur la diversité (« on ne voit pas assez de films représentant cette condition Y, alors poussons-le »), ou encore voter sur le mode de la répartition (« on pourrait donner le prix du montage à ce film qui n’a pas encore eu de prix, puisque ça lui donnera de la visibilité et c’est de visibilité dont l’industrie a besoin »). Toutes ces raisons, à des degrés divers, selon les années et les crus, sont potentiellement valables et peuvent permettre à des films parfois moins faciles de se frayer un chemin dans la tête de certains jurés (car tout débat de jury, ou de comité, cinématographique est un duel d’opinions pouvant souvent se résumer à ce que ses membres considèrent comme un « bon film »).
Je crois que Les Rose de Félix Rose, film émouvant, essentiel, a souffert de ces tergiversations internes au point de ne se mériter qu’une seule nomination, pour le Prix du public, et ce, uniquement après avoir défrayé la manchette et braqué les projecteurs de la honte sur le Gala. Donc, ni Meilleur documentaire, ni Meilleur montage pour un documentaire, deux catégories qu’il méritait pleinement d’intégrer, sinon de remporter. Car bien que les cinq autres aient été méritants, certains bien plus que d'autres, ils ont aussi en commun une facture visuelle plus léchée, plus « maîtrisée », alors que Les Rose est un film à l’esthétique plus frontale, plus « simple ». C’est un film de témoignage, d’introspection familiale et culturelle, de quête historique qui se penche sur un des événements les plus constitutifs de l’identité québécoise, un sujet qui n’avait donc aucunement besoin d’une direction photographique esthétisante afin d’intéresser son public. Plus encore, si Les Rose avait été aussi léché qu’Errance sans retour, on aurait sûrement reproché au jeune cinéaste de s’arroger son passé familial afin d’en faire un show de boucane. Or, Félix Rose a choisi la simplicité et la franchise qui sait l’accompagner, se doutant bien, on l’imagine, que l’importance de son sujet — avec toutes les facettes à la frontière du mythe et du mensonge qu’il évoque— devait absolument tenir cette ligne de l’épure sans cachettes.
Si certains ténors nationalistes se sont inquiétés d’arguments politiques qui auraient pu être formulés durant cette journée de délibération secrète du comité, il faudrait au moins reconnaître maintenant que l’omission du film de Félix Rose ne pouvait qu’être politique, d’une politique identitaire au pire, mais d’une politique de l’image au moins : politique de l’accessibilité aux images (« il a déjà eu son rayonnement, il est déjà disponible gratuitement sur onf.ca »), politique de la représentation culturelle (« pas plus “de souche” que ce sujet »), politique de la beauté technique (« ce n’est pas aussi travaillé que les autres films »). Bref, différentes politiques qui se nouent entre elles comme si toutes les raisons étaient finalement bonnes pour exclure Les Rose de la compétition.
Le film de Félix Rose ose pourtant proposer un important pivot dans le discours historique sur la crise d’Octobre. Il fait le pari de recontextualiser la lutte du FLQ dans un discours global contre l’assujettissement d’individus culturellement ciblés par l’État (on relira Itay Sapir ici pour une réflexion qui s’étend au conflit israélo-palestinien) et parvient à tout cela en s’imposant une mise au point familiale. On voudrait imaginer meilleur film québécois pour débattre de ce qu’est devenu notre cinéma national depuis les grandes années onéfiennes, sur ce que ce cinéma dit de cette nation et de comment cette nation peut se réinventer par le cinéma (ou pas), qu’on ne rêverait d’un film plus riche en perspectives que Les Rose.
Difficile de ne pas repenser encore à ce nouage politique en comparant deux discours de remerciement du Gala. En l’espace d’une vingtaine de minutes d’antenne, Caroline Néron, récipiendaire de l’Iris de la Meilleure interprétation féminine pour un rôle de soutien, et certainement surdouée dans son interprétation de la mère dans La déesse des mouches à feu, a eu un temps de parole de 2 minutes 18 secondes avant qu’on n’entende la musique pointant « poliment » la sortie (sur un discours d’une durée totale de 2 minutes 38 secondes). Au retour de la pause publicitaire, quand Félix Rose est monté sur scène récolter son Iris du Prix du public, 1 minute 5 secondes s’est écoulée, soit deux fois moins, avant que la musique ne démarre en hâte (sur un discours d’une durée totale de 1 minute 40 secondes). Caroline Néron soulignait son comeback après sa déconfiture financière, tant mieux pour elle. Félix Rose, lui, faisait un plaidoyer pour que le documentaire soit mieux reconnu, mieux diffusé, mieux financé, mieux considéré par l’État, par les diffuseurs et, forcément, par le Gala lui-même.
Il faut être moins pressé de croire au complot qu’à une sorte de médiocrité industrielle où le temps de parole des lauréats est le premier à être amputé dans le cadre d’un Gala mené en direct et devant s’aligner sur des impératifs publicitaires. Le fait est que, l’un dans l’autre, ces divers éléments soulignent un paradoxe évident entre la conscience esthétique et culturelle du cinéma québécois et l’industrie censée la promouvoir, entre un certain cinéma de nécessité ou de sincérité et un cinéma entériné par des prérogatives télévisuelles, toujours esthétisantes, souvent complaisantes et parfois même populistes. Il suffit de voir à quel point les récipiendaires des Iris du documentaire, de l’animation ou du court métrage faisaient encore figure d’ovnis durant un Gala qui semble se servir des films plutôt qu’il ne les sert.
C’est le paradoxe d’une industrie qui sait ne pas s’attacher au profit, mais qui a la contrainte de se fêter par un Gala obsédé par les cotes d’écoute. C’est le drame d’un milieu d’artistes vifs, allumés, qui n’ont souvent que des fenêtres de visibilité méfiantes comme des meurtrières, devenus simples produits d’un Gala nivelant vers le bas et qui réitère tout l’ascendant que possède une télévision québécoise incapable d’assumer l’étendue d’un cinéma québécois dont on finira peut-être un jour à souhaiter l’indépendance.
*
À l’index de ce numéro 26, une salve d’impressions en ouverture, petits coups de petites haches signés par l’équipe et quelques collaborateur.rices en l’honneur du monument télévisuel de Steve McQueen ; ensuite, une entrevue avec Oksana Karpovych (Don’t Worry the Doors Will Open, présentement à l’affiche sur Tënk.ca) menée par Naomie Décarie-Daigneault ; une autre entrevue, cette fois avec Chase Joynt (co-réalisateur de No Ordinary Man) et menée par Anthony Raynal ; puis nos dernières couvertures festivalières en rappel (Vues d’Afrique et les RVQC) question de demeurer à l’affût de la tonne de films qui échappent encore aux programmations déconfinées.
Samy Benammar nous invite à (re)découvrir le cinéma de Lotte Reiniger actuellement mis en vedette sur le Criterion Channel ; Anthony Morin-Hébert encense Souterrain de Sophie Dupuis ; je décortique l’Undine de Christian Petzold par le truchement de ses adaptations ; Olivier Thibodeau pointe dans la direction du mésestimé Quo Vadis, Aida? ; et Claire Valade vante les mérites du Minari déjà célèbre de Lee Isaac Chung. Vient ensuite un virage affirmé vers le cinéma de genre, avec Sylvain Lavallée qui ouvre la marche des morts en observant l’Army of the Dead de Zack Snyder, puis moi qui tente d’extirper Zhang Yimou des tenailles chinoises à travers Cliff Walkers, et Simon Laperrière qui nous appâte à travers son admiration sincère de Liam Neeson qu’on vient de retrouver dans The Marksman signé par le tâcheron Robert Lorenz. Enfin, pour souligner la rétrospective récente de son œuvre à la Cinémathèque québécoise, Maude Trottier revient sur la Keiko de Claude Gagnon à travers un texte prenant aussi les allures d’hommage à l’essayiste et professeur à la retraite Claude R. Blouin.
*
Ce numéro de Panorama-cinéma est le dernier numéro de notre cinquième volume, qui avait été amorcé comme une refonte éditoriale en mai 2018. Vingt-six numéros et quelques confinements plus tard, nous avons aujourd’hui la ferme impression que notre publication a grandie à travers l’ajout de nouvelles plumes, le tressage de ses formes d’écriture, la mise en place de plusieurs événements à la Cinémathèque québécoise, au Cinéma Moderne et ailleurs, puis la publication d’articles à la fois plus approfondis et plus engagés que jamais, sur la cohabitation des écrans, la représentation de l’altérité, l’exploration des radicalités festivalières, la mise en scène du numérique, des acteur.rices, de l’Histoire et d’autres sujets pointus comme passionnés. Loin d’avoir fait le tour de ces questions ou de rebrousser chemin sur ces avenues contemporaines, nous nous tenons toutefois fier.è.s face au travail accompli, face au raffermissement de notre ligne éditoriale et au groupe qui s’est constitué au fil de ces équipées.
Car ça y est. Nos démarches ont finalement porté fruit. Des subventionnaires d'envergure feront désormais confiance à notre revue pour porter ses projets d’avenir. Nous écrivons souvent beaucoup, souvent trop, et pourtant les mots manquent aujourd’hui pour traduire toute la joie qui accompagne l’éclosion de ces nouveaux possibles.
Sans en dire plus pour l'instant, nous vous invitons à nous suivre durant les prochains mois qui seront assurément marqués par cette période unique, intense, que sera le déconfinement, période durant laquelle nous continuerons de publier à l’envi, donc sans numéros, sur des films qui nous ont obsédés comme sur des sujets qui nous intimident, incluant les festivals qu’on espère vite retrouver.
En parallèle, l’équipe s’affairera derrière ses rideaux à constituer ces nouveaux projets, un peu fous, peut-être uniques, des initiatives que nous avons hâte de vous présenter et qui permettront à Panorama-cinéma de se repositionner en force au sein de l’industrie du cinéma et de sa critique.
Mathieu Li-Goyette
Rédacteur en chef
|
|

 

  


    
|