
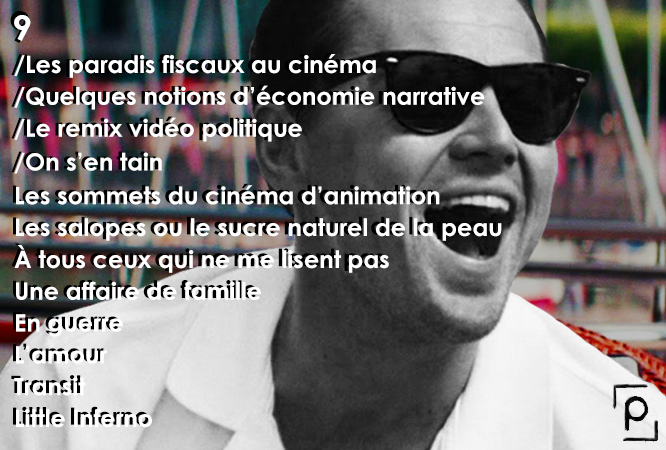
|
DE LA VRAISEMBLANCE À LA BANALISATION :
Si elle n’entraîne pas de critique sociale ou politique, la thématique des paradis fiscaux exploitée pendant plus d’un demi-siècle tant par le cinéma d’Hollywood et d’Occident que par les romans à intrigue et les bandes dessinées, n’en constitue pas moins un révélateur de la conscience publique à son sujet. C’était en 2011 la thèse du chapitre 13 d’Offshore [1], que le réalisateur Alexandre Gingras a entrepris de mettre en images quelques années après [2]. Les principes de vraisemblance et d’identification semblaient être exclusivement en jeu pour comprendre pourquoi les arts commerciaux n’en finissaient plus de nous montrer des barons de la drogue, politiciens corrompus, proxénètes et vendeurs d’armes parvenant à leurs fins en recourant à des banques sises dans des législations exotiques et ultrapermissives, la Suisse au demeurant, mais aussi le Luxembourg, Singapour, les Caïmans, les Bahamas et les Bermudes. Pour qu’on prête une crédibilité à de tels personnages, et éventuellement s’identifier à eux, il semblait requis de les doter de connaissances des réalités offshore. Comment croire au sérieux d’un responsable politique au bras long ou d’un narcotrafiquant qui ne connaîtrait absolument rien aux comptes à numéros administrés par des banques trouvant refuge dans des États criminogènes des Caraïbes ou d’Europe [3] ? Si la panoplie de références à ces sites ne représentait pas un vecteur de politisation, elle témoignait bien d’une compréhension au moins passive du public pour les réalités offshore. Le propos du livre, relayé par Alexandre Gingras, consistait à utiliser ces références comme point de départ en vue d’un travail de sensibilisation. Il s’agissait notamment d’indiquer au public qu’il est conscient du problème, le conscientiser sur l’état de ses connaissances sur le sujet, pour qu’il cesse de se sentir intimidé devant des enjeux réputés abstraits, difficiles ou ennuyants. D’où le titre : Je ne savais pas que je savais. Là-dessus est arrivé, en 2017, le court métrage de Thibaut Quinchon, On s’en tain, réalisé à compte d’auteur et projeté initialement dans le cadre d’une semaine d’activités de l’ATSA au centre-ville de Montréal. L’essai cinématographique circulaire montre en boucle deux classes sociales ne se rencontrant pas. D’une part, des affairistes négocient un contrat sous la protection de leurs gardes du corps. D’autre part, la classe moyenne et les prolétaires, avalés par leur quotidien, et séparés du premier univers par les mêmes gardes du corps. Entre les deux, un miroir sans tain. Il permet aux privilégiés du premier plan de voir la populace qu’ils surplombent. Étrangement, toutefois, leur indifférence est totale et pas une fois ne lorgnent-ils seulement vers le cadre donnant sur les classes subalternes. Ces dernières hurlent pourtant à travers le cadre, nez épatés contre le verre, dans l’espoir de comprendre en raison de quelles modalités d’obscurs puissants régissent leur vie. C’est du moins la perspective qu’on nous donne à voir d’elles quand la caméra faisant le tour de la scène se trouve du côté des puissants. Du côté des classes dominées, le simple miroir continue de renvoyer inexorablement ce que les citoyens ordinaires connaissent de la vie qu’on leur aménage. Ce travail montrait en quoi les dominés n’arrivent pas à voir ce qu’il en est de la réalité des puissants. Tout au plus l’essai cinématographique le suggère-t-il lui-même dans son cinéma muet. Maintenant, la question à laquelle on arrive… Comment les paradis fiscaux peuvent-ils se révéler aussi présents dans les arts de masse, et ce, de manière sérieuse et circonstanciée, sans avoir pour autant suscité de prise de conscience à leur sujet parmi les citoyens ? L’analyse sémiologique de Jean-Marc Limoges permet d’avancer [4]. Très souvent, les paradis fiscaux sont présentés de façon favorable dans les intrigues. Même s’ils concernent des situations que l’on réprouverait d’ordinaire en vertu de la morale élémentaire, les films et bandes dessinées inscrivent les législations de complaisance de manière enviable en raison de procédés cinématographiques : les tiers admirent les larrons qui savent en user ; eux-mêmes sont filmés avec gravité dans des cadrages serrés de façon à ce qu’on les accompagne dans leurs réussites ; les sites caribéens, suisses ou luxembourgeois sont eux-mêmes exhibés avec un halo de mystère qui nous les rend admirables… Comment peut-on chercher à mettre à distance les législations politiques libertariennes qui expliquent aujourd’hui l’évitement fiscal qui appauvrit les populations, le blanchiment d’argent qui rend puissants des criminels dans nos villes et la corruption qui permet à tellement de responsables politiques véreux de s’accrocher au pouvoir, quand ces lieux sont mystifiés au moment où on les donne à imaginer ? Mais l’argumentation ne fonctionne pas à tous les coups. Quid des scénarios qui réservent très clairement les paradis fiscaux à des malfaiteurs, et la lutte contre ce qu’ils autorisent aux figures héroïques ? Le roman The Firm de John Grisham, adapté au cinéma par Sydney Pollack, ou la trilogie Millenium de Stieg Larsson, portée à l’écran dans une production danoise, puis une autre états-unienne, avant de faire l’objet d’un feuilleton radio en France, n’ont manifestement pas suscité de politisation particulière. Tout comme le public se plaira à suivre tour à tour les aventures de Largo Winch dans la bande dessinée éponyme tandis qu’il pourra suivre les péripéties de l’intrépide Larry Max dans IR$, sans avoir l’impression de se contredire. Pourtant, le premier est un héros de l’évitement législatif et fiscal en gérant un empire dans à peu près tous les paradis fiscaux qu’on peut imaginer, tandis que le second traque les personnages de son acabit. On pourrait même les imaginer se faire face. Pourquoi, alors, une telle indifférence au thème même des paradis fiscaux, alors qu’ils constituent presque toujours une pièce maîtresse des intrigues où on les voit apparaître ? Risquons ici une hypothèse : ils ne sauraient choquer au cinéma dès lors qu’on les présente toujours comme dans un papier peint de l’histoire. Les paradis fiscaux, personne ne les désire, personne n’en est responsable. A fortiori, personne ne les crée. Ils sont un donné, toujours déjà-là, comme une fatalité, voire une malédiction, prêts à être utilisés par les plus forts, les plus rusés, les plus habiles. Tout au plus le cinéma nous soulagera-t-il de cet accablement civique en nous présentant de temps à autre un quidam parvenant lui aussi à l’Éden de la finance offshore. On pouvait bien sûr compter sur des Québécois pour nous offrir ce point de vue. Notamment, sur un mode comique, L’Empire bo$$é de Claude Desrosiers en 2012, sur celui de la satire, Un Paradis pour tous de Robert Morin en 2016, et dans une perspective dramatique, La Chute de l’Empire américain de Denys Arcand en 2018. Le dernier exemple est particulièrement représentatif de cette approche. Les paradis fiscaux passent pour un fait social auquel, de l’aveu du réalisateur, on ne viendra pas à bout. Indéniablement, le long métrage fait œuvre utile en montrant l’avocat Wilbrod Taschereau (Pierre Curzi), qui personnifie à lui seul ce que sont à même de faire plusieurs firmes de Montréal, offrir une pédagogie illustrée du phénomène. Étonnamment, c’est moins là la fiction qui inspire le documentaire, que le documentaire la fiction. Toutefois, dans son exposition, l’avocat mystifie l’existence des centres financiers offshore. On finit par oublier, dans ce film à l’instar de tous les autres, à quel point les législations de complaisance doivent leur existence à la seule complicité des États traditionnels, la plupart relevant directement de la Couronne britannique et bénéficiant de fait de la protection du Canada, des États-Unis et des pays de l’Union européenne. Le cadre de la vraisemblance, déployé dans La Chute de l’Empire américain au moment d’un cours universitaire d’économie, suggère au contraire, et de manière erronée, que le Canada menace les utilisateurs des paradis fiscaux. On va jusqu’à entendre que le Canada prévoit imposer des pénalités de l'ordre de 30% à 50% aux particuliers fraudeurs. Or, le Canada est précisément dénoncé depuis des années en raison du traitement au contraire amical qu’il leur réserve, par exemple dans le cas des clients de la firme KPMG qui se sont fait pincer à Man par le fisc, sans pour autant qu’il s’ensuive des conséquences sérieuses pour eux [5]. Dans un rapport resté d’actualité, André Lareau et moi-même avons dénoncé la clémence du Canada dans de tels cas de figure [6]. Il aurait été plus juste de présenter ces petits fraudeurs (un sous-ministre, des restaurateurs...) en tant qu’ils sont simplement impressionnés par la gesticulation de l'OCDE et autres rumeurs, sans que des mesures formelles soient en cause. Mais pour les fins de l'intrigue, convenons qu'il était plus simple de procéder comme l’a fait Arcand. Il reste que, de cet élément d’invraisemblance, émerge une intrigue dans le cadre de laquelle le seul espoir politique pour les petites gens demeure caritatif. Ruser à son tour, à l’instar des ripoux, pour accéder aux avantages que confèrent les paradis fiscaux, au détriment d’un État réputé incompétent et étourdi, afin de jouer aux robins des bois, en servant la soupe populaire qu’on finance et en offrant à tel itinérant, à la manière du numéro chanceux de la loterie, un logement. À l’écran, depuis une quinzaine d’années, non sans un réel souci esthétique, lequel s’inspire parfois des films de fiction mentionnés, ce sont les documentaires qui ont le mieux permis de passer de la mystification du cinéma d’intrigue à la pensée critique. Le Prix à payer d’Harold Crooks, Goldman Sachs : La banque qui dirige le monde de Jérôme Fritel et Marc Roche, ou encore L'Affaire Clearstream racontée à un ouvrier de chez Daewoo de Denis Robert et Pascal Laurent, semblent capables de cerner avec plus de justesse le fait social des paradis fiscaux, qu’un cinéma qui les naturalise, les dramatise ou les banalise.
Un dossier dirigé par
Alain Deneault
[1] Deneault, Alain. 2010 . Offshore. Paradis fiscaux et souveraineté criminelle. Paris : La fabrique, Montréal : Écosociété. [2] Gingras, Alexandre, avec Alain Deneault. 2015. Paradis fiscaux : je ne savais pas que je savais. Montréal : Altercitoyens. 2016. Didn’t you know you knew?. Montréal : Altercitoyens. [3] Deneault, Alain. 2015. « Je ne savais pas que je savais », Liberté, N° 307 (Printemps). [4] Cf. : article dans le présent dossier. [5] Zalac, Frédéric et Harvey Cashore. 2017 « Les intouchables : KPMG a caché l'argent de riches clients ». Site internet. Société Radio-Canada et Canada Broadcast Corporation (Mars). [6] Denault, Alain, en collaboration avec André Lareau. 2014. Paradis fiscaux. Des solutions à notre portée. Montréal : Réseau pour la justice fiscale & Collectif Échec aux paradis fiscaux. |
|
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
