
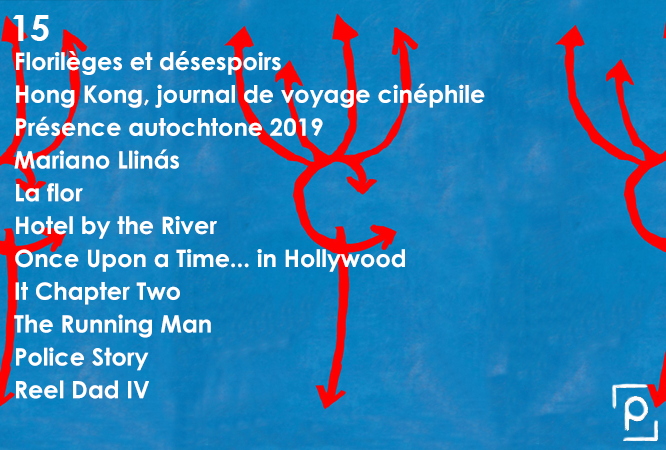
|
FLORILÈGES ET DÉSESPOIRS
Hier des centaines de milliers de personnes ont défilé dans les rues de Montréal pour faire de l’urgence climatique la priorité politique d’une génération. Il y avait 500 000 personnes, dit-on, la plus grosse manifestation de l’histoire du Québec, la plus grosse de cette journée de grève mondiale pour le climat. Cela n’a pas grand-chose à voir avec le cinéma, et pourtant il serait faux de penser que le cinéma ne garde pas déjà en lui des traces de ce tremblement de terre humain qui gronde et grandit. Ce dernier emblématise un profond désir de changement social, politique, environnemental et psychique, changement des mœurs et des idées sous l’égide d’une acceptation qui traverse la vie de toute part : un désir de faire des sacrifices, de viser moins plutôt que plus, un coup de frein dans l’accélérateur capitaliste. Dans une ère d’accessibilité totale, où nos désirs peuvent filer dans toutes les directions à tout moment, le mouvement écologiste prône une réduction censée de nos actions, un dévoiement stratégique de nos possibles, faisant la promotion d’une responsabilité vitale qui passe par une déconstruction des raccourcis conçus par nos modes de vie véloces. Encore une fois, on ne peut pas penser que le cinéma n’y réagisse pas ou ne soit pas déjà atteint des symptômes qui ont précédé cette grande prise de conscience collective. Quand on écrit du confort de son clavier, on a souvent le « changement de paradigme » facile, mais force est d’admettre qu’on voit défiler l’ancien état des choses à toute vitesse — propulsé par des hordes de vieux chroniqueurs blancs et chefs d’État divers qui font la file pour sermonner Greta Thunberg — et que le nouveau se pointe avec force à l’horizon, marqué par l’écoanxiété, la solastalgie d’un monde qu’on craint avoir déjà perdu. Ce sentiment d’urgence participerait donc d’un changement de paradigme du sensible, affiliable aux multiples actions collectives et individuelles qui marquent ces quelques dernières années, de #blacklivesmatter à #oscarssowhite, de #metoo à #copycomic en passant par la dénonciation des formes d’appropriation et de postcolonialisme culturels, qui ont toutes en commun la volonté de faire sauter les référents des générations qui nous ont précédés, ces prédéterminations fondées sur des jurisprudences inexistantes (« on a le droit de le faire parce que personne n’a jamais été reconnu coupable de l’avoir fait ») afin d’imposer une forme de jurisprudence collectiviste dont la mémoire est inscrite dans les principes avant de l’être dans la culpabilité. Difficile de ne pas penser à tout cela en regardant La flor, le film épique de quatorze heures réalisé par Mariano Llinás, nouveau géant, cinéaste pauvre aux idées riches qui s’attaque à l’histoire du cinéma à travers son amour pour ses quatre actrices et les genres cinématographiques qu’il leur propose de traverser. Son chef-d’œuvre est un florilège de six poèmes sur le cinéma, quatre débuts sans fins, suivis d’un récit complet mais silencieux, puis enfin d'un récit de fin sans début. La structure narrative de Llinás est un jeu sur les attentes modelées par notre connaissance des genres et des a priori symboliques, mythologiques, du cinéma. Elle met en valeur ses principes industriels, ceux qu’on ne peut nier et qu’il faut aimer pour savoir malmener. La flor répond en quelque sorte à cette impression de fin de l’histoire qui frappe présentement le cinéma contemporain, cette impression, accentuée par la distribution numérique en buffet ouvert, qu’il y a déjà tellement de films à voir qu’on pourrait oser se demander pourquoi en faire des nouveaux (d’autant que c’est polluant de produire tous ces films et plus encore tous ceux qu’on ne voit jamais mais qui existent malgré tout, pris dans un deal de distribution qui n’a jamais abouti ou confiné à quelques maigres passages dans des festivals parce qu’ils ne sont pas bons ou parce qu’ils n’ont été vus que par les mauvaises personnes ; comme le fait de conserver la disponibilité des fonds de baril de Netflix doit laisser une empreinte écologique non négligeable ; comme la facture écologique des 4000 personnes qui affluent en avion vers un marché du film pour s’échanger des liens Vimeo ne devrait pas passer inaperçue – l’empreinte écologique du cinéma numérique devra être analysée, discutée, débattue). En attendant, La flor propose ces récits en pétales qui se détachent de toute fin, comme une méditation sur l’incomplétude, l’insatisfaction, ces choses jamais terminables, pas commençables ni commerçables, mais qui persistent à débuter et à exister. La leçon qu'on retient, après son émouvant générique final de 40 minutes, c'est qu'il y a dans cette liberté cinématographique beaucoup de ce qui caractérise les besoins révolutionnaires de notre époque. À commencer par celui de s'attaquer aux structures poreuses qui ceinturent notre imaginaire (les genres qui s’hybrident, les sous-catégories des plates-formes en lignes, les tics du elevated horror ou du mumblecore, etc.), d'aboutir à un cinéma qui déconstruit le paysage référentiel afin de nous émanciper des dispositifs narratifs et spectatoriels qui conditionnent et limitent nos attentes. La flor, dans sa pauvreté de moyens affirmée, dans son inventivité réflexive et inédite qui court-circuite les règles de trois de la rentabilité, chuchote, explique, décrit, hurle qu’avec moins on peut effectivement faire plus, que le cinéma n’est pas mort dans ses multiples déclinaisons de variations internes, commerciales autant qu’auteuristes, qu’on peut encore retrouver de la nouveauté dans l’incomparable et qu’au contraire, jamais la comparaison n’a été si morbide, si avalisée à des systèmes culturels qui se liquident. Tout cela, il le fait en suivant quatre actrices qui jouent à fonder une histoire pour le nouveau cinéma, chose qu’Olivier Thibodeau cerne avec adresse dans sa critique du film et qui revient dans la discussion publique que j’ai menée avec Llinás en août dernier au Cinéma Moderne et rendue disponible en baladodiffusion. On le sent aussi à travers le récit de voyage prenant de Claire Valade, invitée à Hong Kong pour présenter le jeune cinéma québécois indépendant en plein climat de manifestation — une autre fin du monde, elle aussi combattue par une génération qui ne supporte pas de vivre dans le futur que leur a légué ses parents. Quant au compte-rendu festivalier de Claire-Amélie Martinant sur la plus récente édition de Présence autochtone, il s'aligne sur l'urgence en cernant la place capitale que tient la défense de l'environnement dans le cinéma des peuples premiers. Sur le dernier film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood, on confirme les clivages sur lesquels repose cette opposition entre une certaine jeunesse et l'esprit réactionnaire qui s'y attaque. D’un autre acabit, on retrouve une violence référentielle, voire un goût pour la nostalgie anesthésiante dans It Chapter Two, qu’Olivier associe avec justesse à la marvellisation du cinéma hollywoodien. Contre ces maux anxieux, quelques remèdes : le texte de Maude Trottier, nouvellement introduite dans notre comité de rédaction, sur Hotel by the River de Hong Sang-soo, où le cinéaste questionne la nature de la tristesse qui habite les retours à la tradition et à la famille que nous impose parfois la vie ; le texte d’Alexandre Fontaine Rousseau sur The Running Man, un classique oublié d’un cinéaste cruellement méconnu, le maître de la fuite, Carol Reed ; puis le texte d’Olivier sur Police Story, une célébration de Jackie Chan. Il y a de tout cela et plus encore dans l’émouvante chronique de Francis Ouellette sur nos enfances de magiciens libres et sur la difficulté que pourraient éprouver les enfants d’aujourd’hui à manipuler l’imaginaire nostalgique, cloisonné et hyperréférentiel qu’on leur impose à grands coups de parts de marché adulescentes. J’en profite, au nom de toute l'équipe, pour rendre hommage à Francis, récemment récompensé du Prix du récit Radio-Canada 2019 pour son Berce-toi Raymonde, magnifique récit d’enfance (celle-là dont il parle si bien dans ses chroniques) et qui vient de le révéler, tel le fier Kong, en p’tit gars du « Faubourg à m’lasse » haut perché sur le sommet de la grande tour brune. Pour paraphraser Welles dans les Ambersons, quelque chose s'est finalement produit, he got his comeuppance.
Mathieu Li-Goyette |
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
