
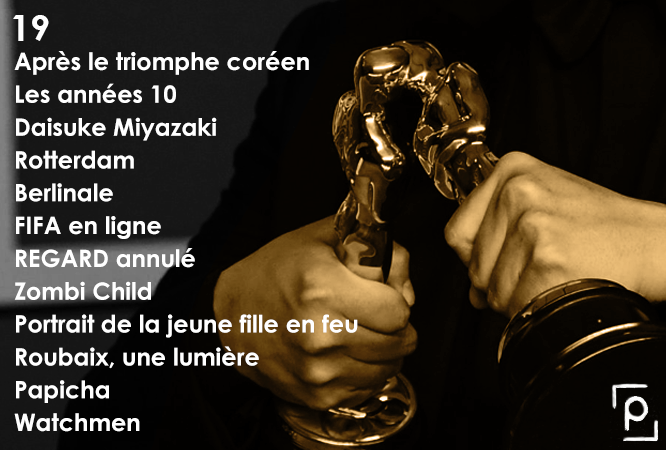
|
APRÈS LE TRIOMPHE CORÉEN
Ce numéro est trop gros et trop en retard. Nous avons voulu le sortir début mars, mais le retard s’est transformé en stupeur, à l’annulation de SXSW le 6 mars, de REGARD le 12 mars, à peine le festival commencé ; annuler un festival saguenéen le jour de son ouverture, c’est dire qu’il n’y aurait déjà plus d’exceptions sinon pour l’État. Comme il avait déjà été bien entamé, nous avons laissé du numéro ce qui avait été rédigé au préalable, en faisant chevaucher divers textes qui témoignent à l’occasion de l’entrée en confinement. Le fait est que ce n’est pas un numéro qui puisse réellement prendre acte de la situation actuelle, d’une part parce qu’un tremblement culturel intérieur semble encore tout immobiliser, d’autre part parce que la violente prise en otage par la vie numérique vole de la joie à la publication numérique. Au mieux il s’agit d’un exercice sur deux temporalités, de l’avant et de l’après, avec un portrait de groupe de la lointaine décennie précédente (« Les années 10 », qui viennent d’être cristallisées), des révisions, des notes et des échos. « J’ai l’impression que 2019 marque actuellement la fin d’un monde — du 20e siècle — beaucoup plus que 1999 ne le pouvait. », confiait Daisuke Miyazaki en octobre dernier. Le cinéma annonçait déjà le mur maintenant frappé. La perte de terrain du physique sur le numérique, l’importance de protéger les instances culturelles et commerciales qui assurent la circulation de la beauté portent en eux des enjeux qu’il nous faudra rapidement, vigoureusement, revaloriser, en espérant faire de cette crise un temps d’exemplarité. En attendant ces réflexions communes et notre prochaine publication, nous espérons que ces textes aux temporalités éparses, écrits autour de la fracture et de la suspension, pourront partager un instantané du cinéma, comme un Polaroid, immédiatement vieux.
*
J’ai la chance d’enseigner et de le faire au Centre d’études asiatiques de l’UdeM. Spécialisé dans la culture visuelle japonaise, ça ne m’a pas empêché ces derniers temps de constater un changement de paradigme sur les bancs d’école, changement qui se confirme à chaque nouvelle assemblée du personnel : bien que l’intérêt pour les études japonaises soit toujours là, les inscriptions en études coréennes ont triplé depuis 2013-2014. Outre le bon travail de mes collègues, des raisons de culture globale expliquent cette ascension fulgurante, et ce particulièrement dans un contexte où l’ensemble des inscriptions dans les sciences humaines sont en constante décroissance. Pourquoi de plus en plus de gens, et surtout les plus jeunes, semblent-ils s’intéresser aussi passionnément à la culture coréenne ? Il me semble qu’il s’agit d’un bon point de départ — contemporain — pour appréhender le triomphe global de Bong Joon-ho, de Cannes jusqu’aux Oscars. D’emblée il faut dire que le cinéma d’auteur coréen est loin d’être le premier responsable de cette vague coréenne. Cette semaine, la génération des millénariaux à laquelle j’enseigne, deux jours après la victoire de Parasite, était claire sur la bougie d’allumage de leur passion commune pour cette culture : la k-pop, la k-pop et la k-pop. Qu’elle soit d’abord appréhendée à travers la culture de l’anime ou du vidéoclip (qui demeure généralement bien plus névralgique en Asie de l’Est qu’ici), la k-pop ouvre d’emblée à la culture coréenne, à ses référents, sa langue, ses mœurs, sa cuisine, ses quartiers (à l’instar du quartier Gangnam de Séoul, devenu une sensation suite au coup de météore qu’avait été Gangnam Style en 2012). Derrière cette vague, un phénomène que la Chine avait baptisé le hallyu, la vague coréenne, regroupé au cinéma sous l’appellation de Hallyuwood et caractérisée d’abord par un investissement gouvernemental considérable dans la k-pop. Profitant du renouveau économique asiatique de la fin des années 1990, le gouvernement coréen d’alors s’installe dans les chaumières de l’Asie de l’Est (musique, télé, cinéma). À ce moment, la culture coréenne s’impose en Orient comme une alternative à la domination des cultures américaine et japonaise et échafaude peu à peu sa propre industrie, notamment par l’appui de mesures politiques hors du commun. Mis en place en 1969 alors que la Corée du Sud est sous la dictature de Park Chung-hee, le quota national du cinéma coréen impose d’abord à l’ensemble de ses salles d’être consacrées, au moins 146 jours par année (41 % par an), à la cinématographie locale, avec en échange une part plus importante du prix des billets (60 % pour l’exploitant et 40 % pour le distributeur coréen ; contre 50-50 pour un film étranger). En réponse à diverses pressions du marché américain, ce quota est revu à la baisse en 1996 (106 jours) et une dernière fois en 2006 (73 jours pour 20,50 % de jours d’une année)[1]. L’ouverture de ce protectionnisme est cependant calculée : le pays vit un basculement historique entre 2002 et 2003, l’année où Oldboy prend l’affiche, pendant que la part coréenne du box-office dépasse le seuil symbolique du 50 % face aux importations (c’est-à-dire qu’un billet de cinéma vendu sur deux l’est pour un film coréen). S’étant maintenu au-dessus de cette ligne de flottaison depuis près de 20 ans, ce quota toujours en règle n’a plus besoin de réglementer, le cinéma coréen pouvant aujourd’hui se vanter d’avoir su consolider l’une des rares industries cinématographiques nationales dont la vitalité des salles n’a pas à reposer sur Hollywood (derrière la Chine avec 64 % et le Japon avec 58 %, mais devant l’Inde à 45 % et la France à 40 % ; au Québec, la production locale représente entre 7 et 8 % des billets). Au téléphone, Nicolas Archambault, codirecteur de la programmation asiatique du Festival Fantasia, abonde dans le même sens : « La stratégie du gouvernement coréen fait que leur industrie se porte très bien et qu’elle n’a présentement pas besoin du marché occidental pour rouler. » Selon le programmateur, qui demeure avec la programmatrice Mi-Jeong Lee une figure historique dans l’importation du cinéma coréen au Québec, on voit se prolonger dans le marché nord-américain la suite de leur stratégie asiatique : « Déjà sur Netflix, avec une série comme Kingdom, avec Okja qui était à Cannes en 2017, on voit à quel point le cinéma coréen gagne du terrain et comment, d’autant plus avec la victoire de Parasite aux Oscars, il participe aussi à briser le tabou des sous-titres ». Le fait est qu’au-delà du triomphe, qui était à prévoir un jour ou l’autre compte tenu de la croissance et de la qualité constante de ce cinéma depuis deux décennies, le cinéma coréen propose un miroir intéressant au cinéma québécois. Notre cinéma, qui rayonne ici comme ailleurs avec l'intermittence d'une belle petite ampoule mal vissée, gagnerait à s’inspirer du modèle étatique coréen : un modèle rigoureux, exclusif, et qui convient surtout très bien aux industries de minorités entourées (eux par le Japon et la Chine, nous par les États-Unis et la France). Ce modèle est bien conçu pour cette digestion des influences étrangères et la valorisation intérieure d’un cinéma national. Un bon point d’arrivée — historique — serait de rappeler qu’un film sorti il y a 70 ans a connu une trajectoire semblable à Parasite, permettant de cerner dans ses grandes lignes ce qui semble se dessiner à l’horizon du cinéma coréen. En 1951, à la Mostra de Venise alors que le Japon est encore sous occupation américaine, Rashômon remporte le Lion d’or, inaugurant la carrière internationale d’Akira Kurosawa ainsi que celle du cinéma japonais… avant de terminer son parcours quelques mois plus tard aux Oscars, où le film est récompensé dans une catégorie honorifique consacrée au Meilleur film étranger (l’ancêtre du prix actuel). Dans les quinze années qui suivent, le cinéma japonais bénéficie du regard étranger, ce qui renforce son public local et contribue à lui faire dépasser en volume annuel la production hollywoodienne. Malgré des contextes radicalement différents (l’après-guerre japonais n’est pas la Corée de la crise économique), un sentiment d’urgence nationale parcourt ces deux films, ainsi qu’une volonté d’user de la mise en scène cinématographique afin d’illustrer des vérités universelles à partir de réalités nationales (la désillusion face aux mensonges déballés par le procès des vaincus de la Guerre du Pacifique, la lutte des classes entre des opposés bien intentionnés dans une Corée sans mobilité sociale). Enfin, à l’instar de Rashômon, il est nécessaire de rappeler que Parasite est un de ces arbres qui cachent des forêts et que le cinéma coréen possède une histoire qui mérite d’être découverte au-delà des grands noms qui circulent. Après Park Chan-wook et Lee Chang-dong, il faut aujourd’hui aller vers Im Kwon-taek (103 films de 1962 à 2014), Yoo Hyun-mok (41 films de 1956 à 1995), espérer aussi que Hong Sang-soo sera plus accessible. D’ailleurs, le Ministère de la Culture en Corée a financé et mis en ligne cette chaîne YouTube, qui présente gratuitement à tous les cinéphiles du monde les grands jalons du cinéma coréen.
*
De retour au présent, ce souhait de voir l’État prendre soin de sa cinématographie sera sans doute plus nécessaire que jamais. Dans ce numéro vous trouverez un article collectif, « Les années 10 », qui propose une série de réflexions sur la décennie 2010 du cinéma. En entrevue, une rencontre avec Daisuke Miyazaki, l’un des jeunes auteurs japonais les plus novateurs et sincères de sa génération. Du côté festivalier, Olivier Thibodeau a inauguré l’année 2020 en nous ramenant des nouvelles du festival de Rotterdam. Je l’ai rejoint à la 70e Berlinale, qui a livré une ambitieuse programmation, marquée par un changement de garde alors que l’ancien directeur Dieter Kosslick a cédé sa place à la codirection de Mariette Rissenbeek et Carlo Chatrian (qui a bien montré comment on métamorphose un festival à Locarno). À ce jour, la Berlinale demeure le dernier événement cinématographique majeur s’étant déroulé sans annulations ni précautions particulières. C’est aussi la dernière fois où nous avons mis les pieds dans une salle de cinéma, luttant pour des sièges dans des salles combles de mille personnes ; pendant ce temps, Alexandre (First Cow), Claire-Amélie (Portrait d'une jeune fille en feu), Claire (Fermières), David (La haine), Francis (La vie invisible d’Eurídice Gusmão), Jean-Marc (Color Out of Space), Maude (Zombi Child), Olivier (The Navigator), Samy (Territoires granulaires) et Sylvain (The Hunt) voyaient sans le savoir leur dernier film en salle. Une fois basculée de l’autre côté du miroir numérique, Maude Trottier a assemblé une équipe de collaborateurs hors pair afin de vous offrir une couverture conséquente de l’édition à domicile du FIFA. De nouveaux collaborateurs audio, Judith Chartier et Benoît Plante, ont proposé une création sonore avec l’actrice et réalisatrice Alexa-Jeanne Dubé autour de l’annulation du Festival REGARD. Enfin, dans le cahier critique, des textes sur Zombi Child, Roubaix, une lumière, Portrait de la jeune fille en feu et Papicha, complétés par une nouvelle baladodiffusion au sujet de Watchmen, le grand chelem de Damon Lindelof. Et pour entretenir une cinéphilie saine, nous continuons de mettre à jour notre page « Cinéma en pantoufles ». Prenez soin de vous.
Mathieu Li-Goyette
[1] Yusuf, Shahid et Kaoru Nabeshima (dir.). 2006. Postindustrial East Asian Cities. Palo Alto : Stanford University Press, p. 172-174. |
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
