
Sky Hopinka est un documentariste et cinéaste expérimental d’origine Ho-Chunk et dont les films, à la frontière entre la poésie et la politique, abordent la question de la représentation autochtone à travers les plasticités du cinéma expérimental. Il affectionne à la fois la pellicule et le numérique et aime jouer avec les couleurs, avec les matières des images qu’il manipule dans le but d’interagir avec son environnement, ainsi qu’avec une écriture médiatique de l’histoire. Nous l’avons rencontré au Café de la Cinémathèque lors de son passage à Montréal dans le cadre de la rétrospective qui lui était consacrée aux RIDM.

:: Sky Hopinka (RIDM 2023) [photo : Samy Bennamar]
Dominic Simard-Jean : Dans Dislocation Blues (2017), vous nous parlez des événements autour des manifestations de 2016 contre la construction de l’oléoduc Dakota Access sur la réserve de Standing Rock. Est-ce que selon vous le cinéma documentaire se doit d’être une alternative à la représentation de la culture autochtone dans les médias traditionnels ?
Sky Hopinka : L’autorité du cinéaste sur son sujet est un aspect du cinéma qui m’intéresse beaucoup et je crois que cette dynamique est particulièrement évidente dans le cinéma documentaire puisque le spectateur est souvent poussé à accorder une confiance totale aux propos exprimés dans le film. Quand j’ai commencé à faire des films, je travaillais principalement à l’intérieur d’une forme traditionnelle du documentaire qui était vraiment centrée autour de l’objectivité de la caméra, et qui, pour moi, imposait inévitablement une position d’autorité du cinéaste par rapport à son sujet. J’ai ensuite voulu trouver des manières de jouer avec ces conventions et ces formalités et de voir comment ces nouvelles méthodes pouvaient s’intégrer à ma démarche artistique. Dans Dislocation Blues, c’est justement pour renverser ce rapport d’autorité que j’ai choisi de m’éloigner de l’abstraction visuelle pour mettre l’accent sur les visages et la parole. Tout cela fait partie d’un ensemble de petits gestes que je fais pour remettre en cause certaines attentes que le spectateur peut avoir, et en particulier le spectateur non autochtone qui est peut-être moins familier avec des événements comme les manifestations de Standing Rock. Tout l’aspect mémoriel est aussi très important pour moi. Par exemple, dans mon entretien avec Cleo, l’intervenant principal du film que j’ai enregistré par le biais d’un appel vidéo, iel se questionne sur le sentiment de nostalgie qui a suivi son passage à Standing Rock et a du mal à se défaire de sa vision biaisée des événements. Il était donc important pour moi de lui laisser l’opportunité de prendre le temps de réfléchir à ce genre de questions. Là aussi, la perspective du spectateur joue un rôle important. La plupart des gens pourraient penser que Cleo est une autorité sur sa propre expérience, mais finalement, il y a beaucoup d’incertitude dans sa propre perception des événements. C’est exactement ce genre de contradictions auxquelles j’aime m’intéresser.
Mathieu Li-Goyette : Vos films utilisent le numérique d’une façon qui semble en tension avec l’analogique, ce qui exprime bien le paradoxe qui existe dans le fait de capturer l’Histoire à travers la technologie numérique, associée à des images parfois artificielles ou mensongères. Comment arrivez-vous à trouver un équilibre dans cette dualité ?
SH : Il faut se rappeler que le désir de préservation de l’histoire et cette hiérarchisation de la matière est un concept profondément occidental ; les musées et les centres d’archives en sont un exemple évident. Il est donc inévitable que cette vision historique des choses s’impose sur la mémoire autochtone. Il me semble justement qu’il y a une forme d’élasticité dans la tradition orale autochtone qui s’est perdue dans les cent dernières années. Je crois que de travailler avec du numérique me rend plus proche de cette élasticité et me permet de m’amuser avec elle.
DSJ : Si vos films prennent bien soin de ne pas entrer dans un processus d’historicisation des images, ils possèdent tout de même un caractère historique important. Comment décririez-vous ce rapport à l’histoire qui existe pourtant dans votre cinéma ?
SH : Il est évident pour moi qu’il faut s’intéresser à l’histoire pour mieux comprendre d’où nous venons, mais aussi pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Nous sommes le résultat direct d’un amalgame et d’une accumulation d’histoires et ce que nous vivons aujourd’hui peut seulement être assimilé si on s’intéresse à notre vécu et au vécu de notre famille, de nos ancêtres. Je crois que l’histoire nous dit aussi que nous devons préparer le monde pour les générations à venir. Bientôt, c’est nous qui serons des archives. Dans maɬni — towards the ocean, towards the shore (2020), j’ai voulu réaliser un film qui, plutôt que de rester fidèle au récit de l’origine de la mort dans la tradition chinook, cherche plutôt à entamer un dialogue avec cette mythologie. Mon but était donc d’en apprendre plus sur la pérennité de ces mythes.
Un autre exemple : dans When you’re lost in the rain (2018), j’ai choisi de superposer un poème de Walt Whitman qui parle de la conquête vers l’Ouest et de la « destinée manifeste » de l’Amérique avec le témoignage de Jordan Craig, qui nous dit que, malgré son statut autochtone, elle se sent constamment comme une étrangère vivant sur des territoires autochtones qui ne sont pas les siens. Il est donc important pour moi de développer une conscience par rapport à cette question de territoire et de faire contrepoids au sentiment de supériorité que beaucoup d’Américains associent avec la conquête de l’Ouest. Ce genre de juxtapositions m’aident à explorer les différentes zones grises et les nuances que l’on retrouve dans le discours historique.

:: maɬni — towards the ocean, towards the shore [Sky Hopinka, 2020]

:: When you're lost in the rain [Sky Hopinka, 2018]
MLG : Dans vos films, vous aimez rendre visibles des écrans et des moniteurs pour ensuite les contextualiser dans l’espace. Qu’est-ce que vous pouvez nous dire sur cet espace que vous cherchez à occuper ? Est-ce un espace privé, ou est-ce un espace qui se veut justement hors de l’Histoire ?
SH : Le témoignage de Cleo dans Dislocation Blues est la première fois que je filmais une entrevue par l’entremise d’un écran. Il y a premièrement un aspect pratique à cette décision parce que moi et Cleo vivons à plusieurs centaines de kilomètres l’un de l’autre. Mais j’ai aussi utilisé cette contrainte à mon avantage et elle m’a permis d’expérimenter avec le cadrage et le son. En représentant Cleo à travers un écran, je cherchais à proposer une réflexion sur les médias sociaux et la manière dont ceux-ci ont changé notre perception de Standing Rock. Je voulais par exemple savoir comment le fait de participer à un mouvement de protestation à travers les médias sociaux se compare à l’expérience de quelqu’un qui a vécu les événements sur place.
Ce sont donc des choses qui débutent comme des idées pratiques, et qui ensuite s’intègrent au contexte plus large de mon travail. Dans Fainting Spells (2018), j’ai filmé des images de mon ami Jordan marchant à travers une terre brulée avec mon téléphone. Je n’aimais pas trop la qualité de l’image et je voulais trouver une solution pour la stabiliser. J’ai donc pensé à transférer ce que j’avais filmé sur une cassette VHS pour ensuite diffuser ces images sur un écran cathodique. J’ai bien aimé le résultat et j’ai donc décidé de l’intégrer dans mon film. Chacun de mes films représente des possibilités différentes au niveau de la forme et cela me permet de constamment remettre en question le contexte de diffusion et la perspective du spectateur.
DSJ : Est-ce que le cinéma serait donc un outil vous permettant d’expérimenter avec le langage et de pouvoir vous libérer de ses conventions en y intégrant une perspective autochtone ?
SH : Oui, je pense bien. Par exemple, dans Jáaji Approx. (2015), j’utilise l’alphabet phonétique international pour réinterpréter le témoignage de mon père à l’écran. Je crois que la langue anglaise s’inscrit aussi énormément dans notre désir constant d’archivage. Mon but dans ce film était d’aborder le témoignage de mon père de manière scientifique et l’utilisation de l’alphabet phonétique est donc devenue pour moi une façon d’établir un dialogue entre ses paroles et le caractère archivistique du langage en utilisant un procédé de distanciation qui a selon moi pour résultat de faire ressortir le caractère très intime de ce témoignage.
DSJ : Pouvez-vous nous parler de l’importance que joue la musique dans votre cinéma, notamment de votre utilisation des protest songs ?
SH : Je crois que la musique m’aide à structurer les choses dans ma tête. C’est souvent elle qui détermine le genre d’émotions et l’atmosphère que je vais chercher à atteindre dans mes films. Mon travail est assez proche de la peinture et j’essaie de travailler à partir des couleurs et des sensations, et ce à la fois visuellement et oralement. Mon processus créatif débute généralement avec une chanson qui m’accroche pour une raison ou un autre. Par exemple, la chanson de Bobby Darin que j’ai inclus dans Dislocation Blues est une chanson que j’écoutais obsessivement pendant plusieurs semaines avant même d’avoir l’idée de l’utiliser. J’ai toujours aimé la musique dans les films et c’est un aspect du processus créatif qui m’apporte beaucoup de satisfaction. Je vois aussi la musique comme un moyen de me défaire de certaines conventions liées à la forme de cinéma expérimental que je pratique.

:: Dislocation Blues [Sky Hopinka, 2017]
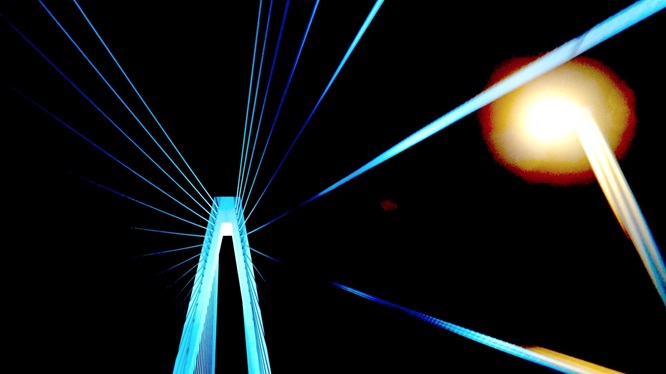
:: Jáaji Approx. [Sky Hopinka, 2015]
DSJ : Les paysages et les territoires jouent aussi un rôle important dans vos films. Est-ce que le cinéma est pour vous une manière de vous approprier ce monde et de l’utiliser pour construire votre propre territoire cinématographique ?
SH : Non, en fait c’est souvent le contraire qui se produit. Si j’essayais de constamment me réapproprier le territoire, je ne ferais que répéter les habitudes du colonialisme. J’ai un ami qui a écrit un poème dans lequel il dit qu’il est impossible pour lui d’écrire sur la terre, parce que la terre se décrit toujours par elle-même. Cette phrase a eu beaucoup d’impact sur mon travail. J’avais déjà réalisé quelques films qui traitaient de cet enjeu du territoire avant d’avoir lu ce poème et j’avais toujours eu de la difficulté à transmettre comment les paysages me faisaient me sentir intérieurement. De lire ce poème m’a fait réaliser l’importance de créer un dialogue avec le territoire et d’observer comment la terre se décrit elle-même, plutôt que de simplement documenter le territoire de manière, disons historique. Il y a ensuite toute une réflexion qui s’impose par rapport à mon interprétation personnelle du territoire. Évidemment, chacun aura une perception différente dépendant de leur histoire personnelle et des biais inhérents. Cela fait aussi partie de la beauté du langage et de la communication. Je cherche toujours à faire une place à ces enjeux dans mes films et c’est pourquoi il est très important pour moi de toujours entamer un dialogue, à la fois avec le sujet filmé et le spectateur.
MLG : Comment décririez-vous le processus créatif qui vous pousse constamment à imaginer de nouvelles trajectoires de mise en scène (des travellings, des zooms qui viennent cartographier l’espace) dans le but de pouvoir explorer les différents espaces et territoires représentés dans votre cinéma ?
SH : Le mouvement de la caméra est un aspect du cinéma qui a toujours été très important pour moi. Un des premiers films qui m’a vraiment impressionné et qui m’a fait comprendre « Oh mon dieu, c’est possible de faire ça avec une caméra » est Werckmeister Harmonies (2000) de Béla Tarr. Le plan d’ouverture de dix minutes qui suit lentement le personnage jusqu’au bar, comment il cadre ses personnages, son utilisation des gros plans et des plans larges ; tout ça est très beau, presque musical dans ses mouvements je dirais, un peu comme un ballet en fait. Je pense beaucoup à la différence entre la durée et la répétition. Quand quelque chose est répétitif, nous sommes toujours en train d’attendre que le cycle se brise. Quand nous regardons quelque chose qui s’inscrit dans la durée, nous avons plus de temps pour nous intéresser aux espaces, que ce soit à un paysage ou à une personne à l’intérieur d’un espace.
Quand j’ai réalisé towards the ocean, towards the shore, j’ai dû repenser ma manière de filmer des sujets humains. J’arrivais dans ces espaces où Jordan et Sweetwater m’amenaient et je les laissais me guider et me montrer ce qui était important pour eux. J’ai donc dû beaucoup penser à la composition de l’image et m’assurer de bien faire interagir le sujet et le paysage en jouant avec la mise au point, en essayant par exemple de faire un flou sur la personne à l’avant-plan. Mon but n’était pas de prioriser le sujet, mais plutôt de mettre l’emphase sur la relation entre le sujet et l’espace et d’aller voir ce que serait le résultat si je mettais la priorité sur le paysage à l’arrière-plan. Le plus crucial pour moi était vraiment de savoir prendre mon temps. Je voulais me laisser emporter par mes sujets et créer un ballet entre eux et la caméra.
MLG : Est-ce que ce sont justement les contraintes posées par cette nouvelle approche qui vous ont poussé vers le long métrage ?
SH : Oui, définitivement. J’ai toujours aimé les plans séquences, même si je sais qu’ils sont souvent très compliqués à réaliser. Je porte beaucoup attention à la rythmique du montage et j’avais déjà essayé quelques fois dans mes courts métrages de jouer avec la temporalité. Je ne voulais pas m’en faire avec les exigences des festivals et le long métrage m’offrait plus de possibilités d’occuper cette temporalité. towards the ocean, towards the shore m’a permis de mieux pouvoir explorer ce concept de durée et d’explorer quel effet cela peut avoir de laisser le temps en suspension, d’observer le genre d’émotion que le spectateur peut ressentir lorsqu’il regarde quelque chose de pas trop long, mais de juste assez long pour que son esprit divague dans une zone, disons, un peu plus dangereuse.

:: Fainting Spells [Sky Hopinka, 2018]
MLG : Je voulais discuter un peu de la plasticité de vos films. À travers votre approche expérimentale, vous semblez avoir acquis la capacité de superposer des territoires et des concepts. En même temps, comme nous en avons déjà discuté, il y a un désir dans votre cinéma de capturer les choses telles qu’elles sont. Pouvez-vous nous parler des enjeux qui existent autour de cette manipulation de l’image ?
SH : En fait, c’est quelque chose qui varie énormément à chacun de mes films. Quand je filme des paysages, je suis plus dans l’abstrait et mon but est surtout de dialoguer avec ce que je filme. Quand je filme des personnes, j’ai plutôt tendance à les laisser occuper l’espace sans trop intervenir. C’est toujours quelque chose auquel je porte une attention particulière. Dans Fainting Spells par exemple, puisque je travaillais avec des gens que je connais bien, j’ai voulu en un sens les protéger en adoptant une perspective plus abstraite, qui m’a permis de mettre en scène une sorte de spectacle de l’espace qui selon moi s’accorde bien avec le thème de la réincarnation et du mythe de la mort, avec toute la question politique de la représentation autochtone.
MLG : Cette question de la représentation autochtone est évidemment au cœur de votre cinéma. Et en règle générale, il faut dire que la fiction et ses politiques contemporaines de représentation nous ont surtout habitués à des récits d’empowerment, alors que vous explorez souvent des émotions plus complexes, notamment liées à la culpabilité ou au défaitisme de vos sujets. Comment arrivez-vous à trouver cet équilibre entre, disons, un cinéma d’autonomisation et un cinéma d’impuissance ?
SH : Je crois que cette question est très complexe et qu’il n’y a jamais de solutions évidentes à cet enjeu de la représentation. Est-ce que les choses doivent toujours s’équilibrer ? Je ne crois pas. L'une des raisons principales pour laquelle j’ai voulu faire du cinéma est justement parce que je trouvais que personne n’avait encore bien exploré cette question de la représentation autochtone. Je crois que juste le fait de voir de la représentation autochtone dans les médias est une part importante de cette représentation. Devoir constamment penser à la perspective des jeunes, à la perspective des adultes. Je cherche toujours à trouver des craques dans le système à travers lesquelles je peux développer ma propre vision et faire du cinéma qui échappe à cette perception binaire qui existe entre faire du cinéma engagé ou faire du cinéma pour parler de mes traumas. Est-ce que tout ça est vraiment un enjeu de représentation ? Pour moi, c’est bien davantage un enjeu d’indépendance.
Transcription et traduction : Dominic Simard-Jean
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
