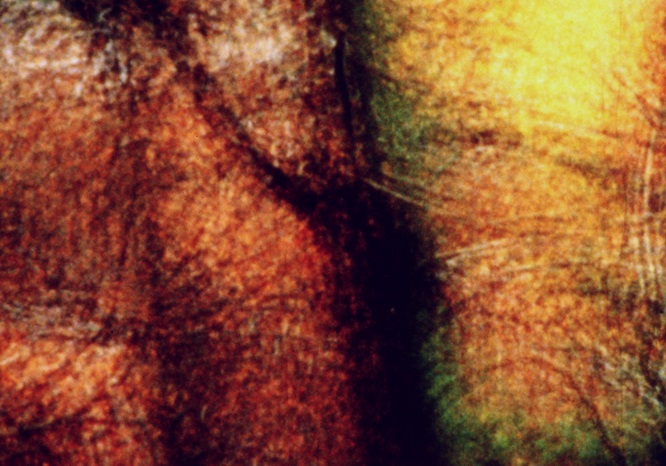
:: I. [Alexandre Larose]
Alexandre Larose est un cinéaste montréalais qui a obtenu un diplôme en génie mécanique avant de voguer vers d’autres horizons et se plonger dans des études en beaux-arts à l’Université Concordia. À la fois poète et homme de science, il a basé son œuvre sur l’un des plus grands plaisirs du métier de cinéaste : la capacité à revoir quelque chose, à décomposer une action plan par plan, à plonger dans les mystères du quotidien. Pendant sept ans, il a filmé une marche du chalet familial, près du lac Saint-Charles, le long d’un chemin flanqué d’arbres et de buissons jusqu’à un quai. Il en a fait dix-neuf films, réunis dans une série nommée brouillard (2008–2015), chacune des marches étant ponctuée d’arrêts et de reprises, alors qu’il rembobinait la pellicule dans la caméra afin de produire une série d’impressions surimposées, comme s’il voyageait à travers le temps. Pour sa série Ville Marie (2006–2017), il a installé des caméras au-dessus des toits de plusieurs édifices de Montréal avant de sélectionner le premier gratte-ciel de la ville, la Place Ville-Marie. Après avoir trouvé l’édifice qu’il voulait, il a songé y travailler comme concierge afin de vivre littéralement dans ses expériences. Des boîtiers spéciaux ont été construits à la main pour s’assurer que les caméras pointent vers le ciel et qu’elles ne tombent pas en morceaux.
Dans sa nouvelle série, scènes de ménage (I./II./III., 2017–2022), l’artiste retourne dans la maison familiale pour filmer son père, Jacques Larose, un homme qu’il nomme « son modèle ». Dans ces films, Jacques effectue de simples rituels quotidiens qui sont filmés, puis refilmés alors que l’artiste rembobine plusieurs fois la pellicule dans sa caméra, créant une symphonie d’images surimposées, de variations sur un thème. Le premier film de la série, scènes de ménage I., porte sur l’ouverture d’une fenêtre qui révèle un paysage forestier. De magnifiques couleurs automnales remplissent le cadre de chaleur et de lumière, alors que la cloison entre l’intérieur et l’extérieur s’estompe.
Dans scènes de ménage II., le père de Larose est assis sur le sofa ou se tient à la fenêtre. De douces éruptions de nature apparaissent, des plans larges du lac, des nuages ou de la forêt. On constate surtout comment il est réconfortant de voir le petit monde dans lequel nous vivons être bichonné avec tant de soin et d’attention méticuleuse. Pas besoin de viser quelque chose de grandiose provenant d’un endroit lointain ; tout ce qu’il y a à voir pour le cinéaste se trouve ici même, à la maison, dans un lieu dénaturé par des couches de grain, des rayures et des traces d’émulsion. L’acte de traverser une pièce se transforme en aventure visuelle, alors que des corps démultipliés gonflent et frissonnent, vibrant sous une étrange lumière fantomatique.
Une ombre plane constamment, comme si le modèle, son père, se rapprochait de la mort. Ses mouvements sont lents et laborieux, et sa présence est fantomatique, comme s’il disparaissait déjà. J’ai vu mon propre père disparaître lentement du monde, au fil des ans, alors qu’il se détachait de son corps, perdant presque toute sensation dans ses pieds, ce qui a affecté sa motricité, puis jusqu’au centre de son corps, ce qui l’a bientôt empêché de se lever de sa chaise. Les trois réflexions muettes de Larose témoignent du passage entre les mondes, alors que son père se transforme tranquillement en lumière.
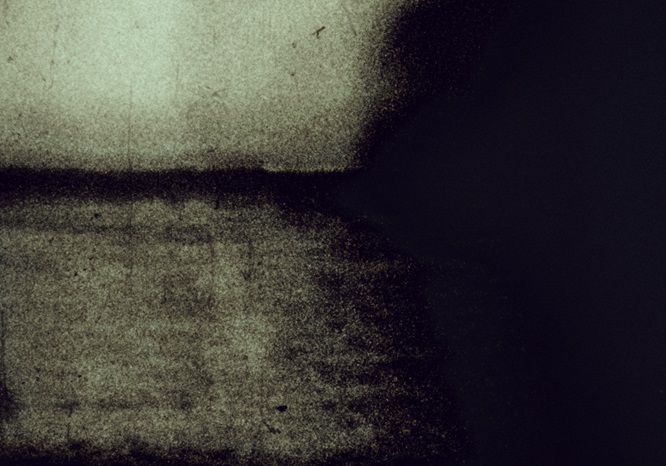
:: II. [Alexandre Larose]
scènes de ménage III. s’intéresse aux mouvements et aux gestes de son père. Il se tourne vers la fenêtre, ouvre un rideau, descend les marches, sort sur la pelouse. Chaque action s’accompagne d’une fantasmagorie d’impressions, d’un époustouflant tourbillon de corps centripètes qui flottent à travers le cadre jusqu’à ce que Jacques s’interrompe, et que, durant cette pause, les nombreux corps se réunissent, formant un tout temporaire avant qu’il ne reparte. Ces palpitants flots sensoriels ont été créés sur divers types de pellicule, parfois dans un noir et blanc tinté granuleux et oppressant, parfois dans une couleur délavée. Le refus de choisir un mode ou l’autre me permet de remarquer la couleur lorsqu’elle apparaît et, inversement, de constater que l’image est maintenant en noir et blanc. Cette tactique nous rappelle que, même à l’intérieur d’un seul film, nos habitudes de visionnage en invisibilisent certaines parties. Au courant de l’œuvre, elle s’efforce de défaire l’une de nos plus immuables habitudes, celle de placer l’humain au centre, et de reléguer le reste à l’arrière-plan, à l’instar des accessoires inanimés de la figure humaine. Ici, Larose réunit très doucement la figure et le sol dans un bégaiement visuel saturé qui suggère un monde qui n’a pas été colonisé ou approprié selon les lois du marché. Les étoiles forment un rideau, une chaise, un drap. Voici enfin une vraie vision écologique, où tout est vivant et relié, interdépendant.
Ces trois films sont muets. Un choix impopulaire, s’il en est. Même à l’époque du cinéma muet, au début du 20e siècle, les films n’étaient pas vraiment muets. Il y avait toujours un piano dans la salle, ou un bonimenteur pour commenter les images défilant, pour guider le regard. Mais lorsque les artistes ont commencé à faire des films, ces dernier∙ère∙s ont libéré le potentiel radical des films muets, quoique je ne puisse m’empêcher de revenir sur l’expérience de John Cage en 1951. Désireux de profiter du silence, il s’est rendu à Harvard, où l’on avait construit une pièce insonorisée parfaitement silencieuse. Quelques minutes après s’être acclimaté, il a remarqué un bruit étouffé d’eau courante accompagné d’un léger battement de tambour. Ce qu’il entendait, c’était son propre flot sanguin et le rythme de son cœur. Il a conclu que le silence était à la fois inatteignable et indispensable.
Je me suis souvent retrouvé dans le silence de cinémas marginaux, où les publics petits et grands remuent inconfortablement en attendant la fin de cette quiétude imposée. Dans l’absence d’une bande sonore, il semblait qu’on nous contraignait à nos corps indésirables, comme si nous venions au cinéma pour échapper à ceux-ci. Dans une culture où les images du corps pullulent, où les publicistes ont compris que tout produit, aussi inutile ou absurde soit-il, semble plus attrayant lorsqu’un beau corps l’accompagne, lui sourit, le pointe du doigt, peut-être n’est-il pas surprenant que nos corps reflètent une existence indésirable, conçue de plus en plus pour qu’on leur échappe. L’ordinateur n’est-il pas le point culminant de cette trajectoire ? Exiger le silence, comme le fait Larose, implique de se dissocier de nos plus profondes habitudes culturelles. Pour la plupart des gens, les films muets ne sont pas simplement insoutenables, mais constituent un acte hostile, une provocation.
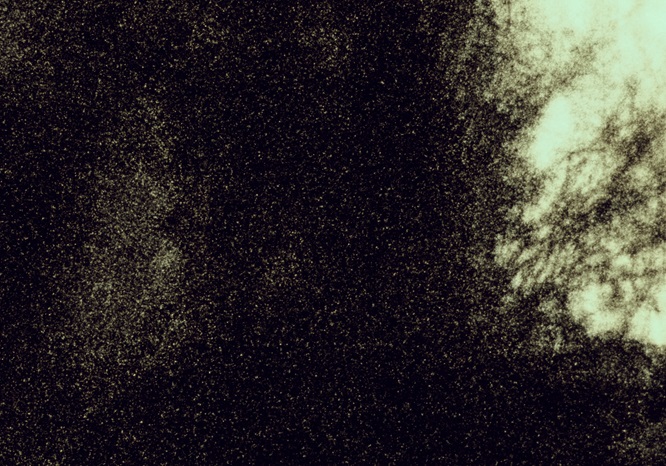
:: III. [Alexandre Larose]
Écoutons l’artiste donner son avis sur l’acte de voir. Ses mots proviennent d’une superbe entrevue avec Tess Takahashi.
Je dois faire un effort conscient pour voir une chose pour ce qu’elle est vraiment. C’est un peu comme être dans une relation qui semble d’abord conditionnée par des attentes psychologiques inconscientes. Ça peut être long avant qu’on réalise qui est vraiment la personne qui nous accompagne. Selon moi, c’est le moment où plusieurs couples se séparent. Mais, il peut alors y avoir un beau revirement, où l’on se dit : « OK, voilà cette personne comme elle est. » Ça m’est arrivé avec mon père, par exemple. J’ai commencé à le connaître comme si c’était une autre personne. Je crois que c’est la même chose avec toute relation, tout objet, toute chose, dans le monde réel. En gros, il suffit d’une reconnaissance attentive pour que nos préconceptions cessent de déterminer ce que l’on voit. [1]
Je crois comprendre que, lorsque Larose regarde quelque chose, il ne voit que le passé, les habitudes, les vieux clichés. Ça me rappelle ce que disait mon ami Gary à propos de l’improvisation à la guitare, que ses mains étaient comme des chiens qui retournaient sans cesse dans des lieux familiers. Il faut travailler fort pour découvrir quelque chose de nouveau, en dehors de la chambre d’écho de nos perceptions passées. Voir n’est pas possible d’un simple battement de cil ; c’est une tâche ardue qui requiert des efforts considérables. Il n’est pas surprenant, alors, que Larose ait choisi une personne qu’il a connue toute sa vie pour essayer de la voir pour la première fois, comme quelqu’un de complètement Autre et inconnu. Ces efforts d’attention soutenus s’apparentent à un cadeau de temps ralenti qui nous ramène à nos corps remplis d’émerveillement à l’idée que le familier puisse réapparaître comme une prière silencieuse.
[1] Tess L. Takahashi, « Q & A: Alexandre Larose », desistfilm, 2 sept. 2015 (https://desistfilm.com/q-a-alexandre-larose/)
*
Mike Hoolboom a commencé à faire des films en 1980. Mis en pratique, avec application quotidienne. Une remixologie continue. Depuis 2000, un flot constant de docus biographiques à partir de séquences trouvées. La question qui anime une communauté : comment puis-je être utile ? Des entrevues avec des artistes médiatiques au fil de trois décennies. Des monographies et des livres, écrits, édités, co-édités. Des écologies locales. Du bénévolat. Ouvrir la porte.
Traduction : Claire Valade
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
