|
Lorsque mon collègue Oliver Thibodeau m’a demandé si j’étais intéressée de souligner la Saint-Jean pour la section Cinéma québécois dont je suis l’éditrice, j’ai immédiatement été emballée par la proposition et je me suis empressée de chercher un angle accrocheur, qui susciterait à la fois l’engouement de mes camarades de Panorama-cinéma, celui de collaborateur·trice·s externes et, surtout, celui de notre auditoire. En réfléchissant à ma propre expérience, j’ai plongé dans les premiers souvenirs de cinéma québécois de ma jeunesse. Ces grosses comédies à succès diffusées à la télé aux heures de grande écoute après une carrière appréciable en salle, comme J’ai mon voyage de Denis Héroux (1973) avec Dominique Michel et l’idole de l’époque, René Simard, qui m’avait fait bidonner dans mon enfance. Les drames historiques à cheval sur le cinéma d’auteur·trice et populaire, comme Les Plouffe (1981) et Maria Chapdelaine (1983) de Gilles Carle qui m’avaient tant émue à l’adolescence. Et tous les autres, des courts d’animation de l’Office national du film (ONF) aux œuvres plus confidentielles et aux documentaires percutants découverts grâce à un professeur de cégep particulièrement allumé, Rolland Haché. Voilà ! Je tenais mon filon !
Vous trouverez donc ci-après une jolie collection de courts articles très divers autour de ce « premier » contact avec le cinéma québécois. Ce premier film marquant, qui a ouvert la porte sur notre cinématographie. Avec moi, 15 collègues et collaborateur·trice·s de générations, d’origines et de milieux différents, mais tou·te·s passionné·e·s de cinéma d’ici, ont bien voulu se prêter au jeu et révéler ce qui a lancé leur exploration des œuvres et des artistes de chez nous. Joyeuse Saint-Jean ! — Claire Valade, Éditrice Cinéma québécois |
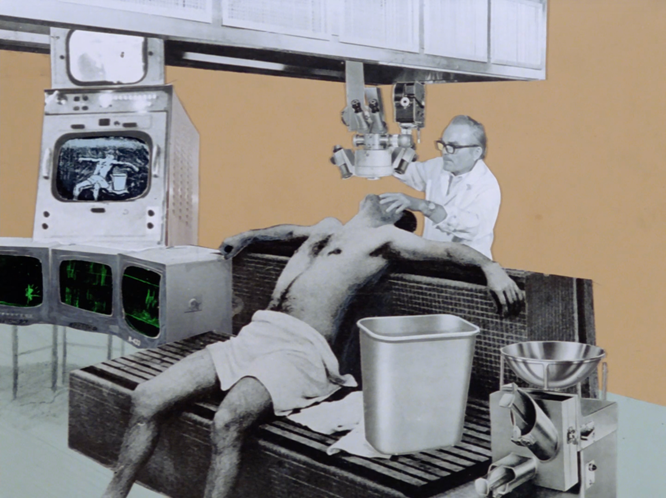


ONF
L’AFFAIRE BRONSWIK
André Leduc et Robert Awad | Québec | 1978 | 23 minutes
ROULI-ROULANT
Claude Jutra | Québec | 1966 | 15 minutes
J’ai grandi en dédaignant la culture artistique québécoise. Chez mon père américanophile, on m’a inculqué très jeune la haine des Colocs, et les contacts avec les fictions d’ici étaient limités, généralement fort peu excitants. L’auberge du chien noir et Nitro (2007) incarnaient à mes yeux la quintessence de notre talent et de notre sensibilité. Une certitude dominait en moi : les productions médiatiques du Québec étaient cheaps, insignifiantes… inférieures à tout ce qui sortait des usines à rêves des US of A.
Impossible d’en être certain, mais je crois que le moment où le bloc lisse et solide de mes préjugés a commencé à s’éroder coïncide avec une visite scolaire à l’ONF, du temps où un robot sympathique nous accueillait à bras ouvert. Au programme : le dynamisme du cinéma documentaire canadien et québécois, et le format du faux documentaire. Les détails de l’activité ont disparu de ma mémoire, mais persiste l’impression d’un choc fulgurant provoqué par L’affaire Bronswik et Rouli-roulant. Dans ces courts métrages qui subvertissent les codes du documentaire-exposé, pas de drame familial ni de misérabilisme national, pas une once de pathos et nulle trace du damné star-système qui m’irritait tant ; aucun des poncifs que j’associais aux fondements ontologiques de notre production nationale n’était de la partie. Un ton d’ironie festive guidait chaque minute de ces œuvres qui défiaient l’intelligence de leur public en opacifiant la démarcation entre réel et fiction, authenticité et fabrication.
Coincé entre l’adolescence et l’âge adulte, assoiffé d’indépendance, j’ai été conquis par cette confiance qu’on m’accordait sans même me connaître, et puis par le contenu des films eux-mêmes qui malmenaient l’autorité, nos angoisses collectives, la bêtise des conventions. Le monde représenté était le mien, mais ce lieu était ouvert et non pas entouré des hautes murailles de l’isolationnisme culturel qui m’étouffait. Comme ailleurs (et surtout, comme aux États-Unis), nous faisions aussi face aux problèmes de la publicité, du consumérisme, de l’hégémonie des réseaux ; les conflits générationnels nous touchaient également, et les modes transigeaient aussi par chez nous.
Quand j’ai à mon tour projeté L’affaire Bronswik à mes étudiant·e·s du cégep, plusieurs paires d’yeux se sont illuminées du même ébahissement.
— Anthony Morin-Hébert

Max Films / Éléphant
UN 32 AOÛT SUR TERRE
Denis Villeneuve | Québec | 1998 | 88 minutes
En 1998, à la sortie du film Un 32 août sur terre de Denis Villeneuve, j’ai cinq ans. C’est mon tout premier souvenir marquant au cinéma. Peut-être même la toute première fois que je franchis les portes d’une salle obscure.
Je me souviens d’avoir été marquée par le titre. À lui seul, il ouvrait un espace poétique, décalé. Ces mots imposaient une sorte de recueillement.
Il me semble qu’il faisait chaud ce jour-là. Mais peut-être n’est-ce qu’une impression née du film lui-même, qui se déroule en partie dans un désert.
Je n’ai aucun souvenir de la trame narrative, bien honnêtement. En ligne, on lit que c’est l’histoire de « Simone (Pascale Bussières), rescapée d’un accident de voiture, qui part avec son ami Philippe (Alexis Martin) ». Ce qui me revient toutefois en mémoire, c’est le regard de Pascale Bussières, sa photogénie troublante. Et l’ambiance du film, lunaire.
Peut-être au fond que tout a commencé là, dans cette indistinction entre l’œuvre et moi, entre la salle et l’extérieur, entre la chaleur du film et la chaleur du souvenir — dans cette extension de l’expérience humaine que permet le 7e art. Pour la première fois, j’apprivoisais cette sensation d’être remuée que seule, je crois, une œuvre cinématographique peut provoquer en soi. Une expérience de l’étrangeté qu’aucun film de Disney n’avait réussi à susciter jusque-là.
Il faudrait que je revoie Un 32 août sur terre. Ou pas.
Les souvenirs sont toujours plus intéressants que la réalité.
— Sarah-Louise Pelletier-Morin

Les Productions La Fête / Éléphant
LA GRENOUILLE ET LA BALEINE
Jean-Claude Lord | Québec | 1988 | 91 minutes
Comme beaucoup de filles prépubères, je me suis projetée dans le personnage de Daphné sans jamais chercher à comprendre pourquoi. Le recul de l’âge adulte m’en offre aujourd’hui quelques clés : contrairement à beaucoup d’héroïnes jeunesse encore sexualisées et passivisées dans les années 1980, son personnage est autonome, lié à son monde intérieur, et incarne une étrangeté pleinement assumée, accueillie comme une force tranquille.
Il faut savoir que La grenouille et la baleine trace une trame fragile, mais marquante, portée par une écologie perceptive et une réciprocité sensible entre l’humain et le vivant. Récit liminal entre terre et mer, entre enfance et âge adulte, esquissant une réflexion sur la porosité des mondes — sur ce que l’enfance permet d’approcher et ce que l’âge adulte rend inaccessible. Cette réflexion s’incarne dans une justesse de ton et un refus d’effusion dramatique.
Fanny Lauzier incarne donc Daphné, une enfant à l’hyperesthésie auditive, dont l’acuité quasi surnaturelle ouvre un dialogue intuitif avec les baleines à bosse, les dauphins. Ce don la place à la frontière entre l’être humain et ce qui le dépasse, rejoignant l’archétype de l’enfant-médium, passeuse entre les espèces et les dimensions.
Et Daphné s’inscrit à l’avant-garde d’une évolution du cinéma jeunesse, qui amorce un changement de regard sur la différence, mais aussi sur la figure de la jeune fille qui n’est plus à normaliser ou à protéger, et qui est reconnue comme sujet à part entière. Sa trajectoire fait écho aux bildungsromans où des fillettes marginales transforment leur divergence en chemin singulier — à l’instar de Matilda de Roald Dahl, publié la même année, puis adapté au cinéma par Danny DeVito en 1996.
L’univers visuel du film repose sur l’apport du directeur photo Pierre Mignot. Son usage du flou atmosphérique confère aux images une matérialité intime, non pas spectaculaire, mais franchement immersive. Jean-Claude Lord y propose une vision animiste du vivant, bien avant que le cinéma mainstream ne s’empare de cette thématique. C’est cette attention au monde sensoriel des plus vulnérables, sans surécriture, qui donne au film sa force tranquille. Avec le recul, sa liberté de ton et la portée poétique de sa vision du vivant en révèlent l’ambition singulière.
— Anne Marie Piette
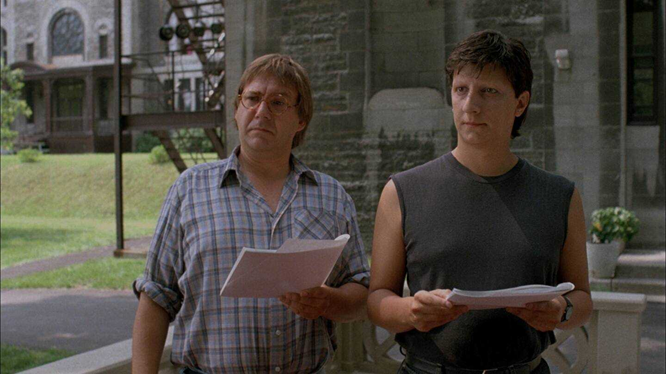
Max Films / Gérard Mital Productions / Éléphant
JÉSUS DE MONTRÉAL
Denys Arcand | Québec | 1989 | 119 minutes
En 1989, j’étais une theatre kid. J’étudiais le jeu et la musique à l’école secondaire, avec l’intention de devenir comédienne. Quand j’ai appris qu’un film québécois portait sur une troupe qui interprétait une nouvelle version de La Passion du Christ, je savais que je devais le voir. J’étais curieuse, tout particulièrement parce que j’adorais jouer devant le public. Qu’est-ce que ce film me dirait de la vie d’actrice, du théâtre au Québec et des nouvelles formes d’expression artistique ? Je me suis donc rendue au cinéma pour regarder Jésus de Montréal.
Pour moi, une adolescente de Toronto, Montréal était la ville la plus cool du Canada. Là où le loyer n’était pas cher et l’art était subversif. Du moins, selon mon impression. En visionnant Jésus de Montréal, j’ai appris que ce n’était pas exactement le cas. Le film de Denys Arcand explorait une culture soumise à une Église conservatrice, à laquelle les artistes résistaient.
Je me souviens d’avoir été étonnée par la pièce de théâtre dans le film, qui avait lieu dehors, au milieu du public, dans une interprétation courageuse et éprouvante. Je voulais faire du théâtre comme ça. J’ai ri à voix haute dans la scène où Martin double le film pornographique. Je me demandais si je pouvais avoir un travail de narratrice comme René. Je me suis demandé : serais-je disposée à m’exposer au sexisme, simplement pour un emploi, comme Mireille ? Je voulais avoir le courage de mes convictions artistiques, comme Daniel.
Je n’avais pas encore visité Montréal. Le film m’a montré une ville passionnante, mais aussi un peu sombre et sale. J’adorais les plans grandioses du Mont-Royal, ou le travelling dans un long couloir de tour à bureaux. Pour moi, c’était un métissage parfait entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Aujourd’hui, je peux reconnaître la vue du Mont-Royal et je peux nommer plusieurs des édifices. Je reconnais la station de métro Place-d’Armes, et même le garage de l’Université de Montréal. Je ne suis pas devenue actrice, mais j’espère faire partie de la vie culturelle de Montréal. Jésus de Montréal était le début de mon amour pour la ville que j’ai choisie.
— Shelagh Rowan-Legg
*
Shelagh Rowan-Legg est autrice, spécialiste du cinéma, et cinéaste. Elle est rédactrice pour ScreenAnarchy et a été publiée dans Sight & Sound et Fangoria. Ses courts métrages ont été projetés dans des festivals comme Fantasia, POFF Shorts, et Revelation Perth Film Festival. Son livre The Spanish Fantastic: Contemporary Filmmaking in Horror, Fantasy and Sci Fi a été publié par Bloomsbury en 2016, et son prochain livre, Not Academically Respectable: The Early Films of Eloy de la Iglesia, sera publié par University of Liverpool Press en 2028.

Les Films Allegro / Triumph Films / Fries Film Company
SCREAMERS
Christian Duguay | États-Unis, Canada, Japon | 1995 | 108 minutes
Mes parents nous avaient dompés chez mes grands-parents pour la fin de semaine. Je m’en souviens ; c’était le 26 janvier 1996. J’étais toujours excité d’aller dormir chez mes grands-parents ; ils nous laissaient veiller tard, et nous amenaient louer des films d’horreur au club vidéo. Ils avaient même une petite télé sur le comptoir de la cuisine, ce qui aurait été impensable chez nous. C’est là-dessus que j’ai découvert Screamers. Le film sortait en salle, et le téléjournal en faisait la promotion de sa manière tout informative dont j’étais encore dupe à l’époque, d’autant que j’étais complètement obnubilé par la proposition…
Pour mon moi de 12 ans, le cinéma québécois, c’était surtout des drames familiaux plates, des Contes pour tous ou des grosses comédies populaires, comme Cruising Bar ou Elvis Gratton. Mais pas des films de science-fiction d’horreur ! Alors, quand j’ai vu Roy Dupuis en soldat futuriste qui se promenait sur une poutre dans un bunker en aiguisant son couteau, j’étais vendu. Je ne connaissais pas Philip K. Dick ou Dan O’Bannon, Peter Weller ou Christian Duguay. Je n’avais pas conscience du concept de cheap labourcinématographique. Je savais juste que le film était fait che nous ! Alors, j’ai insisté pour que mon grand-père nous emmène le voir, et j’ai eu un fun noir.
Screamers, c’est le film parfait pour un préadolescent de 1995. Ça commence par un démembrement à la scie ronde volante, avec du CGI pas trop bon, mais qu’importe ! Ça fait futuriste ! Il y a un bel assortiment de bibites tueuses et de one-liners ; on voit même une jolie fille (Jennifer Rubin) toplessde dos. Et de la direction artistique, en veux-tu, en v’là : un désert postapocalyptique tourné à Joliette et un centre de commandement dans le Stade olympique, avec beaucoup de neige et de débris entre les deux. Et puis, il y a Roy Dupuis en badassqui cite du Shakespeare à un Peter Weller étrangement investi, qui lui répond cyniquement : « Je ne savais pas qu’ils mettaient du Shakespeare dans les bandes dessinées. » Malade.
— Olivier Thibodeau

Corporation Image M & M
SONATINE
Micheline Lanctôt | Québec | 1984 | 91 minutes
Je devais avoir l’âge de Chantal (Pascale Bussières) et de Louisette (Marcia Pilote) lorsque j’ai vu pour la première fois Sonatine, c’est-à-dire autour de 12 ou 13 ans. Et si je n’ai aucun souvenir de comment j’ai pu avoir accès à ce film (la télévision ?), l’impression forte de voir s’incarner devant moi une forme de ma mélancolie adolescente, voire de désespoir, reste encore vive à mon esprit. Mais au-delà du processus d’identification, chevillé à la présence crève-écran des deux jeunes comédiennes, et à la si belle nuit qui, dans les deux premiers tiers du film, se charge de faire apparaître la nébulosité et l’éclat de leurs personnages, ce qui m’avait alors forcément ébranlée, c’était l’éveil de ma conscience à cette idée si troublante de mettre en scène le suicide de deux adolescentes dans le métro de Montréal. C’est-à-dire que, au-delà du suicide comme nœud tragique, et au-delà de ces portraits d’adolescentes en quête d’échappées, Sonatine m’a fait prendre conscience qu’il y avait quelque chose comme un choix et une façon de montrer, un choix artistique et d’auteur·trice. Ce film est ainsi venu dégommer la suspension enfantine de mon incrédulité, cette modalité narrative et de mise en scène par laquelle nous pactisons avec l’œuvre sans forcément en interroger l’opacité.
19 juin 2025. Je revois le film pour en parler ici. Ce qui me frappe aujourd’hui, ce sont toutes ses textures — visuelles, sonores, Sonatine comprend 64 pistes de son ! — et sa tonalité akermanienne. Le suicide comme acte cinématographique, la nuit filmée, les rencontres expérimentales avec des inconnus, le flux des transports allant de pair avec un intercalaire sens de soi : autant d’enveloppes qui me font rattacher Sonatine au cinéma de Chantal Akerman. Il ne s’agit pas ici d’amenuiser le geste de Lanctôt, de ramener servilement sa radicalité et l’épaisseur de son travail à une figure européenne récemment devenue iconique, mais plutôt de l’inscrire dans la partition inachevée de mes engouements et de mes éveils, d’en révéler tout le pouvoir d’intertextualité affective et d’enchantement sensoriel, d’étendre son amorce, des années plus tard, afin de me montrer fidèle à sa qualité d’éclosion.
— Maude Trottier

Cirrus Communications
C.R.A.Z.Y.
Jean-Marc Vallée | Québec | 2005 | 127 minutes
Nichée à Notre-Dame-de-Grâce en haut d’une côte, mon école secondaire était vieille, catholique et pour filles seulement. Nous assistions régulièrement à la messe et prenions la communion. « Je vous salue Marie, pleine de grâce… » et d’autres prières résonnaient entre les murs de nos classes mal isolées tous les matins. L’école était également divisée en deux parties, l’une francophone, l’autre anglophone. J’allais à l’école anglaise.
Au cours de mes cinq années dans ce collège, nous avions regardé quelques films québécois, mais ils ne nous avaient jamais vraiment inspirées. C’est seulement durant ma dernière année, lorsqu’une professeure nous avait montré C.R.A.Z.Y., que tout a changé. Dans la première partie du film, alors que Zac est à la messe de minuit, à Noël, et que la chanson « Sympathy for the Devil » joue alors qu’il s’élève vers le plafond, c’était comme un moment d’extase. L’écrou qui s’était resserré sur nous pendant cinq années de répression, d’ordre et de honte avait paru se détendre en un instant de catharsis pure. Cela semblait si familier, capturant une douleur locale et un désir universel. Le film avait été si populaire que les étudiantes réservaient des salles de classe pour le regarder pendant l’heure du lunch ; des groupes de filles le visionnaient encore et encore et encore. Pour plusieurs d’entre elles, c’était un film qu’elles n’auraient jamais la permission de regarder à la maison. Certains parents avaient choisi mon école parce qu’elle était très performante et compétitive, mais d’autres l’avaient préférée parce qu’elle était religieuse, stricte et n’accueillait que des filles.
Durant mes cinq années à ce collège, les côtés francophone et anglophone ne s’étaient réunis que rarement. La dernière occasion avait été un brunch de graduation. Chaque promotion pouvait choisir une chanson pour la remise des diplômes ; c’était habituellement une bluette pop sentimentale pas trop osée. Les profs, qui ignoraient l’emprise exercée par C.R.A.Z.Y. sur les élèves, étaient perplexes face à notre choix. Des paroles imprimées avaient été passées à travers la salle et tout le monde avait entonné : « Vers les docks où le poids et l’ennui me courbent le dos… Emmenez-moi au bout de la terre / Emmenez-moi au pays des merveilles… »
— Justine Smith
Traduction : Claire Valade
*
Justine Smith est une critique de cinéma et une programmatrice de festival basée à Montréal. Elle conçoit minutieusement la section Underground du Festival international de films Fantasia et siège actuellement au comité de sélection de la 2e Semaine de la critique de Montréal. Pour le réseau CBC, elle rédige une chronique mensuelle intitulée Le Bel Écran consacrée à la culture cinématographique québécoise pour un auditoire anglophone. Elle écrit présentement son premier livre.

ONF
LA FAIM
Peter Foldès | Québec | 1974 | 11 minutes
Lorsque j’avais 6 ans, mon père avait décidé de m’emmener assister à un concert qui devait être enregistré pour la télé devant public au fameux Studio 42 de Radio-Canada, où il travaillait comme réalisateur. Cette sortie visait à me récompenser pour ma fin d’année scolaire à la maternelle. On était en juin, l’après-midi, au début des vacances d’été, et il faisait chaud dans le train de banlieue qui nous portait vers le centre-ville de Montréal depuis Cartierville.
Le concert m’avait semblé interminable. Mon père avait eu beau me dire qu’il durait une demi-heure, comme Bobino que j’adorais, la musique classique n’avait pas le même effet sur moi que les farces de Bobinette. Après le concert, on avait mangé à la cafétéria, puis vagabondé dans les corridors labyrinthiques de la tour du boulevard Dorchester (à l’époque). Entre le département des costumes, l’immense atelier des décors et les fabuleux créateurs du service graphique (dont Frédéric Back, qui m’avait déjà offert un dessin original esquissé sous mes yeux), on était tombé·e·s sur un groupe de collègues de mon père qui se dirigeait vers une salle de visionnement pour une projection de courts métrages tout frais sortis de l’ONF. Il commençait à être tard, mais comment résister à des dessins animés ? C’est ce soir-là que j’ai découvert le génie créateur des artistes de l’Office. Surtout, c’est ce soir-là que j’ai vu La faim pour la première fois.
Quel choc ! Pionnier de l’animation assistée par ordinateur, La faim trace dans un style métamorphique sans paroles un personnage qui en veut toujours plus, grossissant jusqu’à des proportions grotesques. Un destin macabre l’attend : il finit dévoré par une meute d’enfants affamés ! Image profondément troublante des excès du consumérisme. Alors que j’étais déjà affectée par les scènes de famine en Afrique inondant les actualités que mes parents regardaient chaque soir, le message avait frappé de plein fouet — littéralement traumatisé ! — la petite Québécoise ordinaire que j’étais. Mais dans ma fatigue de la longue journée, j’ai cru pendant des décennies avoir rêvé ce film. Ce n’est que dans la trentaine que j’ai pu confirmer qu’il existait bel et bien.
— Claire Valade
BONNE SAINT-JEAN
DE LA PART DE TOUTE
L'ÉQUIPE DE PANORAMA-CINÉMA !
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
