
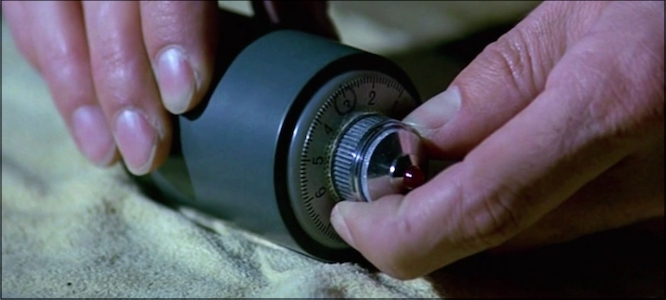
Comme n’importe quel cinéphile en peine, Frank Beauvais s’est enterré de terre d’images durant quelques mois. En 2016, suite à une rupture avec son copain, il regarde 400 films et en tire maintenant un seul de la consolante boulimie, un sublime film de montage, qu’il narre doucement, s’auscultant le cœur, réfléchissant ouvertement à son rapport au cinéma, au vertige de sombrer « dans les films des autres » alors que lui, réalisateur de nombreux courts métrages et consultant musical, ne parvient pas à trouver la force pour tourner de nouveau. Plutôt que de forcer la manivelle, Beauvais sculpte dans son malheur le monument de sa sortie de crise. Il dira plus tard qu’il n’aime pas les journaux intimes, l’écriture de la peine qui la fige, l’amplifie dans la relecture, la donne entière aux aléas passés, de la prise de hauteur et de perspective qui fait du texte une ancre dans le temps. Et si la voix off tient, elle, du style d’un cahier de méditations discrètes, c’est sa superposition aux images rapides, décontextualisées, qui empêche le verbe de se figer, d’être cette coagulation d’émotions qui brouille le souvenir.
Et comme Beauvais veut avancer, comme son film s’intitule Ne croyez surtout pas que je hurle et qu’il faudrait être bien bête pour y voir un énième film intimiste qui cherche candidement à transformer la tristesse en honneur, le cinéaste regarde le cinéma et puise dans celui-ci une impressionnante série d’images captives de sa mémoire, images fortes, perceptuellement pures de toute édification symbolique trop appuyée, fonctionnant plutôt sur la logique d’une succession de jets d’images comme d’autres jettent de la peinture. Pour faire la paix avec ses souvenirs, Beauvais utilise ceux du cinéma pour trouver de la poigne, danser un peu avec eux. Il remonte ainsi quelques années plus tôt, aux retrouvailles forcées avec son père qu’il avait ignoré, et qui vient habiter chez lui le temps de mourir en redécouvrant un vieux film de son enfance, Le ciel est à vous de Jean Grémillon. Le moment communal, qui transite à travers l’écran, anticipe dramatiquement la fin précipitée du père, sa présence fantomatique qui s’accroche dès lors au fauteuil en forme de cercueil dans lequel continuera de siéger le fils jusqu’au bout des visionnages dont on voit aujourd’hui la mise en film. Reporté ensuite au présent de la tristesse relationnelle, le spectateur comprendra mieux, et toujours un peu mieux — Beauvais démontre une habilité remarquable à maintenir intègre le fil narratif de sa confidence — comment le cinéma, quand on le dirige vers l’intérieur de la déprime, devient « un miroir et non une fenêtre », dont le pouvoir d’évocation, dont la capacité à créer des « personnages de fiction qui retombent sur leurs pieds » pendant que « moi, personne ne me regarde », participe à inscrire le spectateur (Beauvais et nous et moi), comme le personnage conceptuel du film, le rhéteur d’images et d’émotions qui se laisse bercer par l’écran en espérant fort qu’une image parmi tant d’autres lui procurera une de ces consolations dont le réel n’a plus le secret.
Car le réel que Beauvais décrit à travers les images, celui de son exil en Alsace catholique, entouré par l’« habitant », choqué par ses cultes enracinés, sa vanité touristique, ses penchants idéologiques et politiques, sa réception on ne peut plus lointaine des événements (les attaques terroristes du Bataclan, à Nice, en Syrie, en Irak, les « records » battus du nombre de réfugiés noyés) qui trouvent dans les médias une « fabrique des martyrs », sa recherche éperdue d’un miracle culturel qui prendra la forme d’un petit concert en plein air, tous ces escaliers descendent vers le creux d’une confrontation à la mortalité, à sa simplicité et à celle de ceux qui ne la considèrent pas assez. Là se recoupent dans l’utopie cinématographique les élans introspectifs que le cinéaste parvient à construire. Film érotique par-ci, film soviétique par-là, le corpus des œuvres découpées est composé, de l’aveu même de la voix qui s’en sert, de films qui mettent en scène un rapport au monde, qui s’interrogent sur la place de ses protagonistes non seulement dans l’intrigue mais aussi dans la société (comme dans cette belle comparaison entre les personnages occidentaux et les personnages du Bloc de l’Est). De la chute amoureuse on passe à la difficulté de rejoindre ce monde qui semble tout devancer et, galopant, tout chambranler.
« Maintenant, j’ai une hache ». Ce sont les paroles d’une chanson éponyme de Zippo restées dans la tête de Beauvais et qui donnent de l’impulsion salvatrice à la dernière partie du film, qui lui permettent de trancher, montrant bien comment les illusions personnelles que procurent les images sont des forces transformatrices, que la « pellicule analgésique » participe à la fois d’un miroir pour l’âme et d’un « droit au plaisir » qui fait basculer l’un dans l’autre, comme le plaisir de s’y enfouir malgré la tristesse inhérente au geste. De ce droit au plaisir jaillit aussi la force générale de Ne croyez surtout pas que je hurle, c’est-à-dire sa capacité à construire dans le temps des morceaux émotifs qui tiennent par eux-mêmes, dans leur histoire comme dans leur résolution, fragments qui, à l’instar des doutes de Beauvais face à l’écriture, refusent l’immobilisme mortifère du texte en préférant la préservation visuelle et sensible de la richesse d’une image de ce qui a été. Le regard reste, les mots doivent partir.
8 |
 |
envoyer par courriel | 
| imprimer | Tweet |
