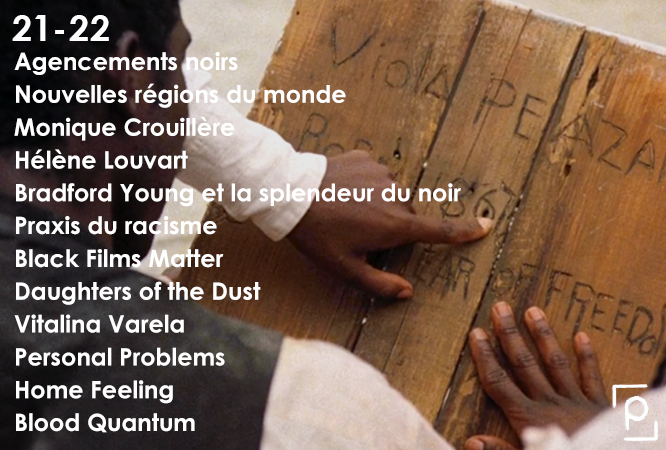AGENCEMENTS NOIRS
« Le train s’engouffra dans le noir avec un abandon phallique, dans le noir qui s’ouvrait pour le recevoir, s’ouvrait, s’ouvrait ; le monde entier tremblait sous leur accouplement. »
– James Baldwin, Un autre pays
Dans ce voyage en train sur l’épine dorsale new-yorkaise, Rufus, le protagoniste noir d’Un autre pays, observe les Blancs et les Noirs se mêler dans la foule serrée, suintante, d’un wagon. C’est dans l’obscurité du tunnel que le noir vient tout recouvrir sans discrimination, ouvrir à une danse des peaux et des sexes, des identités et des rapprochements, que la lumière du jour vient ensuite défaire dans son éclairage impassible des différences symboliques.
*
De plus en plus, l’agentivité et l’intersectionnalité s’affirment comme les maîtres-mots de l’époque. Le premier est un concept qui met en valeur les moyens d’action possibles à travers les structures, les environnements ; les personnes noires ont longtemps eu peu d’agentivité dans l’appareil légal américain. Le second, l’intersectionnalité, sert à décrire les mitoyennetés qu’entretiennent les communautés marginalisées à travers certaines jonctions ; comme la condition féminine, que partagent les femmes blanches, noires, toutes les femmes du monde au-delà de leurs conditions d’origines respectives.
Ces deux termes sont au centre des mouvements actuels contre le racisme et la brutalité policière. Ils révèlent d’une part l’impuissance systémique ressentie par des communautés marginalisées et d’autre part la nécessité pour celles-ci de se reconnaître et d’agir sur un front partagé. L’agentivité est opérabilité des possibles, l’intersectionnalité est partage des conditions. Les deux gagnent à se réfléchir ensemble car ils assurent aux voix minoritaires une présence de corps et d’action. Et à les penser ensemble, on réalise rapidement qu’ils appellent à la constitution d’un nouveau corps social. Il ne s’agit pas d’une prophétie mais de quelque chose de très concret, de très attendu surtout. Sans oublier que le militantisme antiségrégationniste, anticapitaliste, ne date pas d’hier, il est bon de noter aujourd’hui que ce militantisme a évolué en englobant une part grandissante d’alliés venus de tous les horizons, notamment parce que les réseaux sociaux permettent à ces communautés une constitution plus forte, plus ouverte, plus accessible, plus mondiale.
Ces deux termes sont aussi les nouveaux nexus des sciences humaines, des études culturelles, de ce que la droite capitaliste et libertarienne nomme souvent « l’agenda de la gauche », en faisant référence à la propension qu’ont ces deux idées à se décliner à toutes les sauces : cela touche autant les questions d’appropriation culturelles soulevées quand un dramaturge monte une pièce de théâtre sans la coopération des cultures représentées (Kanata) que lorsque des victimes d’agressions sexuelles demandent à être entendues dans un ras-le-bol que la légitimité transforme en raz-de-marée (#metoo) ou lorsque des groupes, des fans, des organisations, réprimandent ou encensent des productions cinématographiques au nom de la diversité humaine qu’ils osent représenter ou non. Si chacun de ces enjeux, pris individuellement, s’inscrit dans sa propre histoire, leur agentivité et leur intersectionnalité génèrent dorénavant une transversalité qui fabrique de nouvelles forces communes qui font, au-delà des inévitables pots cassés, beaucoup de bien à l’équilibre du pouvoir dans les sociétés occidentales. Reste à voir comment parfaire leur organisation, comment y loger des mécanismes d’autorégulation (ce qui est en train de se dérouler dans le milieu littéraire québécois), comment faire mieux comprendre les structures sociales qui incubent les réflexes racistes ou xénophobes (c’est ce que le documentaire Briser le code, réalisé par Nicolas Houde-Sauvé et narré par Fabrice Vil, fait très efficacement).
Ce premier numéro double aborde ces questions par l’entremise du cinéma, où elles se déploient avec complexité car elles sont projetées sur un écran dont l’histoire des genres, des stéréotypes et des tendances est intimement liée à l’histoire des sociétés qui ont fait ces films, sans compter que le réalisme cinématographique confère à ces questions une réflexivité qui ne cesse de se réfracter dans les outils mêmes du cinéma et dans la manière dont leur savoir-faire s’est transmis et édifié.
C’est pourquoi un numéro sur le cinéma noir s’imposait, avec comme élément déclencheur le meurtre révoltant de George Floyd survenu en pleine rue le 25 mai dernier. Sur ces images en tant que telles, André Habib a signé pour Hors Champ un de ces beaux textes tremblants dont il a le secret, mais pour nous l’occasion était d’aborder le racisme systémique sous l’angle des systèmes du cinéma, de voir ce qui les traverse ou les renverse, de faire une échographie des représentations systémiques qui mènent à ces affrontements de plus en plus violents entre les désirs conjoints des manifestants et la volonté du système politique américain à dissoudre ces désirs dans la « loi et l’ordre », comme en témoignent encore aujourd’hui les violences paramilitaires du CBP à Portland. Ce n’est donc pas un numéro qui pouvait se limiter à une réflexion sur la représentation, sur la parité, parce que nous ne voulions pas prêcher des convertis, mais surtout parce que ces critères importants sont des critères industriels, pas esthétiques, et que si le cinéma peut faire quelque chose pour s’agencer sur les intersections de ces luttes collectives, ce ne sera pas dans la comptabilité d’une diversité, aussi représentative soit-elle.
Ce numéro n’est donc pas une célébration simplement auteuriste d’une poignée de créateurs noirs. Il s’agit d’une réflexion tenue au long cours à travers une dizaine de textes qui réfléchissent comment le cinéma filme les personnes noires, ce qu’il fait de la plasticité noire de leur peau, comment il s’agence entre ces peaux que le pouvoir blanc a transformé en stigmate et une symbologie plus générale du noir comme obscurité, comme ténèbres. Or le noir au cinéma, c’est aussi ce qui permet à la lumière d’exister — c’est dans le noir que le monde apparaît, qu’il se dessine tel qu’il est. Ces agencements noirs s’établissent dès lors dans une positivité que ce numéro cherche à prolonger dans une réflexion esthétique et politique, à savoir que s’attacher à la perspective noire au cinéma, cibler l’inaliénable des couleurs de la peau, c’est permettre à la critique de percer l’hégémonie cinématographique occidentale et blanche, de voir apparaître les fêlures qu’il nous faut encore guérir, de prolonger le tunnel de Baldwin afin d’embrasser la condition noire par ces agencements noirs que nous proposons dans ces textes.
Agencements entre des machines techniques et des individus, entre des stéréotypes et des êtres humains, des agencements qui, en se mettant du côté de la non-couleur du noir et des personnes noires, nous permettent d’aborder ces appareils (comme la caméra) et ces structures (comme le montage) en soustrayant les questions évidentes (toute réponse à « est-ce que ce film est raciste ? » doit nécessairement découler de l’évidence) afin de mieux nous concentrer sur la fabrique des images du cinéma et aux pratiques émancipatoires qu’il appelle.
Ainsi nous revenons par la bande à notre plus récente rétrospective qui avait eu lieu l’hiver dernier à la Cinémathèque québécoise, « Directrices de la photographie », où des rencontres avec Monique Crouillère, l’une des premières directrices photo du Québec, et avec Hélène Louvart, la grande collaboratrice d’Alice Rohrwacher, permettent d’emblée de réfléchir à ces questions, alors que ces femmes racontent leur parcours, leur démarche et leur approche de l’altérité au cinéma. Par voie de traverse, ces approches rejoignent directement le texte de Miryam Charles, cinéaste noire, directrice de la photographie, qui nous parle du lieu où elle se tient quand elle filme et réfléchit le cinéma — une poignée de ses films en accès libre accompagnent ses « Nouvelles régions du monde ». À sa suite, le texte d’Olivier Thibodeau sur le directeur de la photographie Bradford Young souligne bien les enjeux techniques de la représentation des personnes noires à l’écran. Ensemble, ces quatre articles autour de la direction photographique forment une première approche de ces agencements noirs, moulée dans une intersectionnalité qui souligne aussi la présence créatrice des femmes derrière la caméra.
Je propose ensuite une réflexion sur la pratique du racisme au cinéma à travers le montage, en revenant aux alternances de Griffith et à deux séries à succès récentes qui ont abordé la ségrégation noire aux États-Unis, la minisérie Watchmen de HBO et la deuxième saison de Mindhunter produite pour Netflix. Pour ouvrir sur un index de découvertes à faire afin de prolonger la réflexion, David Fortin livre une imposante liste d’œuvres afro-américaines emblématiques qui forment une histoire sélective de leur évolution. Une nouvelle collaboratrice, Ouennassa Khiari, offre ensuite une réflexion autour de la transmission et de l’héritage culturel dans Daughters of the Dust, chef-d’œuvre du cinéma indépendant de Julie Dash. Itay Sapir, que nous avions lu lors de la couverture du FIFA, revient avec une perspective picturale sur Vitalina Varela de Pedro Costa, ouvrant les frontières politiques du noir aux obscurités de la peinture de Caravage dans un geste original et transhistorique. Thomas Filteau, un autre nouveau collaborateur, livre une perspective plastique sur l’utilisation de la vidéo, de l’imparfait et des tropes du soap opera dans l’expérience télévisuelle unique de Bill Gunn, Personal Problems. Claire-Amélie Martinant souligne quant à elle l’apport de la première cinéaste noire au Canada, Jennifer Hodge, à travers son seul long métrage, Home Feeling: Struggle for a Community, qui ausculte les tensions raciales dans le quartier Jane-Finch de Toronto. Enfin, Marie-Eve Bradette, nouvelle collaboratrice elle aussi, livre une analyse précise et documentée du mal-aimé Blood Quantum, le nouveau film de Jeff Barnaby qui s’approprie les stéréotypes du film de zombi en les agençant à la cause autochtone dans une démarche qui rappellera les stratégies utilisées dans les films afro-américains qui composent l’essentiel de ce numéro.
Pour finir, j’aimerais remercier Miryam Charles, Ouennassa Khiari et Maude Trottier pour leur participation à un comité de lecture externe, le premier que nous organisons en vue d'une publication. Leurs commentaires et leurs retours sur les textes ont veillé à ce que ce numéro soit cohérent avec ses sujets et leur ambition théorique.
Ces agencements noirs n’ont rien d’exclusif, ils ne cherchent pas plus à inverser les polarités des couleurs de la peau qui, au demeurant, sont des constructions sociales. Il s’agit plutôt de s’accrocher à la condition noire au cinéma comme étant la plus exemplaire des maltraitances du cinéma occidental avec celle des autochtones. Et s'y accrochant, de réévaluer ce que produit la caméra, ce qu'organise le montage, ce que transmettent les récits. Ces agencements noirs sont à l’image du wagon de train de Baldwin : l’occasion d’éclipser la fausse neutralité du jour pour mieux célébrer les éclats du noir.
Mathieu Li-Goyette
Rédacteur en chef
|
|

   

    
|